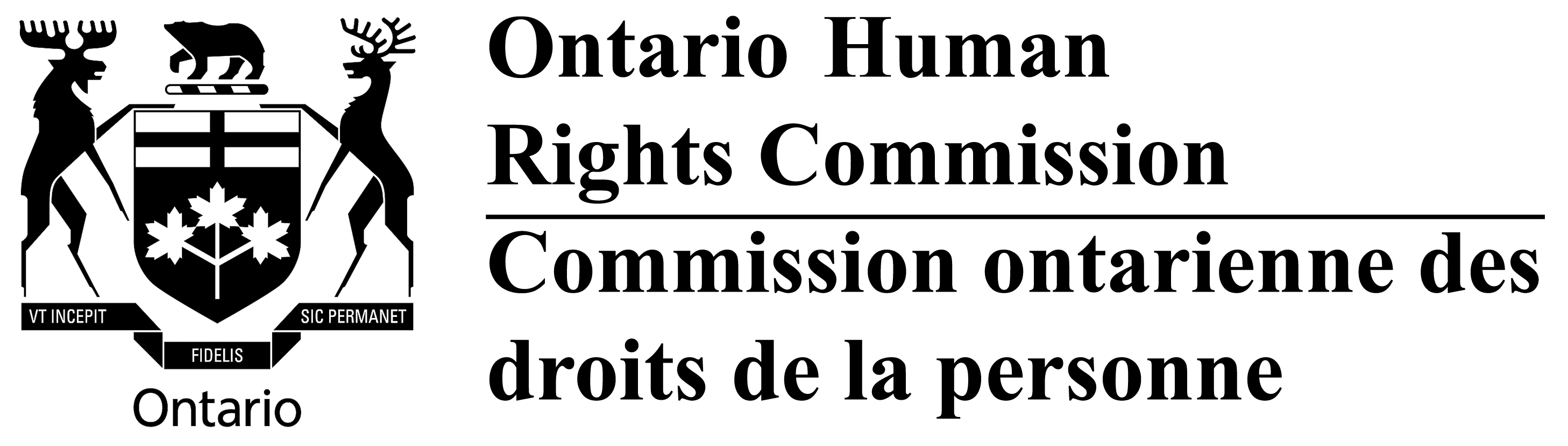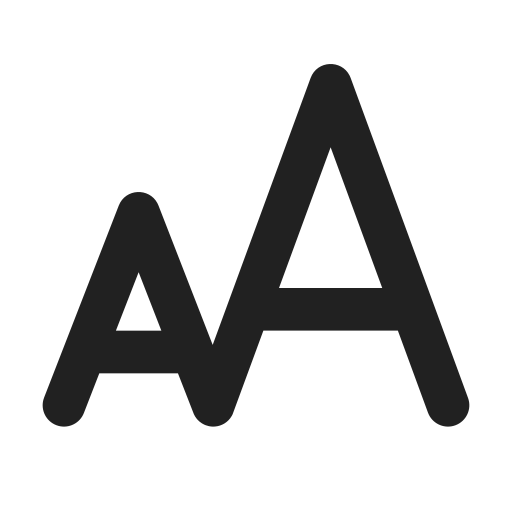Le terme «croyance»[1] n'est pas défini dans le Code. La Commission ontarienne des droits de la personne a cependant adopté la définition suivante :
On entend par croyance une «croyance religieuse» ou une «religion», ce qui est défini par un système reconnu et une confession de foi, comprenant à la fois des convictions et des observances ou un culte. La foi en Dieu ou en des dieux, ou en un être suprême ou une divinité n'est pas une condition essentielle de la définition de croyance.
La Commission accepte le terme religion dans son sens le plus large, par exemple des groupes confessionnels sans divinité, comme les principes et pratiques spirituelles des peuples autochtones, ainsi que les nouvelles religions de bonne foi (chacune étant évaluée individuellement).
Pour qu'il y ait croyance au sens de la loi, il faut et il suffit qu'il y ait à la fois des convictions et des pratiques religieuses, pourvu que ces convictions soient entretenues et que ces pratiques soient observées de façon sincère.
Le terme "croyance» est défini de façon subjective. Le Code protège les convictions, pratiques et observances religieuses personnelles, même si elles ne sont pas un élément essentiel de la croyance[2] ourvu que la personne y croit sincèrement.
La Commission a pris pour position que chaque personne a le droit de vivre à l'abri de la discrimination ou du harcèlement fondé sur sa religion ou sur le fait qu'elle ne partage par la religion de la personne qui la harcèle. Ce principe s'applique également lorsque les personnes visées par le comportement discriminatoire n'ont aucune conviction religieuse, y compris les personnes
athées ou agnostiques, qui elles aussi bénéficient de la protection définie dans le Code.[3]
Dans les deux cas, il faut qu'il soit question de croyance - soit que la personne faisant l'objet de discrimination cherche à pratiquer sa propre religion, ou que la personne qui fait du harcèlement ou de la discrimination essaie d'imposer sa propre croyance à une autre personne. Dans les deux cas, il faut qu'il soit question de croyance.
Le terme croyance ne comprend pas les réalités suivantes :
- convictions profanes, morales ou éthiques
- convictions politiques[4]
- religions qui incitent à la haine ou à la violence contre d'autres groupes ou personnes,[5] et
- pratiques et observances qui prétendent avoir un fondement religieux mais qui contreviennent aux normes internationales en matière de droits de la personne ou même au code criminel.[6]
[1] D'autres territoires de compétence canadiens ont adopté des mesures législatives en matière de droits de la personne qui utilisent le terme «religion» comme motif illicite de discrimination. Pour une étude des décisions portant sur la «croyance» ou sur la «religion», voir Tarnopolsky, Discrimination and the Law (Toronto: Richard deBoo, 1985); pp. 6-1 à 6-6.
[2] Voir Singh v. Workmen's Compensation Board Hospital & Rehabilitation Centre (1981), 2 C.H.R.R. D/549 (commission d'enquête ontarienne); Bhinder v. Canadian National Railway Co. (1981) 2 C.H.R.R. D/546 (tribunal de la Commission canadienne des droits de la personne), infirmé [1983] 2 F.C. 531, confirmé [1985] 2 S.C.R. 561.
[3] Les athées nient l'existence de Dieu; les agnostiques sont d'avis que l'on ne sait rien et que l'on ne peut probablement rien savoir de l'existence de Dieu.
[4] Voir cependant Obdeyn v. Walbar Machine Products of Canada Ltd. (1982), 3 C.H.R.R. D/712 (commission d'enquête ontarienne); pp. D/716 - D/717.
[5] Non seulement de tels groupes ne sont pas protégés par le Code, mais ils pourraient bien être sujets à des poursuites en vertu du Code criminel . Les activités illicites de ces groupes devraient être immédiatement signalées à la police.
[6] Par exemple, la mutilation génitale des femmes est une violation des droits fondamentaux des femmes et n'est pas une activité protégée pour des raisons de croyance. Voir l'énoncé de politique de la Commission à ce sujet : Politique sur la mutilation génitale féminine.