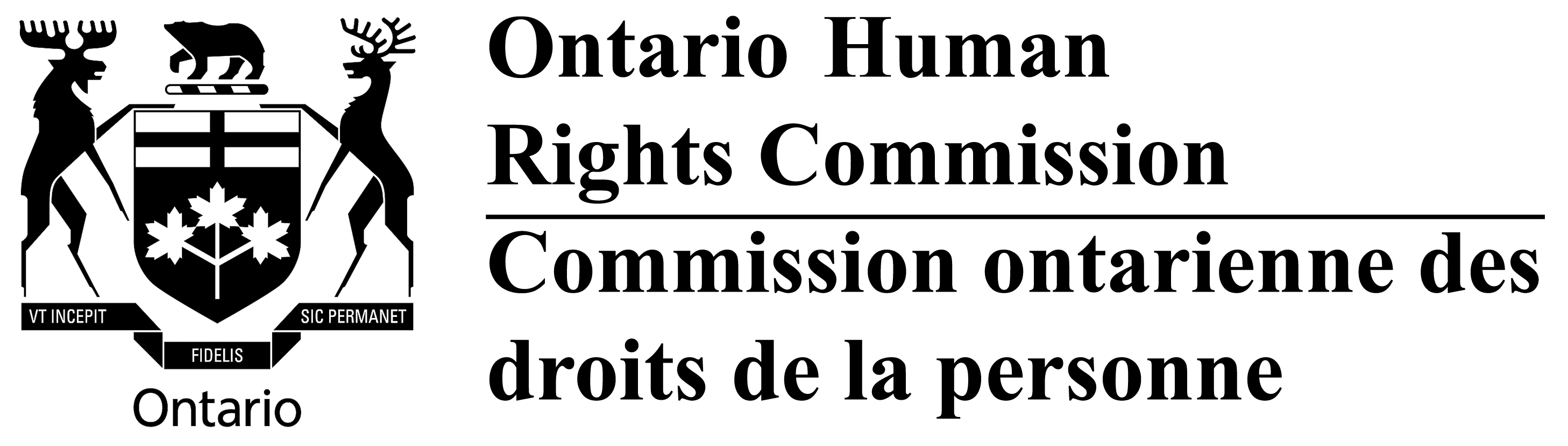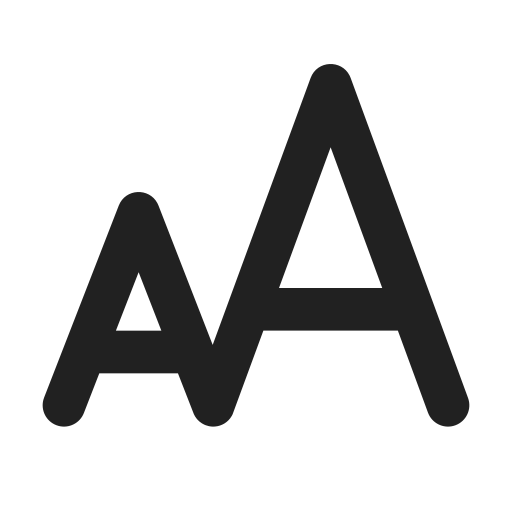Le Code affirme le droit de vivre à l'abri de la discrimination, et le devoir qui y correspond est le devoir général de protéger ce droit. Ce devoir correspondant est le devoir de prendre des mesures d'adaptation pour tenir compte des besoins des personnes et groupes en cause. Ce devoir s'impose lorsque les convictions religieuses d'une personne entrent en conflit avec une exigence, une qualité requise ou une pratique quelconque. Le Code impose le devoir de prendre des mesures d'adaptation pour satisfaire aux besoins du groupe dont la personne demandant l'adaptation est membre. Une adaptation peut se faire en modifiant une règle ou en prévoyant une exception partielle ou totale à la règle pour la personne demandant l'adaptation.
Le paragraphe 11 (2) du Code impose le devoir de tenir compte des besoins des groupes touchés dans les cas de discrimination constructive :
La Commission, le Tribunal ou un tribunal ne doit pas conclure qu'une exigence, une qualité requise ou un critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances, à moins d'être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins du groupe dont la personne est membre ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant.
1. Droits et obligations
Tant la partie responsable de prendre des mesures d'adaptation pour tenir compte des besoins exprimés que la personne demandant les mesures d'adaptation ont des droits et des responsabilités dans ce processus. Voici un tableau illustrant ce fait par quelques exemples :
Personne demandant: Prendre l'initiative de demander une mesure d'adaptation
Personne responsable: Respecter la dignité de la personne qui fait la demande
Personne demandant: Expliquer pourquoi la mesure demandée est nécessaire
Personne responsable: Évaluer le besoin d'adaptation en se fondant sur les besoins du groupe dont la personne est membre.[20]
Personne demandant: Fournir un avis de demande par écrit et allouer le temps nécessaire pour que l'autre partie y réponde
Personne responsable: Répondre à la demande dans un délai raisonnable
Personne demandant: Expliquer quelles mesures d'adaptation sont nécessaires
Personne responsable: Accepter les demandes liées à l'observance des pratiques religieuses
Personne demandant: Faire preuve de bonne foi
Personne responsable: Faire preuve de bonne foi
Personne demandant: Être souple et réaliste
Personne responsable: Considérer d'autres solutions
La personne peut demander des détails sur le coût qu'entraînerait la mesure d'adaptation si l'autre partie invoque un préjudice injustifié
S'il n'est pas possible d'accepter la demande en raison d'un préjudice injustifié, l'expliquer clairement à la personne concernée et être disposé à le lui démontrer.
Dans certains cas, il pourrait ne pas être possible de résoudre entièrement le problème sans causer un préjudice injustifié à la personne responsable de prendre des mesures d'adaptation. La mesure d'adaptation peut être considérée acceptable si elle répond aux besoins de la personne autant qu'il est possible de le faire sans causer un préjudice injustifié, tout en respectant la dignité de la personne qui demande l'adaptation.
2. Les syndicats et le devoir de tenir compte des besoins
Dans le cas de discrimination en milieu de travail, la direction tout comme le syndicat ont le devoir de prendre des mesures d'adaptation. Dans l'affaire Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud[21], le tribunal a indiqué que même si le principe de la responsabilité conjointe existe, c'est l'employeur qui est en charge du milieu de travail et qui est le mieux placé pour élaborer les mesures d'adaptation. Il est donc normal de s'attendre à ce que l'employeur prenne l'initiative du processus menant à des mesures pour adapter le milieu de travail aux besoins d'un membre du personnel. Cependant, le tribunal a également indiqué que le syndicat n'est pas dispensé de ses devoirs à cet égard, et il est en faute s'il omet ou refuse de proposer des mesures possibles pour tenir compte des besoins des membres visés. En d'autres mots, lorsqu'un syndicat participe avec l'employeur à la discrimination, il partage l'obligation d'éliminer ou d'amoindrir la source des effets discriminatoires.[22]
Exemple : M. Renaud, un concierge d'école, s'est plaint que le conseil scolaire et le syndicat ne se sont pas entendus sur une façon de modifier son horaire. M. Renaud est adventiste et ne peut pas travailler le vendredi après-midi. Il a été décidé que le syndicat, de concert avec l'employeur, avait le devoir de tenir compte des besoins de M. Renaud, sauf s'il en résultait un préjudice injustifié. Monsieur le juge Sopinka a écrit dans son jugement que le syndicat pouvait être tenu responsable dans deux situations :
en priemeir lieu, il peut causer la discrimination ou y contribuer d'abord en participant à la forrmulation de la règle de travail qui a un effet discriminatoire sur la plaignant. Il en généralement ainsi lorsque la règle est une disposition de la convention collective;
en duexième lieu, un syndicat peut être resoponsable pour ne pas avoir composé avec croyances religieuses d'un employé, même s'il n'a pas participé à la formulation ou à l'application d'une regle discriminatoire. Cela peut se produire lorsque le syndicat gêne les efforts raisonables que l'employeur déploie pour s'entendre avec l'employé.[23]
Dans l'affaire Gohm c. Domtar[24], l'employeur a accepté de tenir compte des besoins de Mme Gohm en changeant son horaire pour qu'elle travaille le dimanche au lieu du samedi, pourvu qu'elle ne touche pas le salaire majoré prévu dans la convention collective. La tentative de l'employeur a été mise en échec par le syndicat. La Cour divisionnaire de l'Ontario a conclu que le syndicat avait agi de façon discriminatoire à l'égard de la personne qui avait déposé la plainte, et a établi le concept de «partenariat égal» :
La discrimination en milieu de travail est l'affaire de tout le monde. Il ne peut y avoir une prépondérance de responsabilité... les sociétés, les syndicats et les particuliers sont tous au premier rang à égalité dans une seule ligne de défense contre tous les genres de discrimination. En décider autrement ne reconnaîtrait pas la vaste portée du mandat et du rôle du Code des droits de la personne. Toute interprétation plus restrictive que celle-ci ne serait pas fidèle au principe et à la politique énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire O'Malley c. Simpson-Sears.[25] [traduction non officielle]
[20] Article 11 du Code. Des personnes peuvent demander des mesures d'adaptation pour des pratiques ou observances religieuses qui ne correspondent pas à des doctrines établies, ou elles peuvent demander une adaptation pour observer une pratique qui n'est pas observée par tous les membres de la croyance. Les codes vestimentaires, régimes alimentaires, et autres sont de bons exemples de pratiques religieuses qui sont observées de façon sincère mais qui ne sont pas nécessairement observées de façon générale par toutes les personnes pratiquant une religion ou partageant une croyance.
[21] Central Okanagan School District No. 23 v. Renaud (1992), 16 C.H.R.R. D/425, Cour suprême du Canada. La Human Rights Act de Colombie-Britannique, qui était en vigueur au moment de la décision, ne mentionnait pas de façon explicite l'obligation de prendre des mesures d'adaptation. Le principe auquel est arrivée la Cour suprême du Canada dans l'affaire Renaud, soit que le syndicat tout autant que l'employeur ont le devoir de tenir compte des besoins, sauf s'il en résulte un préjudice injustifié, s'applique à plus forte raison au Code des droits de la personne de l'Ontario, lequel impose explicitement l'obligation de tenir compte des besoins des personnes identifiées par les motifs illicites de discrimination, sauf s'il en résulte un préjudice injustifié.
[22] Ibidem; p. D/438.
[23] Supra, note 21, pp. D/436 - D/437.
[24] (1982), 89 D.L.R. (4e) 305 (Cour divisionnaire de l'Ontario).
[25] Ibidem; p. 312.