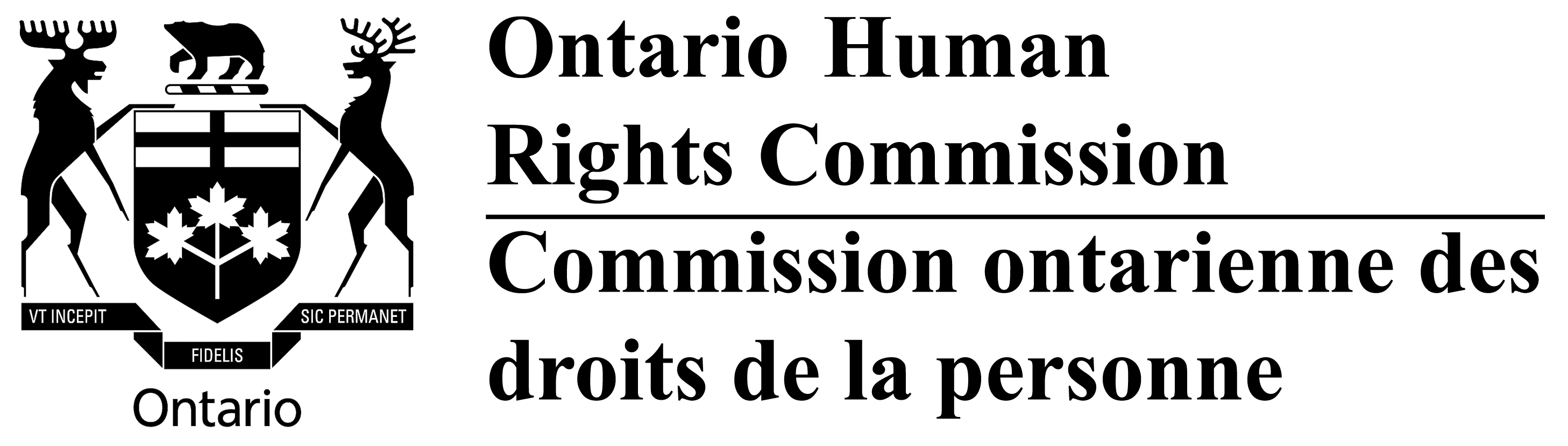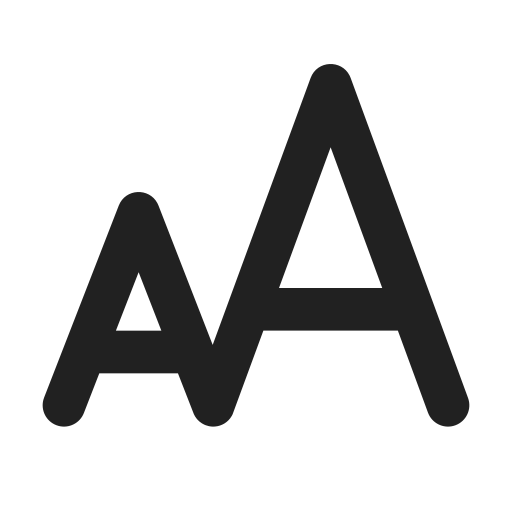2.1 La définition aux termes du Code des droits de la personne
Le terme « handicap » est défini comme suit à l’article 10 (1) du Code :
« à cause d'un handicap » [signifie] [E]n raison de l'existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, de l'une des affections suivantes :
- tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
- un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;
- une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée;
- un trouble mental;
- une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Le terme « handicap » doit être interprété dans un sens large. Il comprend à la fois des états présents et passés, ainsi qu’un élément subjectif, soit un état basé sur la perception d’un handicap. Bien que les alinéas 10 a) à e) comprennent l’énumération de divers types d’états, il est clair que la liste est donnée simplement à titre d’indication et qu’elle est loin d’être exhaustive. La protection des personnes handicapées, aux termes de ce paragraphe, comprend spécifiquement la maladie mentale,[8] les troubles du développement et les difficultés d’apprentissage. Même les maladies ou les infirmités mineures peuvent être des « handicaps » si la personne peut démontrer qu’elle a été traitée injustement à cause d’un handicap présumé[9]. Par contre, si une personne souffrant d’une maladie est incapable de démontrer qu’elle a été traitée injustement en raison d’un handicap réel ou présumé, il lui sera impossible de satisfaire aux critères prima facie de discrimination. Il est toujours essentiel d’examiner le contexte où se situe la différence de traitement afin de déterminer s’il y a eu discrimination et si le motif est le « handicap ».
2.2 La perspective sociale : pour une compréhension plus globale du handicap
La Cour suprême du Canada a jeté une nouvelle lumière sur la manière de comprendre le handicap. Dans Mercier, [10] une cause émanant du Québec, la Cour suprême a indiqué clairement que la notion de handicap doit être interprétée de manière à inclure son aspect subjectif, étant donné que la discrimination peut être basée autant sur des présomptions, des mythes et des stéréotypes que sur l’existence de limites fonctionnelles.
Dans Mercier, les plaignants se sont vu refuser un emploi ou ont été congédiés lorsqu’on a découvert qu’ils avaient des troubles médicaux. Cependant, leur état n’entraînait aucune limite fonctionnelle. Les employeurs ont allégué que, comme leur état ne causait aucune limite fonctionnelle, il ne s’agissait pas de « handicaps » au sens de la loi québécoise sur les droits de la personne. La Cour suprême a rejeté cet argument.
La Cour a décidé de ne pas créer une définition globale de la notion de handicap. Elle a plutôt opté pour un cadre juridique fondé sur la notion d’égalité, qui tient compte de l’évolution de facteurs biomédicaux, sociaux et technologiques. Cette approche comprend une dimension socio-politique qui met l’accent sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité. Ainsi, un handicap peut être le résultat d’une limite physique, d’une affection, d’une limite présumée ou d’une combinaison de tous ces facteurs. On met l’accent sur les effets de la distinction, de la préférence ou de l’exclusion subies par la personne, et non sur la preuve de l’existence de limites physiques ou de la présence d’une affection.
Dans une autre décision[11] rendue plus récemment, la Cour suprême du Canada a confirmé que la création d’un « handicap social », c’est-à-dire la réaction de la société à un handicap réel ou présumé, devrait être l’objet de l’analyse relative à la discrimination.
Cette perspective est compatible avec le Code, qui prévoit l’inclusion d’affections passées, présentes et présumées. Elle permet une interprétation vaste et libérale, tout en favorisant les objectifs poursuivis par le Code.
2.3 Handicaps non apparents
En raison de leur nature ou de leur degré, certains handicaps peuvent passer inaperçus. Le syndrome de fatigue chronique et les maux de dos, par exemple, ne sont pas des affections apparentes. D’autres handicaps peuvent demeurer cachés parce qu’ils sont épisodiques. C’est le cas de l’épilepsie, par exemple. De même, les manifestations d’intolérance au milieu peuvent survenir du jour au lendemain, portant gravement atteinte à la santé de la personne et à sa capacité de fonctionner, tandis qu’à d’autres moments, ce handicap n’est absolument pas apparent. Voici d’autres exemples :
- les personnes dont le handicap ne cause aucune limite fonctionnelle, mais qui font l’objet de discrimination parce que les autres les croient moins aptes;
- les personnes qui se sont remises d’une affection, mais qui sont quand même traitées injustement;
- les personnes ayant un handicap épisodique ou temporaire.
D’autres handicaps peuvent se manifester dans le cadre d’une interaction, par exemple, lorsqu’il est nécessaire de communiquer verbalement avec une personne sourde ou de communiquer par écrit avec une personne ayant des difficultés d’apprentissage. Un handicap peut devenir évident avec le temps, à la suite d’interactions répétées. Il est aussi possible qu’un handicap ne soit révélé que lorsque la personne demande qu’on prenne des mesures d’adaptation. Le handicap peut demeurer non apparent parce que la personne décide de ne pas en dévoiler l’existence pour des raisons personnelles.
Peu importe que le handicap soit apparent ou non, la discrimination dont souffrent les personnes handicapées s’appuie en grande part sur les « concepts » sociaux du normal, qui ont tendance à renforcer les obstacles à l’intégration plutôt qu’à favoriser des moyens pour assurer la pleine participation. Parce que ces handicaps sont « invisibles », ils ne sont généralement pas bien compris par la société. Cela donne lieu à des stéréotypes, des stigmates et des préjugés.
2.4 Handicaps intellectuels
Bien que les handicaps intellectuels soient une forme de handicaps non apparents, ils suscitent des questions particulières qui méritent d’être examinées séparément. Au fil des ans, plusieurs employeurs ont cherché à obtenir des directives portant spécifiquement sur la question des handicaps intellectuels. L’article 10 du Code inclut expressément les troubles mentaux. Les personnes qui ont des handicaps intellectuels sont confrontées à un degré élevé de stigmatisation et à des obstacles considérables dans le milieu du travail.[12] La stigmatisation peut entraîner un climat qui aggrave le stress, ce qui risque de provoquer des crises ou d’empirer l’état de la personne. Cela peut aussi empêcher une personne de chercher de l’aide, de peur de se voir attribuer une étiquette.
La Cour suprême du Canada, qui a reconnu le désavantage distinct et les stéréotypes négatifs auxquels font face les personnes ayant des handicaps intellectuels, a statué que la discrimination contre ces personnes est illégale. Dans Gibbs c. Battlefords[13], la Cour a annulé un régime d’assurance pour employés handicapés parce que les prestations prévues pour les personnes ayant un handicap intellectuel étaient inférieures à celles destinées aux employés ayant un handicap. La CODP considère donc que de telles distinctions constituent une discrimination à première vue.
[8] La maladie mentale a été définie comme « les comportements ou les réactions émotionnelles d’une sévérité marquée, auxquels est associé un certain niveau de détresse, de souffrance (le mal, la mort) ou d’incapacité fonctionnelle (par exemple, à l’école, au travail, dans un contexte social ou familial). À l’origine de ce trouble, on retrouve une dysfonction ou une série de dysfonctions biologiques, psychologiques, ou au niveau du comportement. » Voir la brochure La maladie mentale et le travail publiée par l’Association des psychiatres du Canada, en ligne : page d’accueil de l’Association des psychiatres du Canada, <http://cpa.medical.org/MIAW/MIAW.asp>, page 1.
[9] La définition de « handicap » aux termes du Code comprend les handicaps présumés.
[10] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville) »; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville) », 2000 CSC 27 (3 mai 2000), en ligne : Cour suprême du Canada <http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/index.html> [ci-après Mercier].
[11] Granovsky, supra note 4.
[12] La maladie mentale et le travail, ci-dessus note 8.
[13] Gibbs c. Battlefords and Dist. Co-operative Ltd. (1996), 27 C.H.R.R. D/87 (CSC).