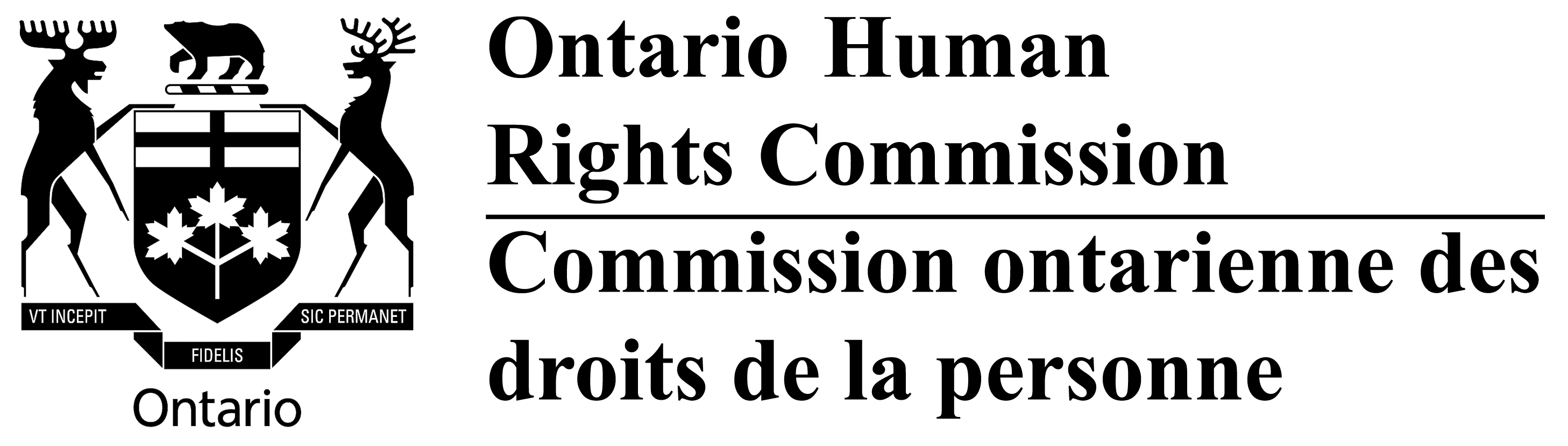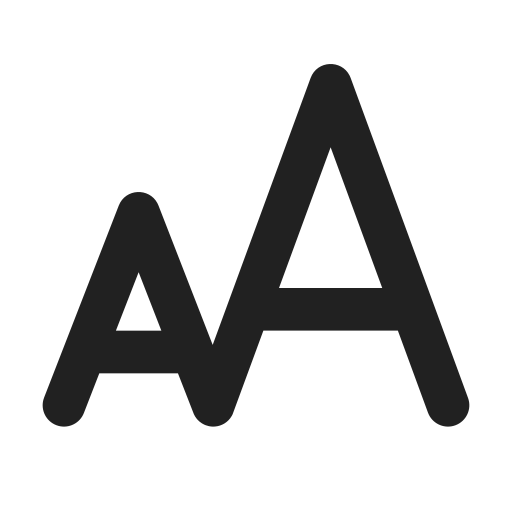La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a développé son Énoncé de politique sur l’embauche spécifique aux Autochtones et son Guide contextuel pour l’Énoncé de politique sur l’embauche spécifique aux Autochtones afin d’apporter des lignes directrices aux employeurs cherchant à doter des postes spécifiques aux Autochtones. Cette foire aux questions (FAQ) répond aux questions fréquemment posées à l’aide de renseignements sommaires tirés de l’énoncé de politique et du guide contextuel qui l’accompagne.
1. Puis-je limiter un processus d’embauche uniquement à des candidat(e)s autochtones ?
2. Qu’est-ce qu’un programme spécial ? Dois-je obtenir permission avant d’en créer un ?
3. Qu’est-ce qu’un emploi particulier ?
1. Puis-je limiter un processus d’embauche uniquement à des candidat(e)s autochtones ?
Le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) permet l’embauche d’employés autochtones pour pourvoir des postes spécifiques aux Autochtones afin de tenter de parvenir à l’égalité réelle si l’embauche se fait dans le contexte d’un programme spécial (article 14 du Code) ou d’emplois particuliers (article 24 du Code).
2. Qu’est-ce qu’un programme spécial ? Dois-je obtenir permission avant d’en créer un ?
L’article 14 du Code permet la mise en œuvre de programmes spéciaux destinés aux personnes qui subissent des préjudices, un désavantage économique, des inégalités ou de la discrimination afin de favoriser l’égalité réelle.
De tels programmes peuvent notamment fournir du soutien aux Autochtones en tenant compte de leur expérience unique de la discrimination et de la marginalisation. Le Code protège également ces programmes contre les plaintes pour atteinte aux droits de la personne déposées par des personnes qui ne subissent pas le même désavantage.
Exemple : Un conseil scolaire a recueilli des données et constaté qu’il compte très peu d’enseignant(e)s des Premières Nations, inuits ou métis. Il met sur pied un programme spécial visant à accroître le bassin d’enseignant(e)s autochtones pour pourvoir les postes vacants. La présence d’un plus grand nombre d’enseignant(e)s autochtones favorisera un environnement d’apprentissage plus inclusif et l’égalité réelle pour les élèves autochtones, de même que les initiatives de réconciliation parmi les élèves et le personnel.
Exemple : Pour une université ontarienne souhaitant favoriser la réconciliation en instaurant un programme d’études autochtones, il pourrait être raisonnable d’embaucher des professeurs autochtones possédant des connaissances et une expérience vécue correspondant aux cours enseignés pour assurer la mise en œuvre efficace du programme spécial.
Les programmes spéciaux doivent être justifiés d’une raison d’être claire et précise et être assortis de critères d’admissibilité adéquats. Les particuliers et organismes qui pourraient considérer ces programmes spéciaux comme discriminatoires pourront ainsi comprendre leur objectif, leur utilisation et la façon dont leur efficacité sera évaluée.
Les organismes n’ont pas à demander à la CODP l’autorisation d’élaborer un programme spécial, ni à prouver que les peuples autochtones font face à des désavantages, car il est largement reconnu qu’ils font face à une discrimination systémique dans tous les domaines sociaux protégés par le Code.
3. Qu’est-ce qu’un emploi particulier ?
L’article 24 du Code prévoit des dispositions sur les emplois particuliers qui délimitent plus précisément la portée de l’interdiction générale de la discrimination dans le domaine de l’emploi. En vertu du paragraphe 24 (1) du Code, un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social peut employer spécifiquement un(e) Autochtone si son principal objectif est de servir les intérêts des Autochtones et s’il est « raisonnable et de bonne foi » d’exiger que l’emploi soit réservé à un(e) Autochtone.
Exemple : Il peut être considéré comme raisonnable et de bonne foi pour un organisme autochtone de bien-être de l’enfance en milieu urbain d’embaucher des travailleurs sociaux autochtones afin de servir les enfants et familles auprès desquels ils travaillent de façon appropriée sur le plan culturel.
Pour comprendre pourquoi l’identité autochtone pourrait constituer une exigence « raisonnable et de bonne foi » dans le contexte du paragraphe 24 (1), il faut souligner la diversité des visions du monde des peuples et personnes autochtones, mais également le fait que leur rapport avec le monde et leur expérience du colonialisme présentent des traits communs et des chevauchements, comme en témoignent certains éléments communs dans les manières de savoir, de faire et d’être de peuples autochtones distincts (p. ex., relationnalité, holisme)[i]. Ces perspectives s’opposent souvent aux visions du monde occidentales qui prédominent. C’est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que les questions autochtones soient interprétées selon des perspectives autochtones[ii] et c’est également pourquoi l’identité autochtone peut constituer une condition d’emploi valable.
Exemple : Un organisme qui fournit des services de santé aux Autochtones recrute une infirmière. Compte tenu de la façon dont les peuples autochtones appréhendent la médecine, il serait « raisonnable et de bonne foi » d’exiger que le(la) candidat(e) choisi(e) soit autochtone et ait une connaissance manifeste des pratiques de santé autochtones.
La CODP met tout de même en garde contre l’essentialisme et la diversité de façade. Il ne faut pas réduire les Autochtones à des stéréotypes coloniaux mais les respecter et leur donner les moyens de mettre leurs connaissances culturelles à contribution dans leur rôle professionnel, sans idées préconçues.
4. Puis-je limiter un processus d’embauche à des candidat(e)s issu(e)s uniquement de communautés autochtones spécifiques (p. ex., des Premières Nations au nord-ouest de l’Ontario) ?
Dans certains cas, oui.
Cependant, il est important d’assortir de telles restrictions d’une justification claire. Que ce soit dans le contexte d’un programme spécial ou d’emplois particuliers, les critères d’admissibilité devraient s’appuyer sur la raison d’être du programme en fonction de données probantes.
Exemple : Une bibliothèque publique souhaite organiser une série d’événements d’information et embaucher spécifiquement des éducateurs(-trices) autochtones pour traiter de l’histoire des Autochtones. L’admissibilité reposera sur l’objet des événements et leur contenu. Ainsi :
s’il s’agit de discuter de l’histoire d’un territoire précis visé par un traité, il serait raisonnable de limiter les candidatures aux Autochtones qui appartiennent à une nation autochtone signataire de ce traité (p. ex., la priorité pourrait être accordée à des Autochtones qui sont visées par les traités Williams pour discuter du règlement des revendications territoriales connexes);
- s’il s’agit de discuter de l’histoire de la colonisation au Canada en général, il serait raisonnable d’accepter des candidat(e)s faisant partie de n’importe quel peuple autochtone du Canada.
Les critères devraient être reliés à la raison d’être du programme ou aux exigences raisonnables et de bonne foi d’un emplois particulier.
5. Pourquoi limiter un processus d’embauche à un groupe spécifique n’est-il pas considéré comme de la discrimination ?
En vertu de l’article 5 du Code, toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur une ou plusieurs caractéristiques personnelles protégées, dit motifs illicites de discrimination.
Le Code (tout comme d’autre lois canadiennes telles que la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi canadienne sur les droits de la personne) reconnaît aussi l’importance de réduire les désavantages historiques en protégeant les programmes spéciaux ainsi que les emplois particuliers visant à venir en aide à des groupes marginalisés et à tenter de parvenir à l’égalité réelle.
L’égalité réelle consiste à comprendre les personnes ou groupes qui font face à des désavantages et à répondre à leurs besoins. Elle tient compte des obstacles discriminatoires, qui ne sont pas toujours évidents ou délibérés. Souvent, les personnes faisant partie de groupes qui subissent des désavantages historiques et actuels n’ont pas accès aux mêmes opportunités que les autres; les programmes spéciaux et les emplois particuliers contribuent à égaliser les chances.
6. Mon organisme n’est pas un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts des Autochtones et n’a pas de programmes spéciaux en place actuellement. Puis-je tout de même limiter un processus d’embauche uniquement à des candidat(e)s autochtones ?
Limiter un processus d’embauche uniquement à des candidat(e)s autochtones (ou à tout autre groupe identifié par un motif du Code) sera probablement considéré comme étant contraire au Code sauf si le processus est entrepris dans le contexte de programmes spéciaux ou d’un emploi particulier.
Si votre organisme ne satisfait pas les critères requis à l’article 24 du Code en vue d’offrir des emplois particuliers, il peut tout de même mettre en place un programme spécial visant à réduire les désavantages systémiques que subissent les Autochtones dans le domaine de l’emploi. Veuillez vous référer à la question 2 de cette FAQ pour de plus amples détails.
7. Puis-je demander des preuves d’identité autochtone de la part d’un(e) candidat(e) ? Comment puis-je faire cette demande de manière respectueuse et appropriée ?
Le Code permet aux employeurs de confirmer les revendications d’identité autochtone au cours du processus d’embauche, et la CODP estime qu’ils devraient le faire au moment de pourvoir un poste spécifique aux Autochtones qui a été créé dans le cadre d’un programme spécial ou qui représente un emploi particulier.
Exemple : Si un(e) candidat(e) à un poste d’agent(e) de liaison autochtone chargé(e) de faciliter l’engagement public avec des groupes autochtones s’identifie comme étant métis(se) et prétend détenir des connaissances culturelles et avoir été consulté par des gouvernements et promoteurs sur des questions d’aménagement du territoire, l’employeur devrait confirmer son identité métisse et ses connaissances culturelles au cours du processus d’embauche.
Les processus de confirmation doivent être adaptés et proportionnels aux exigences du poste en question.
Exemple : Un organisme lance un processus de recrutement en vertu du paragraphe 24 (1) du Code pour pourvoir deux postes spécifiques aux Autochtones : un poste de chef des affaires autochtones et un poste d’interprète ou traducteur d’anishinaabemowin. Les exigences respectives de ces deux postes sont associées à différents éléments qui pourraient avoir trait à l’identité autochtone (p. ex., connaissance de protocoles autochtones et maîtrise de l’anishinaabemowin), de sorte que des processus de confirmation différents pourraient se révéler nécessaires.
Les employeurs doivent s’assurer que leur processus de confirmation s’appuie sur des principes de conception inclusive et ne cause pas de discrimination directe ou indirecte envers les Autochtones (c.-à-d. les membres des groupes protégés auxquels est destiné un programme spécial ou un emploi particulier) en se fiant à des définitions sous-inclusives de qui peut s’affirmer Autochtone et en imposant des exigences trop rigides en matière de preuves pour corroborer une revendication.
Il faut veiller à ce que tout processus de confirmation ne perpétue pas la marginalisation des Autochtones dont l’identité peut avoir été affecté de manière disproportionnée par les politiques coloniales, comme les femmes autochtones, car il pourrait être plus difficile pour ces personnes de fournir des renseignements précis pour confirmer leur revendication d’identité. En effet, un programme spécial pourrait être considéré discriminatoire et remis en question par les personnes auxquelles il est censé venir en aide (voir Ball v. Ontario (Community and Social Services), 2010 HRTO 360 (CanLII) [en anglais uniquement]).
Les employeurs qui souhaitent embaucher des Autochtones pour pourvoir des postes spécifiques aux Autochtones et confirmer leurs revendications d’identité doivent donc nouer, maintenir, honorer et respecter des relations avec les détenteurs de droits et les peuples et organismes autochtones locaux qui servent la communauté, et les consulter de manière efficace en vue d’élaborer des politiques et des pratiques concernant les processus de confirmation à adopter.
8. Pourquoi devrais-je confirmer la revendication d’un(e) candidat(e) à une identité autochtone ? Ne devrais-je pas plutôt respecter l’auto-identification ?
Au cours des deux derniers cycles de recensement, la population de personnes s’identifiant comme membres des Premières Nations, Métis ou Inuit au Canada a connu une forte hausse au cours des dix dernières années (+18,9 % de 2011 à 2016 et +9,4 % de 2016 à 2021).
Ce phénomène témoigne du fait que les Autochtones se sentent plus à l’aise pour s’identifier ouvertement comme étant autochtones, ce qui leur donne accès à un soutien accru et à des droits uniques et distincts.
Cependant, le nombre croissant d’allégations de fausse représentation de l’identité autochtone révèle que des personnes non autochtones malhonnêtes ou mal informées sont mieux en mesure d’exploiter le système qui existait afin de reconnaître l’auto-identification comme un élément du droit à l’autodétermination des peuples autochtones.
L’usurpation de l’identité autochtone, que ce soit délibérément, par l’exagération de liens génétiques lointains avec un ancêtre autochtone ou par l’interprétation inexacte de récits familiaux, constitue une pratique dommageable qui peut donner lieu à un abus de confiance.
Le regretté honorable Murray Sinclair a déclaré en 2021 :
[Traduction]
De toute évidence, il ne suffit plus de se déclarer autochtone. Une telle déclaration revêt de l’importance, mais elle n’est qu’un début. Nous devons aller au-delà d’un système fondé sur l’honneur, et écouter les voix des communautés autochtones de l’ensemble de l’île de la Tortue.
9. De quelles complexités devrais-je tenir compte avant d’entreprendre de confirmer la revendication d’un(e) candidat(e) à une identité autochtone ?
Au Canada, le terme « autochtone » s’entend des nations et cultures distinctes et uniques des Premières Nations, des Métis et des Inuit, qui sont les premiers habitants des terres que l’on connaît sous le nom de Canada. Cela dit, le Code ne définit ni ne décrit l’« autochtonité » ou les identités autochtones dans toute leur complexité (c.-à-d. qui est autochtone, qui peut s’identifier comme autochtone, ou ce que l’on pourrait considérer comme des marqueurs authentiques d’identité autochtone).
Le droit des peuples autochtones de déterminer eux-mêmes leur identité suppose qu’il devrait être simple de définir l’identité autochtone, car chaque peuple autochtone la définirait à sa guise. Cependant, l’histoire et la réalité persistante du colonialisme de peuplement ont sapé la liberté et l’autonomie des peuples autochtones d’établir leur propre identité.
Il est important d’établir des relations avec les peuples et organismes autochtones locaux avant d’entreprendre tout processus d’embauche spécifique aux Autochtones et de confirmer les revendications d’identité autochtone. Le terme « local » peut être interprété de diverses manières, mais la CODP invite les employeurs à commencer par déterminer à qui reviennent les terres où ils exercent leurs activités. Si l’entreprise se trouve en milieu urbain, il serait souhaitable de communiquer avec des organismes qui sont au service des Autochtones de ce milieu, comme les centres d’amitié, les organismes de femmes autochtones et les centres de santé ou de soutien autochtones.
La confirmation d’une revendication d’appartenance à un peuple autochtone de la part d’un(e) candidat(e) pourrait nécessiter des mesures différentes selon que ce peuple est situé au Canada ou à l’étranger.
10. Que faire si un(e) candidat(e) ne peut ou ne veut pas corroborer sa revendication d’être autochtone ?
Dans le cas d’un(e) candidat(e) faisant face à des obstacles afin de corroborer ses revendications à une identité autochtone, la CODP encourage les employeurs à collaborer avec le (la) candidat(e) ainsi qu’avec des partenaires autochtones afin d’identifier jointement comment ces obstacles peuvent être surmonter.
Dans le cas d’un(e) candidat(e) refusant de participer à un processus visant à confirmer qu’il (elle) répond aux exigences d’un programme spécial ou d’un emploi particulier, il (elle) pourrait dans les faits exprimer un refus de prendre part au processus d’embauche. La raison d’être, les objectifs et les étapes d’un processus de confirmation devraient être communiquer clairement aux candidat(e)s afin de préconiser le dialogue et un appui général du processus.
11. Puis-je demander des preuves d’identité autochtone aux employé(e)s actuel(le)s de mon organisme détenant des postes spécifiques aux Autochtones ?
Les revendications d’identité autochtone devraient être confirmées au stade du recrutement de la relation d’emploi. En effet, tenter de confirmer ces revendications à un stade ultérieur pourrait soulever des questions relatives au droit du travail.
Les employeurs doivent respecter leurs obligations en matière de droits de la personne en vertu du Code, et se conformer à l’ensemble des lois et règlements en matière d’emploi au moment d’établir leurs processus de confirmation de l’identité autochtone.
[i] Indigenous Corporate Training Inc., Indigenous Worldviews vs Western Worldviews, page Web. Consulté le 9 septembre 2024; en ligne : https://www.ictinc.ca/blog/indigenous-worldviews-vs-western-worldviews (en anglais uniquement)
[ii] Adam Gaudry et Danielle Lorenz, « Indigenization as inclusion, reconciliation, and decolonization: navigating the different visions for indigenizing the Canadian Academy » (2018), AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, vol. 14, no 3, p. 224; en ligne : https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1177180118785382 (en anglais uniquement)