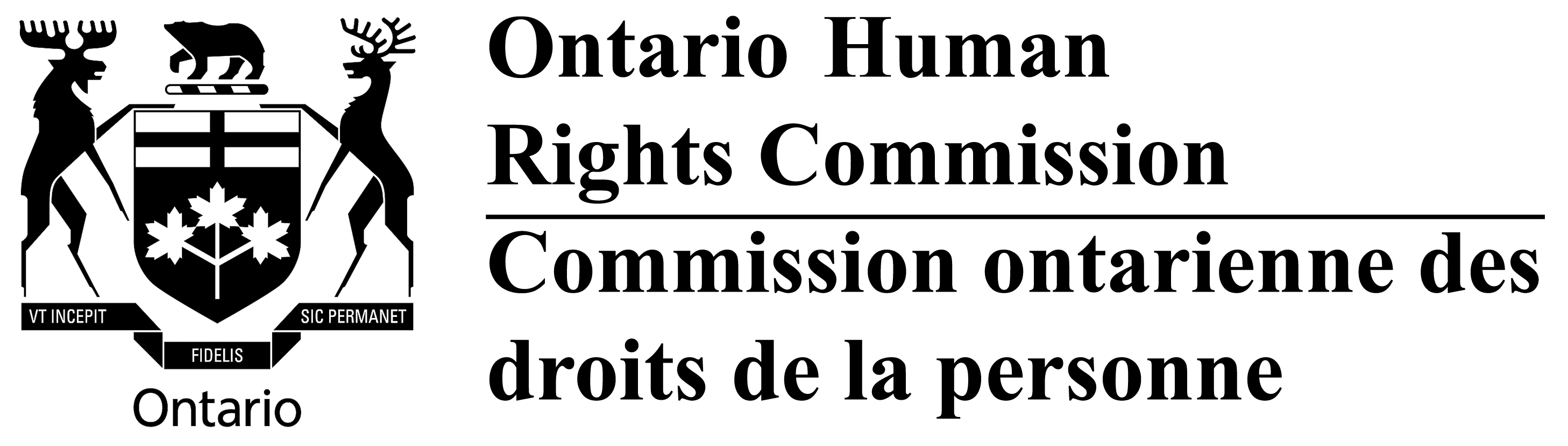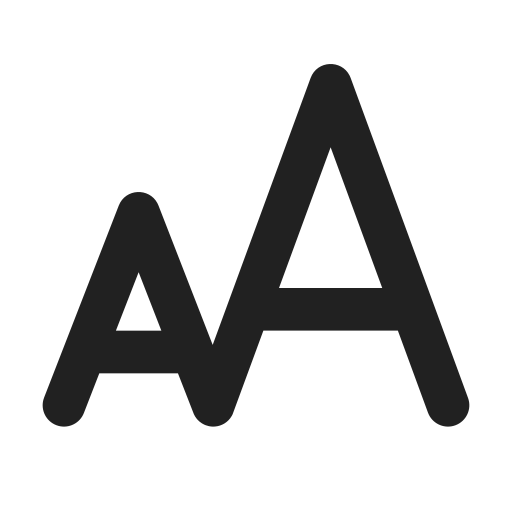En juillet 1977, La CODP a publié un rapport exhaustif intitulé Life Together qui présentait les conclusions d’une consultation menée à l’échelle de la province sur le Code des droits de la personne et les mesures pouvant être prises pour l’améliorer. Le rapport recommandait l’apport de changements majeurs, dont beaucoup ont obtenu force de loi. Parmi les recommandations figuraient :
- accorder la « primauté » au Code, ce qui donne préséance au Code sur toute autre loi, à moins que la loi n’indique le contraire
- étendre aux contrats la protection en matière de discrimination
- intégrer les droits de la personne au système d’éducation et aux activités de maintien de l’ordre
- ajouter la protection contre la discrimination par association
- ajouter l’état matrimonial et l’âge aux motifs interdits de discrimination en matière de logement
- ajouter le handicap physique, l’orientation sexuelle et la présence d’un casier judiciaire aux motifs de discrimination interdits par le Code
- étendre aux « catégories de personnes » le droit de déposer une plainte relative aux droits de la personne, jusqu’à présent réservé aux « personnes »
- ajouter la capacité de composer avec la discrimination systémique ou « constructive »
- faire passer la disposition sur l’âge de 40 ans et plus à 18 ans et plus.
Extraits :
Aucun rapport annuel?
[F]ait surprenant, outre quelques paragraphes d’usage inclus aux rapports au ministère du Travail, aucune demande n’a été faite ou disposition n’a été prise jusqu’à présent durant les 15 premières années d’existence de la Commission ontariennes des droits de la personne pour que l’organisme ne rédige de rapport annuel. Les commissaires recommandent que la Commission prépare un rapport annuel chaque année, le dépose devant l’Assemblée législative et le rende public.
Hausse des problèmes de relations communautaires
Un nombre croissant de problèmes de relations communautaires est porté à l’attention de la Commission. Ces problèmes concernent notamment des cas d’agitation et même de violence raciale dans des écoles secondaires, des allégations de brutalité policière à l’endroit d’Autochtones et de membres d’autres minorités visibles, la diffusion de matériel haineux, des enregistrements téléphoniques encourageant les préjugés raciaux et des cas de vandalisme à caractère racial lors de festivals confessionnels et dans des lieux de culte.
Les pratiques en vigueur sont-elle réellement neutres?
[En] 1962, on croyait généralement que la discrimination prenait la forme de gestes conscients et manifestes dirigés vers des personnes. Par conséquent, le Code interdisait expressément de tels gestes, ce qui a depuis réduit dans une certaine mesure la discrimination manifeste et délibérée. Mais les 15 dernières années d’administration du Code par la Commission ont démontré que la discrimination la plus omniprésente aujourd’hui découle souvent de pratiques inconscientes, d’apparence neutre, qui pourraient néanmoins s’avérer aussi nuisibles aux droits de la personne que la discrimination de type plus manifeste et intentionnelle.
Priorité aux systèmes sociaux
Il peut s’installer un cercle vicieux de discrimination perpétuelle qui n’a rien à voir avec les mérites d’une personne en particulier, et tout à voir avec des circonstances historiques, économiques et sociales discriminatoires. Par exemple, comme cela arrive souvent, une personne autochtone perd un concours pour l’obtention d’un emploi en raison d’un manque de qualifications sur le plan de l’éducation. La personne a probablement été victime de discrimination. Cependant, la source de la discrimination ne se situe pas au niveau des exigences de l’emploi en matière d’éducation, mais au niveau du système social qui a limité l’accès de la personne aux possibilités d’études.
Aborder les causes profondes de la discrimination
Étant donné le caractère omniprésent et complexe de la discrimination historique et institutionnelle, la Commission ne peut pas combattre efficacement cette discrimination en travaillant uniquement à la résolution de plaintes individuelles. Son mandat doit être élargi et ses procédures doivent être suffisamment assouplies de façon à lui permettre de composer avec les questions de droits de la personne qui sont à l’origine de la discrimination, plutôt que de seulement régler les situations de discrimination qui découlent de telles questions de droit.
Le savoir est la clé!
Avant que la politique de l’Ontario en matière de droits de la personne ne puisse être comprise et respectée, la population devra se familiariser davantage avec ses composantes et les raisons de son adoption.
Le système d’éducation doit faire figure de proue
[Le] système d’éducation a comme responsabilité particulière d’assurer la promotion des droits de la personne en informant la population, en favorisant sa compréhension des droits de la personne et en servant de modèle pour contrer l’ignorance et la désinformation à l’origine de la discrimination.
Quand Léo s’affaire sous les yeux attentifs de Léa
Une analyse du matériel d’orientation [scolaire] montre qu’on encourage généralement les filles à devenir hygiénistes dentaires ou infirmières, et les garçons à devenir dentistes ou médecins. Même dans le cas d’un dépliant récent dont la couverture montre une femme portant un blouson blanc, le texte à l’intérieur fait uniquement référence au médecin au masculin. On retrouve de tels stéréotypes homme-femme dans les livres de lecture du primaire, qui semblent représenter « Léo s’affairant sous les yeux attentifs de Léa ».
Discrimination par organisation interposée
La Commission fait face à un nombre croissant d’incidents de discrimination commise au nom de clients par des intermédiaires comme des agences de placement et cabinets de gestion. Cette pratique équivaut, dans la pratique, à du « blanchiment » de discrimination dans le sens que les employeurs ont eux-mêmes aucun contact direct avec les victimes et, par conséquent, ne semblent pas agir en contravention avec le Code même s’ils sont clairement responsables de discrimination du fait qu’ils acceptent le placement. D’ailleurs, de tels gestes de discrimination sont souvent si bien cachés que la victime elle-même peut ne pas savoir qu’elle fait l’objet de discrimination.
Transport collectif peu accessible – en 1977
[Un] grand nombre de personnes ayant un handicap physique aimeraient pouvoir utiliser les transports collectifs ordinaires, soit les autobus, les trains et les métros, comme tout le monde. Elles devraient pouvoir le faire.