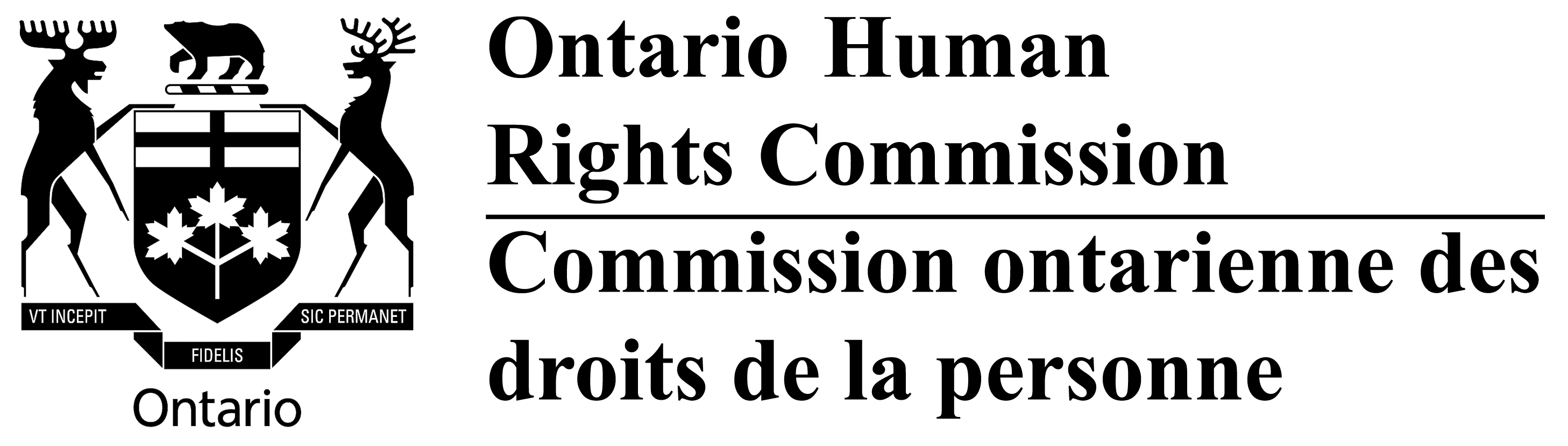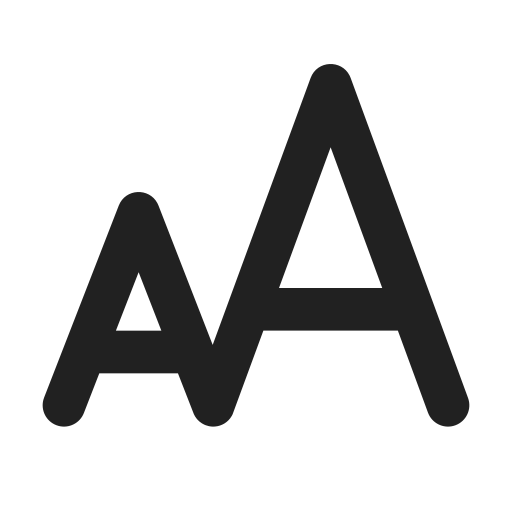Résumé
Le présent mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a pour but de renseigner la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme au sujet des travaux que la CODP a accomplis au cours des plus de 20 dernières années sur l’intersectionnalité selon une perspective de justice raciale, aux fins du rapport de la Rapporteuse spéciale à la 53e session du Conseil des droits de l’homme et pour favoriser la promotion des droits de la personne en Ontario.
À propos de la CODP
Établie en 1961, la CODP est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario et un organisme indépendant du gouvernement provincial. Chargée d’appliquer le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code), elle a pour mandat de promouvoir et de faire respecter le Code par des activités de recherche, d’élaboration de politiques et de sensibilisation du public, par des enquêtes publiques et par des interventions juridiques devant les tribunaux administratifs et judiciaires. La CODP est l’un des trois piliers du système de droits de la personne de l’Ontario. Les deux autres sont le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) et le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP).
Le Code a pour objet de créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à y contribuer pleinement. Il confère à toute personne le droit à un traitement égal en matière d’emploi, de logement, de biens, de services et d’installations, de contrats et d’adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle, sans discrimination fondée sur 17 caractéristiques protégées par le Code connues sous le nom de motifs[1].
Le présent mémoire
La CODP formule régulièrement au gouvernement et aux organes des droits de la personne des Nations Unies des observations sur des questions qui relèvent de son mandat. La CODP a présenté son précédent mémoire en 2023 au sujet du quatrième examen périodique universel du Canada.
La CODP reconnaît régulièrement l’incidence de la discrimination intersectionnelle dans ses publications; mentionnons comme exemples récents son Évaluation de l’impact de l’intelligence artificielle sur les droits de la personne et son Approche fondée sur les droits de la personne pour l’élaboration de programmes et de politiques – Le cadre AFDP. Dans le présent mémoire, la CODP décrit ses principales activités visant à protéger et à promouvoir les droits des personnes racisées et à lutter contre le racisme systémique, en soulignant particulièrement les torts disproportionnés de la discrimination raciale intersectionnelle. La CODP considère ses travaux dans ce domaine comme une priorité stratégique depuis de longues années, et ils continuent d’éclairer les objectifs et les résultats escomptés de son Plan stratégique 2023-2025 dans cinq secteurs prioritaires (réconciliation avec les Autochtones, santé et bien-être, éducation, justice pénale et culture des droits de la personne).
Dans le présent mémoire, la CODP reconnaît les efforts soutenus des Nations Unies en vue de promouvoir les droits de la personne dans le monde, y compris les droits des personnes racisées. Des traités et cadres internationaux sur les droits de la personne (comme la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones) ont établi des normes précieuses pour faire face aux formes intersectionnelles de discrimination et lutter contre le racisme.
La CODP reconnaît également l’impact limité de ces efforts sur les communautés racisées. Cette réalité découle de toute évidence des pouvoirs d’application limités qui sont conférés aux organes créés par traités et prévus par les procédures spéciales. Cependant, la CODP considère que cet impact limité pourrait également découler d’incohérences dans le discours des experts indépendants (y compris dans les rapports de visites de pays) et d’un portrait superficiel du contexte socioéconomique de différentes régions.
La CODP met en garde contre les mesures de promotion des droits de la personne prises pour la forme, et invite la Rapporteuse spéciale à préconiser des mesures de fond concrètes dans le contexte de son mandat pour faire face efficacement au racisme et à la discrimination intersectionnelle. Ces mesures pourraient comprendre notamment les suivantes :
- accroître la fréquence des visites de pays;
- mener des activités de suivi annuelles;
- préparer des communications ciblées ainsi que des rapports thématiques et des rapports sur les visites de pays.
La CODP recommande également le recours plus systématique à des indicateurs pour mesurer les progrès (ou leur absence) des mesures des Nations Unies visant à faire face à la discrimination raciale, ainsi que la promotion de pratiques fructueuses mises en œuvre par des États membres qui ont donné des résultats manifestement positifs pour les communautés racisées.
L’intersectionnalité et la discrimination raciale en Ontario
La CODP a exploré en profondeur le concept d’intersectionnalité dans son document de travail Approche intersectionnelle de la discrimination : Pour traiter les plaintes relatives aux droits de la personne fondées sur des motifs multiples, et elle a analysé son incidence sur la discrimination raciale dans son document Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale. La CODP reconnaît également que l’intersectionnalité peut jouer un rôle clé dans la haine.
En bref, une personne qui fait l’objet de discrimination pour des motifs multiples, comme l’orientation sexuelle et la race, fait face à des obstacles ou à une discrimination uniques et cumulatifs.
L’application d’une approche intersectionnelle à des motifs multiples de discrimination reconnaît la complexité de l’expérience de la discrimination telle qu’elle est vécue, qu’elle repose sur les caractéristiques uniques de la personne ou sur le contexte social et historique de différents groupes. En outre, l’intersectionnalité se révèle utile pour tenir compte des enjeux sociaux, économiques, politiques et juridiques qui contribuent à la discrimination mais qui ne sont pas abordés directement dans les lois anti-discrimination comme le Code. Mentionnons notamment la pauvreté, l’itinérance, les répercussions de la pandémie de COVID-19 et le recours à la technologie de l’intelligence artificielle.
Il importe de souligner que, malgré leur usage universel, les termes « race » et « discrimination raciale » sont souvent mal compris. Dans le contexte du Code et dans le document Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale, il s’agit de « processus sociaux qui cherchent à établir des différences entre les groupes, avec le résultat d’en marginaliser certains par rapport à la société ». Le Code interdit la discrimination fondée sur la race et d’autres motifs liés à la race.
Schémas de discrimination intersectionnelle
Une analyse intersectionnelle se révèle pertinente en ce qui concerne la discrimination fondée sur n’importe quelle combinaison de motifs protégés par le Code, mais surtout sur des motifs liés à la race.
En Ontario, des données du TDPO[2] montrent qu’entre 2008 et 2024, la plupart (53 %) des plaintes pour discrimination en contravention du Code faisaient état de plus d’un motif de discrimination. L’analyse de ces données pour relever les plaintes faisant intervenir des motifs liés à la race (c.-à-d. la race, l’ascendance, la couleur, la citoyenneté, le lieu d’origine et l’origine ethnique)[3] fait ressortir encore plus clairement l’importance de l’intersectionnalité : seules 1 017 plaintes portaient sur des cas de discrimination fondés sur un seul motif lié à la race, alors que 15 317 plaintes alléguaient une discrimination fondée sur l’un des six motifs liés à la race en plus d’un ou plusieurs autres motifs. Plus de 48 % (48,6 %) des plaintes faisant intervenir une discrimination intersectionnelle portaient sur la discrimination raciale.
Les intersections les plus courantes sont entre des motifs liés à la race, ainsi qu’entre ces motifs et la croyance ou un handicap. L’intersection des motifs liés à la race d’une part et, d’autre part, le sexe, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle est également importante. La CODP invite la Rapporteuse spéciale à examiner attentivement ces interactions dans son rapport.
Intersection de motifs multiples liés à la race
Les motifs liés à la race peuvent être en intersection, car ils représentent des facteurs distincts à l’intérieur du construit social de la race et sont perçus de manière unique selon les identités. Par exemple, même si elles sont toutes les deux des personnes racisées, une personne noire pourrait vivre la discrimination différemment d’une personne asiatique en raison de l’intersection de la race et de la couleur. De même, si elles sont toutes deux autochtones, une personne anichinabée peut être aux prises avec des schémas de discrimination différents d’une personne inuite en raison de l’intersection de l’ascendance, de l’origine ethnique et du lieu d’origine.
La CODP souligne que cette expression nuancée de l’intersectionnalité pourrait passer inaperçue quand on la compare à des interactions éventuellement plus flagrantes entre des motifs protégés par le Code (voir plus loin). La CODP a étudié ces interactions dans plusieurs domaines, mais elle se concentre ici sur le profilage racial dans la justice pénale et l’éducation.
Le profilage racial dans le système de justice pénale
Le profilage racial est un type insidieux et particulièrement dommageable de discrimination raciale qui s’appuie sur des notions de sécurité. Le rapport Pris à partie : Préoccupations à l’égard du profilage racial effectué par les services de police de la CODP décrit cette question en détail et a éclairé sa Politique sur l’élimination du profilage racial en contexte de maintien de l’ordre.
Faisant fond sur cette politique, la CODP a lancé une enquête sur le racisme envers les Noirs par le service de police de Toronto (SPT) et a constaté qu’il y avait de la discrimination raciale, du profilage racial et du racisme envers les Noirs à l’état systémique dans le cadre des interactions avec le SPT. Les conclusions de cette enquête ont éclairé le Cadre pour un changement destiné à lutter contre le racisme systémique dans les services policiers de la CODP et son rapport De l’impact à l’action : Rapport final sur le racisme envers les personnes noires par le service de police de Toronto, qui a donné lieu à un dialogue continu entre la CODP et le SPT pour favoriser des progrès.
Le profilage racial dans le système d’éducation
Dans le secteur de l’éducation, l’impact de la discrimination raciale peut se faire sentir tant chez les apprenantes et apprenants que chez les éducatrices et éducateurs. L’enquête « Le droit de lire », le rapport « Ce que nous avons entendu » issu des tables rondes sur la lutte contre le racisme envers les Noirs en éducation et la Politique sur l’éducation accessible aux élèves handicapés de la CODP ont permis de constater que les apprenantes et apprenants racisés sont plus susceptibles d’être cloisonnés dans des cours théoriques de niveau inférieur en raison de suppositions fondées sur des stéréotypes, font l’objet de mesures disciplinaires disproportionnées et voient leurs besoins évalués de façon inadéquate. Les éducatrices et éducateurs racisés, quant à eux, sont plus susceptibles de faire l’objet d’une surveillance excessive de leur travail, de ne pas être retenus pour des occasions de perfectionnement professionnel, de subir un épuisement professionnel et d’être visés par une diversité de façade.
Enfin, comme les différentes parties du secteur public sont interreliées, le profilage racial et la discrimination intersectionnelle peuvent aggraver les vulnérabilités en raison de la multiplicité des interactions avec des établissements entachés de racisme systémique. La CODP a souligné cette réalité dans le cadre de son enquête publique Enfances interrompues, qui a examiné la surreprésentation des enfants autochtones et noirs dans le système de bien-être de l’enfance de l’Ontario. Cette enquête a permis de constater que les désavantages systémiques dans les différents domaines sociaux contribuent à de mauvais résultats socioéconomiques qui, à leur tour, augmentent les contacts entre les familles et les enfants racisés et le système de bien-être de l’enfance. Les enfants racisés sont plus susceptibles de subir les effets négatifs associés à leur prise en charge par ce système, perpétuant ainsi le cycle de la discrimination systémique.
Intersection des motifs liés à la race et de la croyance
L’intersection des caractéristiques raciales réelles ou perçues d’une personne et de sa croyance (c.-à-d. le système de convictions profondes de cette personne) est étudiée dans la Politique de prévention de la discrimination fondée sur la croyance de la CODP. Cette politique décrit comment faire face à la discrimination fondée sur la croyance et la prévenir, et reconnaît le lien inextricable entre les systèmes de convictions, la race et l’origine ethnique dans la société contemporaine. Parmi les formes de discrimination racisée fondées sur la croyance, mentionnons l’islamophobie, l’antisémitisme, la discrimination fondée sur la caste et la minimisation des traditions spirituelles autochtones en tant que manifestation de la discrimination envers les Autochtones.
Intersection des motifs liés à la race et d’un handicap
Les personnes racisées ayant un handicap sont très vulnérables aux effets cumulatifs de la discrimination intersectionnelle, car elles font face non seulement à l’oppression sociale du racisme systémique, mais également aux stéréotypes et aux obstacles à l’accessibilité résultant du capacitisme.
La Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap de la CODP souligne que les fournisseurs de services (fonctionnaires, professionnels de la santé, police, éducatrices et éducateurs), les employeurs et les fournisseurs de logements doivent tenir compte des besoins uniques des personnes qui subissent de la discrimination en raison d’un handicap et de leur race, dans le cadre de leur obligation légale de maintenir un environnement exempt de discrimination et de harcèlement.
La CODP a constaté la nécessité d’accorder plus d’attention aux formes de discrimination et de harcèlement que subissent les élèves racisés ayant un handicap, particulièrement les élèves autochtones et noirs. Elle a étudié cette question dans sa Politique sur l’éducation accessible aux élèves handicapés et dans le rapport de son enquête « Le droit de lire » (une enquête publique sur les questions relatives aux droits de la personne qui touchent les élèves ayant des troubles de lecture, en mettant l’accent sur la petite enfance). La CODP a affirmé clairement que les fournisseurs de services d’éducation doivent veiller à ce que les préjugés inconscients et les stéréotypes négatifs n’influent pas sur la façon dont ils fournissent des services et du soutien aux élèves racisés ayant un handicap.
De plus, dans le Rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne sur l’usage de force par les services de police et la santé mentale et dans Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, Ies troubles mentaux et les dépendances de la CODP, la CODP a reconnu que les personnes ayant des problèmes de santé mentale comptent souvent parmi les personnes les plus vulnérables en Ontario. Par exemple, il est plus difficile pour les jeunes hommes noirs ayant un handicap psychiatrique de trouver un logement en raison de stéréotypes liés à la race, à l’âge, au sexe et au handicap.
Les personnes ayant des problèmes de santé mentale présentent également une vulnérabilité disproportionnée dans leurs interactions avec les forces de l’ordre. Les policiers sont plus susceptibles de faire usage de la force contre elles lorsque leurs réactions aux directives policières semblent inhabituelles, imprévisibles ou inappropriées, ou parce que les agents s’appuient sur des suppositions stéréotypées à propos de leur dangerosité ou de leurs tendances violentes. Conjuguée au profilage racial, cette réalité fait en sorte que les personnes racisées ayant des problèmes de santé mentale courent un risque élevé.
Intersection des motifs liés à la race d’une part et du sexe, de l’identité sexuelle ou de l’expression de l’identité sexuelle d’autre part
Les effets cumulatifs de la discrimination intersectionnelle s’observent également dans le fait que l’expérience de la discrimination que vivent les personnes racisées varie selon le sexe ou le genre. Par exemple, dans ses travaux sur le profilage racial, la CODP a constaté que les hommes noirs couraient un risque particulièrement élevé de se voir soupçonnés d’actes violents et criminels par les forces de l’ordre[4], et que les femmes autochtones et les personnes transgenres peuvent être profilées comme étant des voleurs à l’étalage, des consommateurs ou passeurs de drogues ou des travailleurs du sexe en raison de stéréotypes.
Comme il est indiqué dans la Politique de prévention de la discrimination fondée sur la croyance de la CODP, les femmes racisées qui pratiquent une religion subissent des formes différentes de discrimination et de harcèlement dans la société en raison de préjugés fondés sur la croyance. Cela est attribuable souvent à leur plus grande visibilité ou à leur vulnérabilité perçue. Par exemple, les femmes musulmanes qui portent le voile recouvrant la tête (hijab) ou celui recouvrant le visage (niqab) sont particulièrement exposées à la discrimination et au harcèlement fondés sur la croyance.
Faire face à la discrimination intersectionnelle
Les organisations privées et publiques peuvent prendre des mesures concrètes pour faire face à la discrimination intersectionnelle et demander conseil aux organismes de défense des droits de la personne. Il est possible de réaliser des progrès importants quand tous les membres de la société accordent la priorité aux droits de la personne, en font la promotion, les protègent et les respectent.
En Ontario, en vertu de l’article 14 du Code, tous les détenteurs d’obligations peuvent créer des programmes spéciaux[5] destinés à réduire les désavantages historiques dont font l’objet certains groupes (p. ex., les personnes racisées). La CODP fournit des lignes directrices sur ces programmes spéciaux à l’intention des détenteurs de droits et d’obligations dans son Guide des programmes spéciaux et du Code des droits de la personne.
La CODP est convaincue que, pour faire progresser les droits de la personne, il faut amplifier la voix des personnes qui sont victimes de discrimination. Des dialogues publics (comme le dialogue sur les peuples autochtones et les droits de la personne organisé par la CODP), des groupes consultatifs d’experts, des appels de communications et des consultations auprès de personnes et de groupes touchés par la discrimination intersectionnelle sont autant de moyens essentiels de faire en sorte que les communautés touchées façonnent les politiques et les interventions en matière de droits de la personne.
Enfin, la CODP aimerait souligner le rôle essentiel de la collecte de données. En effet, la collecte cyclique de données désagrégées est essentielle pour lutter contre la discrimination raciale et faire face à l’intersectionnalité. On croit souvent à tort que les lois anti-discrimination, comme le Code, interdisent la collecte et l’analyse de données identificatoires fondées sur la race et d’autres motifs. Cependant, non seulement le Code permet la collecte de telles données fondées sur des motifs protégés par le Code à des fins légitimes, mais la CODP estime que cela est nécessaire pour réaliser les objets du Code. La CODP a toujours recommandé aux détenteurs d’obligations de recueillir et d’analyser des données désagrégées, comme il est décrit dans Comptez-moi! : collecte de données relatives aux droits de la personne.
[1] Les 17 motifs protégés par le Code sont les suivants :
- Âge
- Ascendance, couleur, race
- Citoyenneté
- Origine ethnique
- Lieu d’origine
- Croyance
- Handicap
- État familial
- État matrimonial (y compris le fait d’être célibataire ou d’avoir un partenaire de même sexe)
- Identité sexuelle, expression de l’identité sexuelle
- État d’assisté social (dans le domaine du logement uniquement)
- Existence d’un casier judiciaire (dans le domaine de l’emploi uniquement)
- Sexe (y compris la grossesse et l’allaitement)
- Orientation sexuelle
[2] En vertu de l’article 38 du Code, la TDPO divulgue des données sur les requêtes chaque trimestre.
[3] Soulignons que la croyance est également un motif du Code qui est étroitement associé à la race, mais qu’elle est abordée séparément dans le présent mémoire.
[4] R v. Smith, 2015 ONSC 3548 (CanLII), au par. 183, 338 CRR (2d) 1 [Smith].
[5] Dans un contexte international, les programmes spéciaux sont souvent synonymes de mesures spéciales ou d’action positive.