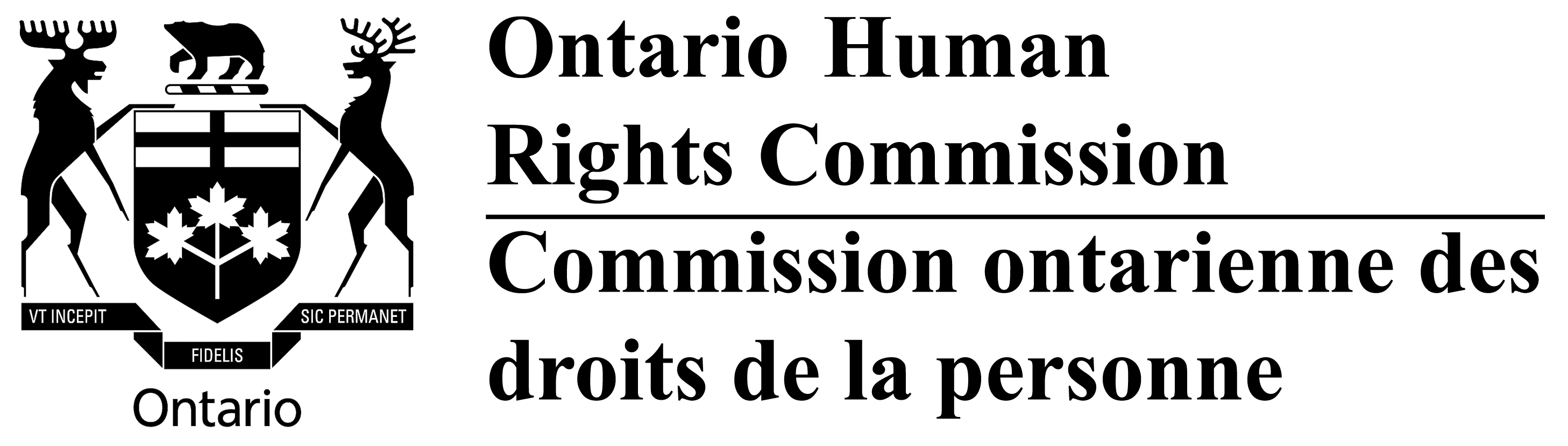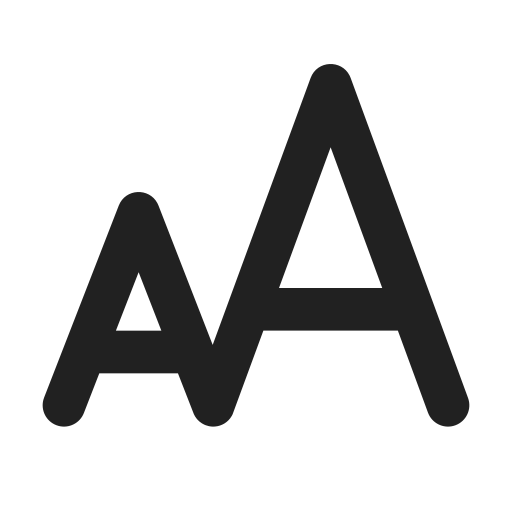1. La nécessité d’un changement
Les personnes qui ont participé à la consultation sont dans l’ensemble d’accord sur la nécessité d’examiner et de renforcer le système ontarien de protection des droits de la personne. Elles ont presque toutes dit que le système actuel ne fonctionne pas assez bien et qu’il faudrait y apporter divers changements, plus ou moins importants. Quelques voix se sont par ailleurs levées pour dire leur frustration que des consultations antérieures n’aient en fait mené à rien.
On ne peut qu’espérer que cette nouvelle consultation sera différente de toutes celles qui l’ont précédée ces 20 dernières années et qu’elle mènera à des changements réels et progressistes.
Clinique d’aide juridique
Bien que la quasi‑totalité des personnes ayant participé à la consultation s’accordent à dire que des changements s’imposent, elles sont loin d’être d’accord sur la nature et l’ampleur des changements à entreprendre. Quelques personnes ont réclamé des changements mineurs au niveau des procédures de la Commission, tandis que d’autres ont laissé entendre qu’il n’y ait rien à reprocher au mandat ni à la structure de la Commission, mais que celle‑ci avait jusqu’ici manqué de s’acquitter convenablement de ses responsabilités.
Certains diront peut-être qu’il faudrait augmenter les pouvoirs de la Commission pour lui faciliter le travail, mais à notre avis, le problème, c’est que la Commission a manqué d’exercer correctement les pouvoirs dont elle dispose déjà pour remplir son mandat.
Clinique d’aide juridique
Quelques personnes parmi les participantes et participants à la consultation ont aussi prôné la réorganisation totale du système ontarien de protection des droits de la personne, y compris une considérable réduction des pouvoirs de la Commission.
Les points de vue de la majorité des participantes et des participants se situent entre ces deux extrêmes et appellent des changements plus ou moins importants à tel ou tel élément du système. Cette diversité d’opinions devient parfaitement évidente aux prochaines pages, qui soulignent les nombreuses sources de préoccupation des personnes et groupes intéressés et la gamme de changements que les uns et les autres jugent indispensables.
Thèmes clefs
Les intervenants ne sont pas satisfaits du système actuel de protection des droits de la personne et souhaitent que des changements réels y soient apportés.
2. L’examen du système sous l’angle des principes applicables
La Commission estime que tout examen et toute réforme du système ontarien de protection des droits de la personne doivent s’appuyer sur les principes à la base de ces droits, tels qu’établis dans les conventions et les normes internationales s’y rapportant, de même que sur les exigences administratives prescrites par la loi.
En conséquence, la consultation de la Commission a pris pour point de départ la résolution des Nations Unies communément appelée les Principes de Paris[2]. Ces principes et les lignes directrices connexes énoncent les rôles et les responsabilités clefs indispensables au bon fonctionnement de tout système de protection des droits de la personne. Le Canada ayant affirmé son adhésion à ces principes devant les Nations Unies, l’Ontario est tenu de respecter cet engagement. Le Document de discussion énonçait les sept critères ci‑après comme devant servir à mesurer l’efficacité d’un système de protection des droits de la personne, selon les Principes de Paris et les lignes directrices s’y rapportant :
- Indépendance
- Compétence délimitée
- Coopération
- Pouvoirs suffisants
- Accessibilité
- Efficacité opérationnelle
- Responsabilité
La consultation s’est par ailleurs appuyée sur une série d’exigences législatives et de principes régissant les organismes administratifs au Canada, notamment l’obligation d’équité, qui complètent et reflètent les Principes de Paris.
Une partie des personnes ayant pris part à la consultation trouvent qu’un examen du système basé sur les principes applicables en matière de droits de la personne n’est pas nécessaire, ni même indiqué. Une personne a été jusqu’à dire qu’il n’y avait pas du tout lieu de tenir compte des normes internationales, soutenant que celles‑ci ne font que refléter les visées politiques des pays membres des Nations Unies.
D’autres ne voient pas l’intérêt de prendre les principes en question et les critères d’efficacité comme points de départ de la consultation, parce qu’à leurs yeux, il s’agit là soit de « truismes » que peu de gens contesteraient, soit de déclarations trop abstraites. Ces personnes sont d’avis que la discussion devrait surtout porter sur les problèmes concrets du système actuel et sur les réformes qui pourraient y remédier.
Il me semble que les principes sont ce qu’ils sont. Ce qu’il faut, c’est trouver un modèle qui fonctionne. Au fond, il n’y a rien à redire aux bases législatives de notre système, c’est leur application sur le terrain qui ne fonctionne pas. À mon sens, c’est le modèle de prestation des services qui pose un problème. La question est de savoir comment mettre sur pied un système qui soit vraiment capable de traiter les plaintes de façon équitable et raisonnable, assez rapidement et suivant des procédures appropriées. Comment pouvons-nous, à l’aide du système existant, nous attaquer aux problèmes systémiques? Et comment pourrions‑nous instaurer une fonction de marketing social et d’éducation du public qui permette réellement d’éviter de futures plaintes?
Organisme gouvernemental
Parmi les observations recueillies, certaines soulignent la nécessité d’une discussion de fond sur les droits de la personne. L’une des personnes ayant participé à la consultation se demande si, en réalité, le problème ne serait pas une question de désaccord sur les données et les principes de base.
… face à la plupart de ces critères d’efficacité, je ne peux que dire oui, en effet, il nous faut ceci, et bien sûr, il nous faut cela, et tel ou tel autre élément également. Ce qui manque à mon avis, c’est une réflexion plus poussée sur les droits de la personne … est-ce que personne d’autre à part moi ne trouve ironique que nous parlions de renforcer la Commission, de renforcer le système ontarien de protection des droits de la personne, en nous basant sur une série de principes qui sont censés être universels, internationaux, et que pendant ce temps, nous n’arrêtons pas de dire, en Colombie‑Britannique, ils font ceci, et au Québec, ils font cela, alors que nous en Ontario, on fait telle autre chose. … Nous trahissons vraiment un esprit de clocher dans notre façon d’aborder la protection des droits de la personne.
Organisme communautaire
Très peu de participantes et de participants ont directement évoqué la validité d’examiner le système de protection des droits de la personne à la lumière de ses principes fondamentaux, plutôt que d’une quelconque autre manière plus pragmatique. La plupart des personnes ayant participé à la consultation ont donné leur avis sur les catégories de principes mis de l’avant par la Commission aux fins de la consultation sans trouver à y redire. En fait, bon nombre de personnes ont émis de graves doutes quant au respect des normes internationales par rapport à des critères d’efficacité tels que l’indépendance, la compétence délimitée, l’accessibilité et l’efficience opérationnelle.
Thèmes clefs
Quelques personnes se sont explicitement dites favorables ou au contraire opposées à un examen du système ontarien de protection des droits de la personne fondé sur des principes, tel que proposé dans le Document de discussion. La plupart des participantes et participants ont reconnu le mérite d’un tel examen et s’inquiètent plutôt du respect des critères retenus pour mesurer l’efficacité d’un système de protection des droits de la personne.
3. Les ressources
Ces dix dernières années, le budget de la Commission est resté essentiellement inchangé : il est passé de 11 306 000 dollars en 1995‑1996 à 12 519 000 dollars en 2004‑2005. Pourtant, les ressources de la Commission sont plus convoitées d’année en année et les décisions relatives à leur utilisation sont de plus en plus difficiles. Pour mettre son coût en perspective, le budget actuel de la Commission équivaut seulement à un dollar par Ontarienne et par Ontarien par année.
Les personnes ayant participé à la consultation étaient presque unanimes à reconnaître l’importance des ressources mises à la disposition du système ontarien de protection des droits de la personne, à déplorer l’insuffisance de ces ressources et à souhaiter qu’une plus grande priorité soit accordée au financement du système.
L’insuffisance du financement de notre système de protection des droits de la personne m’inquiète sérieusement. Je trouve incroyable que le budget de la Commission ait pratiquement stagné ces dix dernières années : sa capacité de faire face au volume croissant de plaintes s’en est manifestement ressentie.
Particulier
Quelques voix se sont levées parmi les participantes et les participants selon lesquelles le gouvernement est principalement responsable de l’insuffisance des ressources consacrées à la protection des droits de la personne. Certaines ont mis en doute l’engagement des gouvernements au Canada en faveur de cette protection.
… il me semble absolument essentiel d’accorder un financement suffisant à la Commission et au Tribunal si l’on veut que le système ontarien de protection des droits de la personne fonctionne correctement. L’insuffisance de ce financement nuit à l’efficacité de la Commission comme du Tribunal et mine les principes à la base de tout système opérationnel … Selon moi, le refus du gouvernement sortant d’augmenter le financement du système ontarien de protection des droits de la personne équivaut à un refus d’accorder une importance prioritaire au respect de ces droits en Ontario. Les gouvernements qui clament leur détermination à protéger le droit à l’égalité de l’ensemble des Ontariennes et des Ontariens sans égard à leurs caractéristiques personnelles immuables doivent être prêts à financer les institutions qui ont pour mission d’assurer cette protection. Il ne suffit pas de parler, il faut agir.
Syndicat
Plusieurs représentantes et représentants du milieu des personnes handicapées ont souligné que l’insuffisance du financement a des retombées particulièrement prononcées sur ces dernières lorsqu’elles présentent une plainte pour atteinte à leurs droits.
Depuis toujours, la Commission et le Tribunal ont eu à composer avec un financement insuffisant qui entraîne d’inutiles retards au niveau du traitement des plaintes pour atteinte aux droits de la personne. Plusieurs personnes malentendantes, sourdes de naissance ou devenues sourdes qui ont porté plainte auprès de la Commission nous ont fait part de ces retards. Ces personnes doivent déjà attendre plus longtemps que la moyenne des plaignantes et des plaignants, vu que l’audition de leurs plaintes nécessite l’assistance d’interprètes gestuels, pour lesquels ces retards sont particulièrement problématiques. Certaines personnes sourdes ou malentendantes ont dit qu’elles craignaient un report, voire l’annulation, de leurs rendez‑vous avec la Commission en raison d’un manque d’interprètes. Or, l’annulation ou le report d’une réunion avec le personnel de la Commission ou d’une audience devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario risque de se traduire par une attente d’au moins trois à six mois de plus avant la date d’une nouvelle réunion ou audience.
Quelques participantes et participants ont proposé différentes façons d’établir le budget des institutions chargées de la protection des droits de la personne. La suggestion a été faite à plusieurs reprises que l’établissement de ce budget devrait être confié à un comité formé d’élus provinciaux représentant tous les partis à l’Assemblée. Certaines personnes ont aussi avancé l’idée de lier le budget dont la Commission dispose pour faire observer le Code soit au nombre de plaintes déposées, de manière à ce qu’il augmente automatiquement selon l’éventuelle multiplication des plaintes, soit à des facteurs tels que la croissance démographique ou la hausse de la proportion de personnes handicapées ou racialisées au sein de la population.
La consultation a aussi engendré des remarques quelque peu cyniques à propos d’un appel à augmenter les fonds consacrés à la protection des droits de la personne en l’absence d’un plan ou d’un modèle bien précis.
La proposition mise de l’avant, c’est ce que la Commission veut. … Elle veut plus d’argent, et je pense que tout le monde serait d’accord pour dire que nous ne pouvons pas espérer renforcer l’efficacité du système sans fonds additionnels… par contre, je ne pense pas que gonfler le budget en l’absence d’un plan cohérent soit une bonne idée. Il faut d’abord arrêter un plan d’action.
Universitaire
Nombreuses sont par ailleurs les personnes qui réclament plus de pragmatisme. De nos jours, tous les organismes gouvernementaux sont soumis à des contraintes financières. D’importantes injections de fonds étant peu probables, il s’agirait plutôt de réfléchir à la meilleure utilisation possible des fonds disponibles, par exemple moyennant une simplification des procédures, une plus grande mise en commun des ressources, y compris des ressources humaines, entre organismes aux mandats similaires et une redéfinition des priorités.
... la Commission n’est pas la seule à se trouver dans cette situation, au contraire : pratiquement tous les organismes de réglementation de l’Ontario se heurtent présentement aux mêmes contraintes budgétaires et difficultés financières. Je doute que les choses changent bien vite à ce niveau : il ne faut pas compter sur une manne tombée du ciel qui permettra de tout restructurer d’un coup, comme d’autres l’ont me semble‑t‑il déjà fait remarquer. Ma perception des choses, du point de vue du secteur privé, est qu’il est plus important que jamais que la Commission et d’autres organismes connexes commencent à étudier des moyens de mettre en commun leurs ressources et leur savoir‑faire, en particulier pour le traitement des plaintes dont les objets se recoupent, ces plaintes multiples qui au fond portent sur les mêmes différends opposant les mêmes parties. Je ne parle pas des activités liées à la mise en application du Code, mais juste d’une plus grande mise en commun des connaissances et autres ressources existantes.
Avocat de la défense
Certaines personnes ont pour leur part défendu le point de vue que l’étendue de la réforme du système ontarien de protection des droits de la personne ne devrait pas être décidée d’avance en raison d’une pénurie de ressources : elles estiment que vu l’importance des droits de la personne, il faudrait tout mettre en œuvre pour aboutir à un système nettement amélioré, sans égards aux coûts.
J’ai l’impression que la discussion se passe en partant du principe que les ressources vont rester inchangées. … À mon avis, le problème fondamental a rapport à la détermination de nos gouvernements, provinciaux et fédéral, à défendre les droits de la personne. Ces droits ne figurent pas en très bonne place parmi les priorités gouvernementales où que ce soit au pays. Nos dirigeants n’ont pas exactement envie de nous donner les moyens de les tracasser. Nous semblons tous, partout, avoir simplement abandonné l’idée qu’il ne faudrait doubler les budgets prévus pour ce type d’activités, qu’il faudrait les décupler, parce qu’il y va de notre cohésion sociale.
Universitaire
Une bonne partie des participantes et participants ont émis l’avis que l’efficacité de tout changement dépendra vraisemblablement d’un considérable apport de fonds, pour couvrir tant les coûts transitoires que les coûts permanents.
Tout est finalement une question d’argent, et l’argent sera dépensé quelque part, que ce soit pour les activités du Tribunal ou celles de la Commission, si l’on veut que le système fonctionne. Je ne crois pas qu’il puisse être question de retrancher des fonds des services d’enquête et de les réutiliser ailleurs. Ce qu’il faut pour que les choses tournent rond, c’est augmenter le financement du système.
Spécialiste
Thèmes clefs
Nombreux sont les intervenants qui sont très inquiets de l’insuffisance du financement du système de protection des droits de la personne, à tel point que certains estiment qu’il serait temps de réfléchir à la conception et à la mise en œuvre de mesures objectives visant le financement des institutions chargée de la protection de ces droits.
4. L’instauration d’une culture des droits de la personne
S’il est vrai que quelques‑unes des personnes ayant participé à la consultation n’accordent guère de valeur à une culture des droits de la personne et jugent les institutions chargées de la protection de ces droits trop interventionnistes, la plupart des participantes et des participants ont indiqué que toute discussion relative au système ontarien de protection des droits de la personne devait surtout être axée sur l’instauration réussie d’une telle culture à l’échelle de la province. Selon la majorité, cette culture fait défaut, les droits de la personne ne sont pas une priorité, la population ne mesure en général pas l’importance de ces droits ni les répercussions de leur enfreinte, et trop peu de gens se rallient à la vision du Code et de la Charte des droits et libertés (« la Charte »).
Je pense que la majeure partie de la population, son groupe dominant ou appelez‑ça comme vous voudrez, ne se soucie vraiment pas des droits de la personne. Honnêtement, je nous vois comme des pions : nous formons une très petite communauté, dont les membres sont très attachés à la protection de ces droits, mais je ne pense vraiment pas que nous reflétons les sentiments de la plupart de nos concitoyennes et concitoyens. Les droits de la personne sont selon moi le cadet de leurs soucis.
Avocat représentant une partie plaignanteLa plupart des gens ont le sentiment qu’offrir des services de santé universels fait partie des obligations du gouvernement, mais il n’en est pas de même pour la protection des droits de la personne. Nous n’avons pas de culture de défense des droits de la personne, et cela s’explique en partie du fait que le gouvernement s’est désisté de ses responsabilités à cet égard. Il a constitué la commission des droits de la personne et il lui a dit « Allez, faites ce qu’il faut, ce n’est pas notre affaire. Voici combien d’argent nous pouvons vous donner, débrouillez‑vous. »
Clinique d’aide juridique
L’une des personnes ayant participé à la consultation pense pouvoir expliquer le manque d’engagement en faveur des droits de la personne au Canada :
Pourquoi les gens ne se soucient‑ils pas davantage des droits de la personne? … Quelqu’un qui n’a jamais été l’objet d’insultes liées à sa race ne sait pas ce que c’est que le racisme, ni ce que c’est que d’être lésé dans ses droits humains fondamentaux. … la plupart des Canadiennes et des Canadiens, bon nombre d’entre eux en tous cas, prennent le respect des droits de la personne pour acquis, faute de n’avoir jamais eu à se battre pour les faire respecter.
Organisme communautaire
Favoriser l’émergence d’une culture des droits de la personne est perçu par une partie des personnes ayant participé à la consultation comme indispensable à une mise en application efficace de ces droits.
Tous les gouvernements connaissent des difficultés financières, surtout de nos jours. Notre gouvernement peut prendre des mesures pour réduire les coûts du système en faisant en sorte que la reconnaissance et la protection des droits de la personne soient tout à fait normales dans la province. La nouvelle loi relative aux personnes handicapées représente par exemple un pas dans la bonne direction : le jour où elle sera pleinement mise en application, nous devrions assister à une baisse notable du nombre de plaintes pour atteinte aux droits de la personne émanant de particuliers.
Organisme de défense des droits de la personne
Comme nous y reviendrons dans la section traitant des questions d’harmonisation, nombreuses sont les personnes parmi celles qui ont participé à la consultation qui sont d’avis qu’il serait utile de prendre des mesures de protection des droits de la personne dans tous les secteurs et à l’égard de tous les aspects de notre vie en société. Quelques‑unes souhaiteraient par exemple voir, comme preuve fondamentale de l’engagement public en faveur des droits de la personne, que les lois en vigueur soient régulièrement passées en revue, afin de vérifier leur conformité au Code et à la Charte.
Enfin, bon nombre des participantes et participants sont d’avis que l’instauration d’une culture des droits de la personne nécessite l’organisation d’activités d’éducation du public aussi vastes que variées, et que l’éducation du public sur les droits de la personne devrait constituer l’un des rôles essentiels de toute institution gouvernementale chargée de protéger ces droits.
Les politiques officielles sont bien entendu le point de départ de la planification, mais il ne faut pas oublier que l’éducation est un élément indispensable, l’éducation du publique, l’éducation de tous les instants. Voyez‑vous, je n’ai pas peur de répéter à qui voudra l’entendre que ce qu’il nous faut, c’est « éduquer, éduquer, éduquer, encore et toujours éduquer ».
Organisme communautaireIl faudrait que le mandat éducatif de la Commission soit vaste et complet… Une approche proactive des droits de la personne nous oblige à modifier aussi bien nos attitudes que nos comportements. Pour cela, l’éducation sur les droits de la personne devrait commencer très tôt, dans les écoles : des notions telles que l’égalité véritable, la discrimination et le harcèlement pourraient très bien être incorporées aux programmes d’études.
Syndicat
Je dirais que les deux éléments indispensables sont la Commission et un tribunal. Je sais bien qu’en Colombie‑Britannique, les fonctions d’éducation ont été confiées à une coalition externe, mais quel que soit le savoir‑faire de cette coalition, et aussi bonnes que puissent être ses intentions, aussi fort son engagement, aussi dévoués ses intervenantes et intervenants, elle ne peut pas espérer obtenir les mêmes résultats qu’une Commission. Les initiatives d’éducation du public entreprises par une Commission ont plus de poids, il n’y a pas à dire, et le public les perçoit autrement, c’est indéniable.
Syndicat
Quelques voix se sont levées pour déplorer qu’il n’y ait pas plus d’activités d’éducation et de rayonnement locales en matière de droits de la personne, disant que la protection et la promotion efficaces des droits de la personne dépendent du contact établi avec les personnes les plus directement visées par ces activités :
Je me souviens avoir lu quelque chose, il y a longtemps, sur l’EOC [Equal Opportunity Commission] aux États-Unis. Ils avaient mené une campagne d’éducation du public au prix de plusieurs millions de dollars, puis en avaient évalué les résultats. La mesure la plus efficace a été le collage d’affiches dans des laveries automatiques, et non des choses comme la communication sur Internet ou d’autres moyens plus sophistiqués. Ce qui importe, c’est la présence sur le terrain.
Une personne travaillant pour la Commission a parlé du fait que le traitement de plaintes indépendantes et l’incorporation dans leurs règlements de mesures visant le redressement des problèmes systémiques et la protection de l’intérêt public contribuaient à faire évoluer la culture.
… Presque toutes les plaintes font entrer en jeu l’intérêt public, d’une manière ou d’une autre. Les remèdes systémiques, notamment l’adoption de certaines politiques ou la mise en place d’activités de formation, peuvent s’avérer bénéfiques même pour les lieux de travail qui ne comptent qu’un nombre faible ou moyen d’employés, vu leur effet sur la « culture » de l’endroit. Si ces remèdes se répandent petit à petit, employeur par employeur, comme c’est le cas à l’heure actuelle, ils finissent quand même, avec le temps, par donner naissance à une toute nouvelle culture.
Thèmes clefs
L’absence d’une culture des droits de la personne préoccupe la plupart des intervenants, qui appellent une multiplication des efforts, à l’échelle de la société, pour favoriser l’émergence d’une telle culture, surtout avec la prise de mesures au niveau de l’éducation primaire et moyennant l’éducation du public par les organismes gouvernementaux chargés de la protection des droits de la personne.
[2] Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, annexe au document Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Résolution 1992/54 adoptée par la Commission des droits de l’homme, supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A, documents officiels du Conseil économique et social des Nations Unies (CES NU), 1992; annexe de la résolution A/RES/48/134 adoptée par l’Assemblée générale, documents officiels des Nations Unies, 1993. Veuillez vous reporter à l’annexe C.