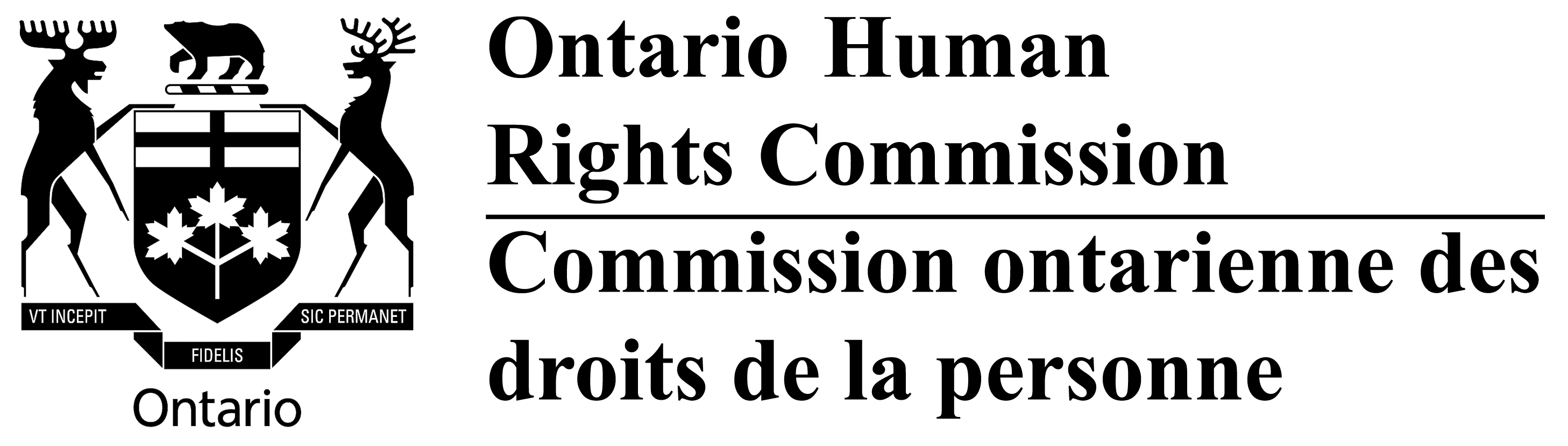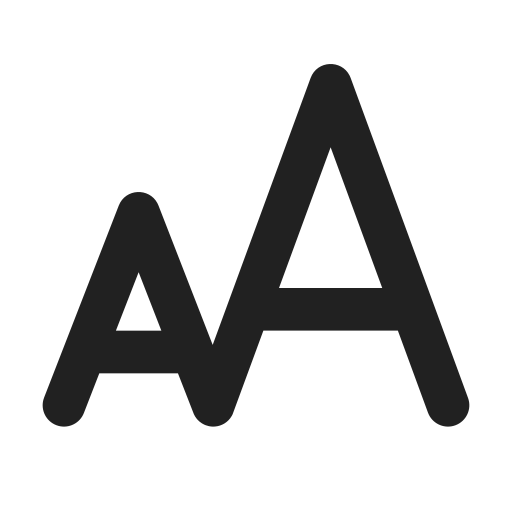Le Code définit trois critères dont il faut tenir compte pour savoir si une demande d’adaptation est susceptible de causer un préjudice injustifié. Il s’agit :
- du coût,
- des sources extérieures de financement, le cas échéant,
- des exigences en matière de santé et de sécurité, s’il y a lieu.
Mettre en oeuvre des mesures d’adaptation à l’égard des personnes handicapées est rarement aussi coûteux ou aussi difficile qu’on ne l’imagine. Plus des deux tiers des mesures d’adaptation au travail coûtent moins de 500 $, tandis qu’un grand nombre ne coûtent absolument rien.[52]
Le Code ne définit que trois critères. Par conséquent, en vertu des lois ontariennes, aucun autre facteur à l’exception de ceux qui se rapportent à ces trois normes ne peut être pris en considération. Dans certains cas, d’autres facteurs tels que le moral des employés ou une incompatibilité avec une convention collective étaient acceptés comme fondement d’un préjudice injustifié. Cependant, la législature ontarienne a jugé approprié d’adopter une norme plus élevée en limitant spécifiquement le préjudice injustifié à trois éléments. Cette interprétation vaste et téléologique du Code et des droits de la personne signifie qu’en règle générale les droits doivent être interprétés libéralement et que les arguments contre ces droits doivent être interprétés étroitement.[53] De plus, le Code a prépondérance sur d’autres mesures législatives,[54] en plus de prévaloir sur les ententes comme les conventions collectives.[55]
Plusieurs critères soulevés fréquemment par les répondants font donc l’objet d’une exclusion. La liste inclut entre autres les inconvénients professionnels, le moral des employés, la préférence des clients et les conventions collectives et contrats.[56]
5.1 Facteurs exclus
5.1.1 Inconvénients professionnels
Les inconvénients professionnels ne constituent pas un argument contre l’obligation d’accommodement. Les coûts attribuables à la baisse de productivité ou d’efficacité peuvent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice injustifié en vertu de la norme en matière de coût, pourvu qu’ils soient quantifiables et qu’on puisse démontrer qu’ils sont liés à l’adaptation projetée.
5.1.2 Moral des employés
Dans certains cas, les mesures d’adaptation visant un employé peuvent susciter des réactions négatives de la part de collègues qui ignorent les raisons de l’adaptation ou qui croient que la personne reçoit un traitement préférentiel. La réaction peut aller du ressentiment à l’hostilité. La personne responsable de l’adaptation doit donc s’assurer que les employés s’appuient mutuellement et contribuent à faire régner un climat favorable pour tous. Il n’est pas acceptable de permettre que des attitudes discriminatoires dégénèrent en hostilités qui empoisonnent l’atmosphère dans laquelle travaillent les personnes handicapées.
De plus, les personnes handicapées ont droit à des mesures d’adaptation qui respectent leur dignité. On fait un affront à quelqu’un lorsqu’on néglige d’empêcher ou de régler les problèmes liés au moral des employés et aux idées fausses qui résultent de la perception d’un manque d’équité. Dans de tels cas, on peut considérer que les responsables n’ont pas rempli leur obligation de fournir des mesures d’adaptation avec dignité.
5.1.3 Préférence des tiers
La jurisprudence sur les droits de la personne établit que la préférence des tiers ne justifie pas les actes discriminatoires, et ce principe s’applique aux préférences des clients.[57]
5.1.4 Conventions collectives ou contrats
Les conventions collectives ou les accords contractuels ne peuvent constituer une entrave qui empêche d’offrir une mesure d’adaptation. Les tribunaux ont statué que les conventions collectives et les contrats doivent respecter les exigences des lois sur les droits de la personne. L’inverse équivaudrait à permettre aux parties de conclure des accords en dehors de leurs droits en vertu du Code, sous l’autorité d’ententes privées. Par conséquent, sous réserve de la norme de préjudice injustifié, les dispositions des conventions collectives ou des ententes contractuelles ne peuvent justifier des actes discriminatoires interdits par le Code.
Un syndicat peut engendrer de la discrimination ou y contribuer en participant à la formulation d’une contrainte professionnelle, comme une disposition d’une convention collective ayant un effet discriminatoire.[58] Il appartient conjointement aux syndicats et aux employeurs de négocier des conventions collectives qui respectent les lois sur les droits de la personne. Ils devraient inclure des notions d’égalité dans les conventions collectives.[59]
Exemple : Lorsqu’un syndicat et un employeur négocient une convention collective, il est normal qu’on maintienne le principe général de l’ancienneté. Cependant, le syndicat et l’employeur peuvent déterminer ensemble comment on tiendra compte des besoins des employés handicapés.
Cependant, si un employeur et un syndicat ne parviennent pas à s’entendre sur une mesure d’adaptation, l’employeur doit mettre en oeuvre l’adaptation nécessaire malgré la convention. Si le syndicat s’oppose à l’adaptation ou refuse de collaborer au processus, il peut être cité comme intimé dans le cadre d’une plainte déposée auprès de la Commission.
Les syndicats devront satisfaire aux mêmes exigences afin de prouver un préjudice injustifié en matière de coûts et de santé et sécurité. Par exemple, s’il peut être démontré qu’un écart par rapport à une convention collective occasionne des frais directs, ce facteur peut être pris en considération en vertu de la norme de coûts. Les dispositions des conventions touchant la santé et la sécurité seront traitées dans la section intitulée Santé et sécurité.
Dans les milieux de travail non syndiqués, les employeurs peuvent offrir des conditions de travail plus souples afin de respecter l’obligation d’accommodement. Cette souplesse en matière de conditions de travail devrait être considérée dans les milieux syndiqués, bien que les arrangements requis puissent ne pas relever de la convention collective d’où se dégage l’obligation d’accommodement.
5.2 Fardeau de la preuve et preuve matérielle
Lorsqu’une personne responsable de l’adaptation souhaite invoquer l’argument d’un préjudice injustifié, c’est à elle qu’incombe le fardeau de la preuve.[60] Il ne revient pas à la personne handicapée de prouver que l’adaptation peut être réalisée sans que cela impose un préjudice injustifié.
La preuve exigée pour démontrer un préjudice injustifié doit être objective, réelle, directe et, lorsqu’il s’agit de coûts, quantifiable. La personne responsable de l’adaptation doit présenter des faits et des chiffres ainsi que des données ou des opinions scientifiques pour appuyer un argument voulant que l’adaptation proposée causerait réellement un préjudice injustifié. Une simple déclaration, sans preuve à l’appui, selon laquelle le coût ou le risque est « trop élevé », compte tenu de diverses impressions ou de différents stéréotypes, ne serait pas adéquate.[61]
Exemple :Un patient sourd demande les services d’un interprète gestuel dans un hôpital. L’administrateur de l’hôpital refuse de fournir l’adaptation, déclarant que « si tout le monde demandait un interprète, cela entraînerait la faillite. » L’administrateur ne fournit aucune information financière pour prouver son allégation ni ne présente de données démographiques sur le nombre probable de patients pouvant avoir besoin de tels services. Dans ce cas, il est fort probable que l’argument de l’hôpital sera rejeté.
Les preuves matérielles peuvent notamment inclure les éléments suivants :
- états financiers et budgets,
- données scientifiques, information et données découlant d’études empiriques,
- opinions d’experts
- renseignements détaillés sur l’activité et l’adaptation demandée,
- renseignements sur les conditions entourant l’activité et leurs effets sur la personne handicapée ou le groupe.
5.3 Éléments d’un argument fondé sur le préjudice injustifié
5.3.1 Coût
La Cour suprême du Canada a déclaré qu’« il faut se garder de ne pas accorder suffisamment d'importance à l'accommodement de la personne handicapée. Il est beaucoup trop facile d'invoquer l'augmentation des coûts pour justifier un refus d'accorder un traitement égal aux personnes handicapées. »[62] La norme de coûts constitue donc un critère élevé.
Les coûts représentent un préjudice injustifié si les conditions suivantes sont réunies :
- ils sont quantifiables;
- ils sont réputés découler de l’adaptation nécessaire;
- ils ont une importance telle qu’ils modifieraient la nature essentielle de l’entreprise ou ont une incidence telle qu’ils influenceraient considérablement sa viabilité.
Ce critère s’appliquera peu importe si l’adaptation vise une personne ou un groupe.
On établira le préjudice injustifié en se basant sur le reliquat des coûts après que l’ensemble des frais, déductions et autres facteurs ont été pris en considération.
Tous les frais projetés que l’on peut quantifier et dont on peut démontrer la pertinence à l’adaptation projetée doivent être pris en considération. Les spéculations pures et simples, par exemple, sur les pertes financières qui peuvent découler de l’adaptation aux besoins de la personne handicapée ne sont généralement pas convaincantes.
Sont compris dans les coûts financiers de l’adaptation :
- les dépenses d’immobilisations, comme l’installation d’une rampe d’accès ou l’achat d’une loupe d’écran ou d’un logiciel;
- les frais d’exploitation, comme les frais d’interprètes gestuels, d’accompagnateurs ou de personnel additionnel;
- les coûts engagés par suite d’une restructuration rendue nécessaire par l’adaptation;
- toute autre dépense quantifiable engagée directement par suite de l’adaptation.
On pourra avoir des inquiétudes quant à l’augmentation possible des primes d’assurance responsabilité en raison de la perception de risques en matière de santé et de sécurité attribuables à la présence de personnes handicapées sur lieux de travail. Les suppléments de primes d’assurance ou d’indemnités d’assurance-maladie pourraient entrer dans le calcul des frais d’exploitation lorsqu’ils sont quantifiés (c’est-à-dire hausses effectives, et non hypothétiques) et qu’ils ne sont pas contraires aux principes du Code dans le domaine de l’assurance.[63] Lorsque l’on peut quantifier et prouver un accroissement de la responsabilité et qu’on a tenté, en vain, de souscrire d’autres formes d’assurance, on peut tenir compte de la hausse des primes d’assurance responsabilité.
Pour savoir si des coûts financiers[64] pourraient modifier la nature essentielle de l’entreprise ou influencer considérablement sa viabilité, il faut tenir compte de ce qui suit :
- la possibilité, pour la personne responsable de l’adaptation, de récupérer les frais de cette adaptation dans le cadre normal des activités de l’entreprise (voir section 4.4.1);
- les subventions ou prêts offerts par les gouvernements fédéral ou provincial, les municipalités ou des organismes non gouvernementaux qui permettraient de compenser les frais d'adaptation;
- la possibilité, pour la personne responsable de l'adaptation, de répartir les frais de la mesure d’adaptation sur l'ensemble des activités de l'entreprise (voir section 4.4.2);
- la possibilité, pour la personne responsable de l'adaptation, d’amortir les dépenses d'immobilisations liées à l'adaptation selon les principes comptables généralement reconnus;
- la possibilité, pour la personne responsable de l'adaptation, de déduire des frais d'adaptation les économies qui peuvent en résulter, notamment :
- les exonérations d'impôt et les autres avantages offerts par les gouvernements (voir section 4.4.4),
- les hausses de productivité ou d'efficacité (voir section 4.4.5),
- l'augmentation de la valeur de revente de l'immeuble, si l'on peut à juste titre prévoir que l’immeuble pourrait être vendu,
- l'accroissement de la clientèle, de la réserve de main-d'oeuvre potentielle ou du nombre de locataires,
- la possibilité de se prévaloir du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés[65] de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (voir section 4.4.6).
Les grandes entreprises et le gouvernement sont sans doute mieux en mesure de donner l'exemple ou de prendre l'initiative pour répondre aux besoins d’adaptation des personnes handicapées. Les grandes entreprises peuvent sans doute absorber plus facilement les coûts d'adaptation. Les employeurs importants, par exemple, ont davantage l'occasion et les moyens d'offrir des emplois à un plus grand nombre de personnes handicapées en répondant à leurs besoins.
L'expression « avantages d'un meilleur accès à l'égalité » vise à tenir compte des avantages que peut faire rejaillir l'adaptation sur les collègues de travail ou camarades de classe, les parents et les amis de la personne handicapée ou sur le grand public.
5.3.1(a) Immeubles historiques
L'accessibilité aux immeubles historiques est une question qui donne lieu à de nombreuses controverses. La présente Politique ne prévoit pas de dérogation générale aux exigences en matière d'accessibilité pour les immeubles historiques, car cette exemption entraînerait de très nombreuses exclusions, étant donné que de plus en plus d'immeubles sont protégés du fait de leur valeur historique. Dans les cas d’immeubles historiques, il est admis que la nécessité de protéger les caractéristiques historiques de la conception des immeubles peut accroître les coûts d'adaptation. Cependant, l'évaluation ne doit pas tenir compte des caractéristiques esthétiques pures et simples de ces immeubles, à moins que ces caractéristiques n’aient également une valeur historique. Le critère de la modification de la nature essentielle de l'entreprise ou des incidences considérables sur sa viabilité permet de tenir compte de la protection des caractéristiques propres d'un immeuble historique comme facteur justifiable pour l'évaluation d'un préjudice injustifié.
5.3.2 Sources extérieures de financement
L’accessibilité à des sources extérieures de financement peut atténuer les coûts des mesures d’adaptation. Si les entreprises peuvent utiliser des ressources extérieures afin de respecter leur devoir d’adaptation[66], elles doivent le faire avant d’invoquer un préjudice injustifié.
Il existe trois sources extérieures de financement possibles :
1. Fonds rendus accessibles à la personne concernée seulement dans le cadre d’un programme gouvernemental relativement au handicap de cette personne.
Certaines ressources, comme des services ou des programmes, existent pour répondre aux besoins des personnes handicapées, que ce soit dans leur milieu de travail, à leur domicile ou lors de l’utilisation d’un service public.
Il se peut que les personnes handicapées aient à se prévaloir elles-mêmes des ressources extérieures qui leur sont offertes au moment de demander des aménagements à un employeur ou à un fournisseur de services. Cependant, ces ressources sont d’abord destinées à combler les besoins de la personne concernée, tout en respectant sa dignité.
2. Fonds établis pour aider les employeurs et les fournisseurs de services à assumer les coûts des mesures d’adaptation.
D’autres ressources extérieures peuvent être disponibles lorsque plusieurs entreprises exercent des activités qui se chevauchent ou qui sont interreliées dans le but de respecter leur devoir d’adaptation respectif.
Exemple : Un avocat malentendant au service d’un important cabinet bénéficie de services de sous-titrage en temps réel ou de l’aide d’un interprète gestuel, aux frais d’une cour. Lorsque cet avocat plaide, la cour se charge de combler ses besoins d’adaptation à la place du cabinet, mais uniquement durant les audiences.
Programmes de financement destinés à améliorer l’accessibilité des personnes handicapées – responsabilité d’ordre organisationnel.
Les gouvernements ont le devoir positif de s’assurer que les services généralement offerts au public le sont également aux personnes handicapées. Ils ne devraient pas se libérer de leurs responsabilités dans ce domaine en confiant la mise en œuvre de leurs politiques et de leurs programmes en matière de droits de la personne à des sociétés privées[67]. L’entreprise qui assume la responsabilité de la mise en œuvre d’un programme gouvernemental doit répondre aux besoins d’adaptation de ses clients.
5.3.3 Santé et sécurité
Les exigences en matière de santé ou de sécurité peuvent constituer une obligation imposée par une loi ou un règlement, ou découler de règles, de pratiques ou de procédures établies de façon autonome ou en collaboration avec d’autres entreprises ou services qui participent à des activités similaires.
Les entreprises doivent mettre en place des mesures garantissant que les risques liés à leurs installations ou à leurs services en matière de santé et de sécurité ne sont pas plus élevés pour les personnes handicapées que pour les autres. Lorsqu’une exigence en matière de santé et de sécurité a pour effet d’exclure une personne handicapée, il peut s’avérer nécessaire d’y apporter des modifications ou d’y renoncer. Si l’abolition d’une exigence en matière de santé et de sécurité risque d’entraîner la violation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), l’employeur doit trouver des solutions de rechange en fonction des clauses d’équivalence contenues dans la LSST[68]. En plus de procéder à une évaluation objective du risque, l’employeur doit prouver comment ses solutions de rechange offrent des chances égales aux personnes handicapées. Il peut cependant invoquer un préjudice injustifié si un risque important demeure, malgré ses efforts d’adaptation.
5.3.3 (a) Exigences raisonnables et de bonne foi
Un préjudice injustifié sera réputé exister sile risque qui subsiste une fois l'adaptation mise en œuvre l'emporte, par son ampleur, sur les avantages de l'égalité ainsi offerte aux personnes handicapées. La personne responsable de l’adaptation devra réussir l’épreuve en trois étapes présentée au point 3.2.
Les normes en matière de santé et de sécurité visant d’abord à protéger des travailleurs, des clients ou le public répondent habituellement à la deuxième étape de l’épreuve, contrairement à la norme fixée dans le but de contourner la législation sur les droits de la personne.
La troisième étape exige d’une entreprise qu’elle prouve que sa norme est raisonnablement nécessaire et que l’adaptation entraînerait un préjudice injustifié.
Les risques en matière de santé ou de sécurité posant un préjudice injustifié pourraient progressivement être réduits jusqu’à des niveaux acceptables, par exemple en ajoutant des dispositifs de sécurité ou en modifiant la description des tâches de façon à l’adapter aux employés handicapés. La mise au point d’une nouvelle technique permettant aux employés handicapés de se servir de certains appareils de façon plus sécuritaire pourrait toutefois exiger un délai. Aussi, en principe, la personne responsable de l’adaptation pourrait devoir intégrer des mesures qui réduiront le risque en matière de santé ou de sécurité à long terme, à la condition que le délai soit raisonnable et justifié par rapport au temps consacré à l’adaptation.
5.3.3 (b) Acceptation du risque
Il est possible qu’une personne handicapée accepte de courir un risque. Le risque qu’entraîne la modification ou l’abolition d’une exigence en matière de santé et de sécurité doit être pondéré par rapport au droit à l’égalité de la personne handicapée. Dans les cas où ce risque a une importance telle qu’il l’emporte sur les avantages de l’égalité, il est réputé donner lieu à un préjudice injustifié.
En cherchant à savoir si l'obligation de modifier une exigence en matière de santé ou de sécurité ou d'y renoncer, qu'elle soit définie par la loi ou non, crée un risque important pour quiconque, il faut tenir compte :
- de l’importance, de la probabilité et de la gravité du risque couru;
- des autres types de risques que la personne responsable de l’adaptation assume au sein de l’entreprise;
- des types de risques tolérés dans la société dans son ensemble et visés dans des normes légiférées, par exemple les conditions régissant l’obtention d’un permis, ou dans des entreprises du même type.
Le « risque » qui demeure après que toutes les précautions possibles ont été prises, y compris l’adaptation (dont on a soustrait le coût estimé du préjudice injustifié) mise en œuvre pour réduire ce risque, déterminera la valeur du préjudice injustifié.
Lorsque la modification ou l’abolition d’une exigence en matière de santé et de sécurité entraîne un risque pour une personne handicapée, la personne responsable de l’adaptation est tenue d’expliquer à la personne concernée le risque qu’elle peut courir. Autant que possible, il importe que les personnes handicapées puissent assumer avec dignité les risques auxquels elles sont exposées, sous réserve de la norme de préjudice injustifié. De plus, en vertu de la législation relative à la santé et à la sécurité, les entreprises ont le devoir d’éviter toute situation qui pourrait entraîner une menace directe ou blesser des personnes. La probabilité élevée de tels dangers est considérée comme un préjudice injustifié.
Gravité du risque
Le fait qu'une personne a une incapacité ne suffit pas, en soi, pour établir qu'il existe un risque. Cette affirmation soulève la question de la nature et de la qualité des éléments de preuve à soumettre pour définir la nature, la gravité, la probabilité et l'étendue du risque.
Lorsqu’on définit la gravité du risque, il faut examiner les critères suivants :
- la nature du risque
- quelles seraient les conséquences préjudiciables?
- la gravité du risque
- quelle serait la gravité des conséquences?
- la probabilité du risque
- quelle est la probabilité que les conséquences préjudiciables se produisent?
- s’agit-il d’un risque réel, ou purement hypothétique ou spéculatif?
- ces conséquences pourraient-elles se produire souvent?
- l’étendue du risque
- quelles sont les personnes qui subiront les conséquences de ce risque?
Ces cinq facteurs doivent être examinés ensemble afin d'établir la gravité du risque. Si les conséquences préjudiciables éventuelles sont légères et peu susceptibles de se produire, le risque ne doit pas être considéré comme grave. Un risque menaçant la sécurité du grand public doit être évalué selon le critère de l’étendue, alors que les conséquences préjudiciables possibles doivent être examinées selon le critère de la probabilité.
On ne peut établir la gravité du risque qu’après avoir déployé des efforts d’adaptation, en supposant que toutes les précautions qui s’imposaient ont été prises.
Exemple : Une responsable de l’acheminement des ambulances ayant une déficience auditive gère les appels téléphoniques d’urgence. Sa capacité d’exécution est jugée sûre et fiable dans la mesure où elle porte un appareil auditif et utilise un téléphone compatible avec cet appareil.
Autres types de risques
Lorsqu’on évalue la gravité du risque que représente l'obligation de modifier une exigence en matière de santé ou de sécurité ou d'y renoncer, il faut tenir compte des autres types de risques assumés dans une entreprise. Par exemple, de nombreux emplois comportent des risques inhérents à la nature du travail en soi.
De même, on peut refuser des emplois à des candidats parce qu'ils sont atteints de certains handicaps. Il faut signaler cependant que certains employés s'acquittent des mêmes fonctions depuis plusieurs années même s’ils sont atteints de limites identiques ou semblables qui ont plus ou pas d'influence sur leur capacité de s'acquitter de leurs fonctions de façon satisfaisante et sont donc sans incidence sur leur carrière.
Risques courants de la vie quotidienne
Il existe, dans les établissements de travail, de nombreuses sources de risques, outre les risques qui peuvent découler de l'adaptation aux besoins des employés handicapés. Tous les employés assument chaque jour des risques inhérents à un établissement ou à des conditions de travail qui peuvent être provoqués par la fatigue, un moment d'inattention ou le surmenage d'un collègue. Les employeurs savent que tous les employés ne sont pas productifs à 100 p. tous les jours; c'est pourquoi ils offrent des programmes d'orientation ou d'autres moyens de faire face à des difficultés financières ou affectives et à d’autres problèmes. Il faut tenir compte des risques qui découlent de ces situations pour définir le niveau de risque que nous acceptons dans la vie de tous les jours.
Les risques potentiels créés par les efforts d'adaptation doivent être évalués à la lumière des autres sources, plus répandues, de risques dans les établissements de travail.
Risques présents dans l’ensemble de la société
Il convient de tenir compte des autres types de risques qui existent dans des entreprises analogues ou dans la société dans son ensemble. Même s'il est toujours souhaitable d'accroître au maximum la sécurité, la société met constamment en équilibre le niveau de sécurité à atteindre et les avantages concurrents. Ainsi, nous mettons en équilibre les risques de blessures dans les sports et les avantages économiques et récréatifs. Nous mettons en équilibre les risques entraînés par des limites de vitesse plus élevées sur les routes et leurs avantages, qui consistent à accroître la fluidité de la circulation automobile. De même, nous mettons en équilibre les risques entraînés par la conduite de voitures moins chères et les frais qu'il faudrait engager pour les rendre plus solides et plus sécuritaires.
5.4 Minimiser le préjudice injustifié
Il importe de tenir compte des stratégies et des facteurs suivants pour éviter tout préjudice injustifié et respecter le devoir d’adaptation prescrit en vertu du Code.
5.4.1 Recouvrement des coûts
La personne responsable de l'adaptation devrait prendre des mesures pour récupérer les frais d'adaptation. Ainsi, elle pourrait apporter des modifications raisonnables à ses pratiques professionnelles ou tenter d’obtenir des subventions pour compenser ces frais. Si elle est d'avis que ces mesures ne lui permettront pas d'éviter un préjudice injustifié, elle devra démontrer que ces interventions ne sont pas appropriées dans les circonstances, qu'elles sont impossibles à réaliser ou qu'elles ne permettront pas d'avoir accès aux ressources nécessaires.
En d'autres termes, la personne responsable de l'adaptation devra prouver que les frais qu'elle devra supporter une fois adoptées les mesures de récupération des coûts modifieront la nature essentielle de l'entreprise ou en influenceront considérablement la viabilité.
5.4.2 Répartition des coûts
Les frais d'adaptation doivent être répartis le plus largement possible au sein de l'entreprise qui en est responsable, de façon à éviter qu'ils alourdissent le budget d'un seul service, employé, client ou filiale. Afin d'évaluer l'incidence du coût de l'adaptation, il convient de tenir compte du budget de l'entreprise tout entière, et non seulement de celui de la succursale ou de l'unité auprès de laquelle la personne handicapée est affectée ou à laquelle elle s'adresse pour demander un emploi. Dans le cas du gouvernement, le terme « entreprise tout entière » vise les programmes et services offerts ou financés par le gouvernement. Par exemple, certaines formes d'adaptation nécessitent des dépenses considérables, qui pourraient avoir pour effet de modifier la nature essentielle des programmes gouvernementaux, en totalité ou en partie, ou d'en influencer considérablement la viabilité, si elles étaient mises en oeuvre à bref délai. En pareils cas, il peut s'avérer nécessaire de réaliser l'adaptation prescrite de façon progressive.
5.4.3 Réduction du fardeau financier
Pour étaler le financement d'une adaptation dans le temps, une entreprise pourrait recourir à des emprunts, émettre des actions ou des obligations ou faire appel à d'autres moyens. L'amortissement ou la dépréciation constitue un autre moyen à la portée d’une entreprise en vue d'alléger son fardeau financier, dans la mesure du possible.
5.4.4 Exonérations d'impôt
On doit également tenir compte, pour compenser le coût de l'adaptation, des exonérations d'impôt et des autres avantages offerts par les gouvernements à ce titre.
5.4.5 Amélioration de la productivité, de l'efficience ou de l'efficacité
La personne responsable de l'adaptation devrait se demander si le fait de tenir compte des besoins d'une personne handicapée pourrait améliorer sa productivité ou son efficacité, permettre à l'entreprise d'étendre ses activités ou améli orer la valeur de l'entreprise ou de l'immeuble.
Exemple : Une adaptation visant un nombre important de personnes handicapées, par exemple une voie d'accès pour les fauteuils roulants, pourrait permettre aux exploitants de magasins ou aux prestataires de services de compter sur une nouvelle clientèle. L’ajout d’une rampe permettrait à beaucoup plus de gens de fréquenter un établissement commercial.
5.4.6 Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [69]
Il faut tenir compte des incidences du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du
travail. Si un travailleur subit une blessure causée par sa propre incapacité physique, on peut soumettre une demande d'indemnités à ce fonds, même si l'employeur n'avait pas connaissance de l'état préalable de l'employé. La présentation d’une demande d'indemnités à ce fonds n'a pas pour conséquence d'augmenter les taux de cotisation de l'employeur.
Étant donné que 90 % des employés de la province de l'Ontario sont protégés par la Commission et que ce fonds est offert à la plupart des employeurs assurés, il y aura peu de cas où la hausse des primes d'assurance-responsabilité pour les risques de blessures à une personne en raison d'un état ou d'un handicap physique préalables constituera un facteur donnant lieu à un préjudice injustifié.
5.4.7 Solutions d'aménagement ingénieuses
Les solutions d'aménagement ingénieuses permettent souvent d’éviter d'importantes dépenses d'immobilisations. Il peut s’agir, par exemple, d’adapter de façon particulière la conception d'un aménagement aux capacités fonctionnelles de la personne handicapée. Ces solutions doivent parfaitement respecter la dignité humaine.
5.4.8 Solutions moins coûteuses
Lorsque l'on invoque un préjudice injustifié, les devis et les évaluations du risque feront l'objet d'un examen attentif pour s'assurer qu'ils ne sont pas excessifs par rapport à l'objectif déclaré. Si c’était le cas, il faudrait envisager une solution de rechange moins onéreuse ou posant moins de risques pour réaliser l’adaptation (soit une mesure temporaire dans le cadre de travaux étalés, soit une disposition permanente), tout en respectant parfaitement la dignité de la personne handicapée.
5.4.9 Étalement des travaux
Certaines adaptations, par ailleurs très importantes, sont difficiles à réaliser dans un court délai.
Exemple : Une petite municipalité peut être en mesure de démontrer qu'elle subirait un préjudice injustifié si elle devait réaliser des adaptations pour rendre accessible à bref délai aux personnes handicapées son centre communautaire ou son réseau de transport. De même, une petite entreprise peut se trouver dans l'impossibilité de faciliter l'accès à son hall d'entrée et à ses toilettes sans subir de préjudice injustifié.
Dans ces cas, on peut éviter ce préjudice en étalant la réalisation des aménagements. Certaines adaptations, qui produisent des avantages pour un nombre important de personnes handicapées, ne peuvent être réalisées pour des raisons de coût. Selon une solution permettant de réduire le préjudice, il est possible d'étaler le coût des travaux sur plusieurs années en réalisant progressivement les aménagements.
Exemple : On pourrait chaque année rendre accessible aux personnes handicapées un certain nombre de gares sur un parcours ferroviaire utilisé pour le transport des banlieusards.
Dans plusieurs cas, si l'aménagement d'une adaptation est étalé sur un délai prolongé, il peut toujours être possible de mettre en oeuvre des aménagements provisoires à l'intention d'une personne handicapée. Si, à long comme à court terme, les aménagements peuvent être mis en oeuvre sans donner lieu à un préjudice injustifié, ces deux types d'adaptations devraient être considérés simultanément.
5.4.10 Constitution d'un fonds de réserve
La constitution d’un fonds de réserve auquel la personne responsable de l’adaptation devrait verser certaines sommes dans certaines conditions constitue une deuxième méthode de réduction de l’incidence des coûts d’un aménagement. L’une des conditions de la constitution de ce fonds devrait être que le fonds ne doit servir qu’à financer les frais d’aménagement des adaptations. Celles -ci pourraient être réalisées progressivement en puisant dans le fonds de réserve ou une fois que des fonds suffisants ont été réunis.
La solution du fonds de réserve ne doit pas remplacer celle de l’emprunt dans les cas où l’aménagement pourrait être réalisé à bref délai et que les frais connexes pourraient être amortis sur une certaine durée. Le fonds de réserve doit plutôt servir dans les cas où l’emprunt et la réalisation à bref délai de l’adaptation entraîneraient un préjudice injustifié pour la personne responsable de cette adaptation. Le fonds de réserve représente l’une des nombreuses solutions de financement envisagées pour évaluer la faisabilité d’une adaptation. S’il faut constituer un fonds de réserve, il faut prévoir la modification des règles pertinentes en fonction de l’évolution ultérieure de la situation.
L’étalement des travaux et la constitution d’un fonds de réserve ne doivent être envisagés que lorsque la personne responsable de l’adaptation a démontré que les travaux les plus appropriés ne pouvaient être réalisés à bref délai. Il faut, dans toute la mesure du possible, préférer l’étalement des travaux à la constitution d’un fonds de réserve.
5.4.11 Incidence des coûts restants
Une fois prise en compte la totalité des coûts, avantages, exonérations, sources de financement extérieures et autres facteurs, il faut ensuite savoir si les coûts (nets) restants modifieront la nature essentielle de l’entreprise responsable de l’adaptation ou influenceront considérablement sa viabilité.
La personne responsable de l’adaptation devrait alors démontrer l’incidence de ces coûts sur la nature ou la viabilité de l’entreprise. Elle ne pourra pas simplement affirmer, sans soumettre d’éléments de preuve justifiant sa conclusion, que les marges bénéficiaires de l’entreprise sont faibles et que cette dernière pourrait déclarer faillite si elle mettait en oeuvre l’adaptation nécessaire.
Enfin, si la présence d’un préjudice injustifié est démontrée, la personne handicapée doit avoir la possibilité de contribuer aux travaux d’adaptation ou de payer la partie des frais liés au préjudice injustifié.
5.4.12 Aide de spécialistes
Lorsqu’une analyse visant à établir s’il y a préjudice injustifié prévoit des dépenses d'immobilisations ou d’exploitation substantielles, ou d’importants changements aux procédures, à cause, par exemple, de modifications concrètes à un immeuble, à un chantier, à un véhicule ou à un bien d'équipement ou de nouvelles exigences en matière de santé et de sécurité, il est souhaitable que la personne responsable de l'adaptation demande une proposition et un devis à des experts dans la conception et la construction d'immeubles à accès facile.
[52] Cantor, A. The Costs and Benefits of Accommodating Employees with Disabilities, Toronto, 1996. En ligne : Cantor + Associates Workplace Accommodation Consultants http://www.cantoraccess.com/publications/accomm_1996_worksitenews_2.shtml
[53] Un certain nombre de cas confirment cette façon d’aborder l’interprétation des lois en matière de droits de la personne. Récemment, dans Mercier, supra note 10, la Cour suprême a résumé ces cas et a souligné les principes qui s’en dégagent pour l’interprétation des droits de la personne.
[54] Article 44 du Code.
[55] Renaud, ci-dessus note 49.
[56] Il ne s’agit pas d’une liste exclusive. Au cours des consultations, on a soulevé la question à savoir si la liberté de l’enseignement peut être comprise dans le préjudice injustifié. La liberté de l’enseignement n’est pas liée à l’obligation d’accommodement et ne devrait pas constituer un moyen de défense en regard de mesures d’adaptation pour les personnes handicapées. Par exemple, un étudiant peut demander que la salle de cours soit plus facilement accessible ou peut nécessiter plus de temps pour faire un examen en raison d’un handicap. Il s’agit là d’exigences légitimes qui ne portent pas atteinte à la liberté de l’enseignement. Si un besoin en matière d’adaptation constitue un tel fardeau financier pour une institution que cela équivaudrait à un préjudice injustifié en raison du coût ou parce que cela modifierait profondément la nature de l’entreprise ou affecterait sa viabilité, on satisferait alors au critère d’un préjudice injustifié. Cette question sera traitée plus en profondeur dans les directives sur l’adaptation dans le secteur de l’enseignement que la Commission compte publier.
[57] La question de la préférence des clients, des tiers et des employés est traitée dans : Keene, J. Human Rights in Ontario, 2e édition, Toronto, Carswell, 1992, p. 204-205.
[58] Renaud, supra note 49.
[59] Meiorin, supra note 6, alinéa 68. Les personnes qui établissent les normes et les règles devraient se préoccuper des différences entre les particuliers et les groupes de particuliers. Les normes et les règles ne devraient pas être basées uniquement sur la majorité, c.-à-d. les employés exempts de handicap.
[60] Grismer, ci-dessus note 29, à l’alinéa 42.
[61] Meiorin, supra note 6, aux alinéas 78-79, et Grismer, supra note 29, à l’alinéa 41. Des cas depuis Meiorin et Grismer ont aussi eu recours à cette exigence stricte en matière de preuve matérielle. Voir, à titre d’exemple, Miele c. Famous Players Inc. (2000), 37 C.H.R.R. D/1 (B.C.H.R.T.).
[62] Grismer, supra note 32, à l’alinéa 41.
[63] Paragraphe 25 (1) du Code.
[64] Pour une discussion plus approfondie sur la réduction des coûts, prière de consulter la section 4.4 « Minimiser le préjudice injustifié ».
[65] Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR), Document de principe (08-01-05) dans le Manuel des politiques opérationnelles antérieur à la Loi 99 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).
[66] Le Fonds «Accès» est un exemple d’une source extérieure de financement. Il aide les organismes communautaires à aménager des installations à accès facile de manière à permettre aux personnes handicapées d'agir comme bénévoles et de poser leur candidature lorsque des postes sont offerts. Faisant partie du Plan d'égalité des chances de l'Ontario, le Fonds «Accès» a été conçu en partenariat avec la Fondation Trillium de l'Ontario, qui assure sa mise en œuvre.
[67] Voir Eldridge, supra, note 5.
[68] L.R.O. 1990 chap. 0-1. Les règlements pris en application de la LSST prévoient des clauses d’équivalence pour permettre l’adoption d’autres mesures que celles stipulées, à la condition que ces autres conditions fournissent aux travailleurs une protection égale ou supérieure.
[69] supra, note 65