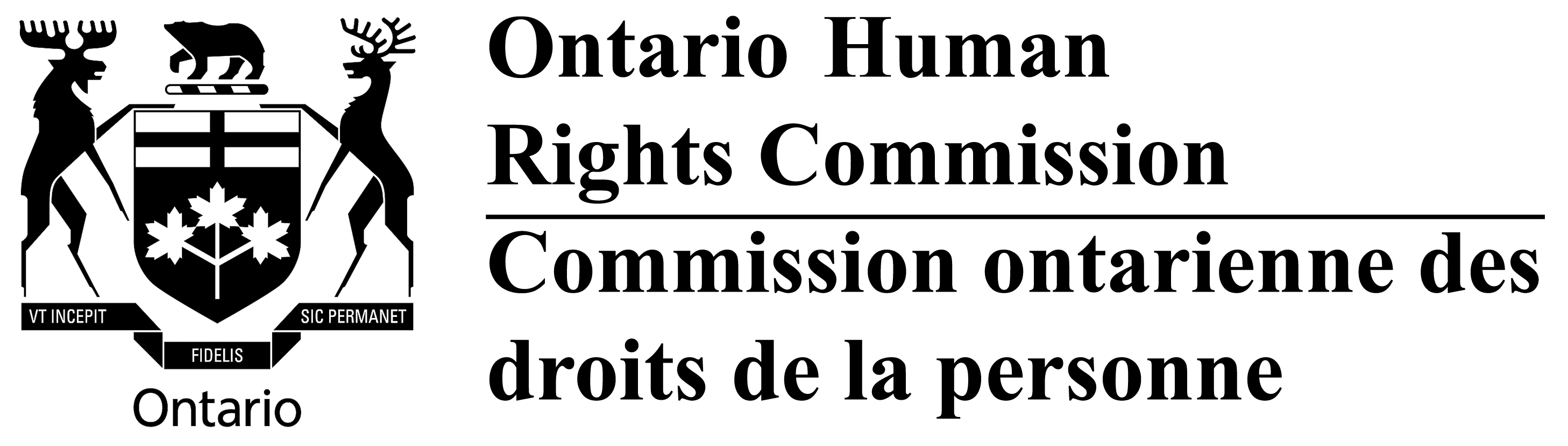En matière de logement locatif, le Code interdit la discrimination aux motifs suivants :
- La race
- La couleur
- L’origine ancestrale
- La croyance (religion)
- Le lieu d’origine
- L’origine ethnique
- La citoyenneté
- Le sexe (y compris la grossesse, l’identité de genre)
- L’orientation sexuelle
- L’âge
- L’état matrimonial
- L’état familial
- Le handicap
- L’état d’assisté social
L'intersectionnalité
Au cours des dernières années, l’analyse des droits de la personne a progressé de façon à tenir compte du contexte dans lequel survient la discrimination. En vertu du Code, les personnes sont protégées contre la discrimination et le harcèlement pour les motifs énumérés ci-dessus. On reconnaît cependant de plus en plus que la discrimination est souvent fondée sur plus d’un motif, et que ces motifs peuvent se croiser et produire ainsi des expériences uniques de discrimination.[88]
La Commission a longuement étudié cette approche contextualisée ou intersectionnelle de l’analyse de la discrimination dans son document de travail intitulé An Intersectional Approach to Discrimination: Addressing Multiple Grounds in Human Rights Claims.[89] D’après la Commission, pour bien juger les façons complexes et diversifiées dont les gens subissent la discrimination en matière d’adaptation de logement locatif, et leur faire justice, une approche contextuelle est nécessaire.
Le phénomène d’intersectionnalité se rencontre souvent dans les plaintes pour discrimination en matière d’adaptation de logement locatif. Il arrive fréquemment que des locataires subissent un traitement différencié fondé sur plus d’un motif, et ces motifs entrent en concurrence. Par exemple, une jeune mère seule et prestataire d’aide sociale qui cherche un logement locatif pourrait possiblement subir de la discrimination en raison de son sexe, son âge, son état familial et son état d’assistée sociale. Si elle est une personne racialisée ou si elle a un handicap, elle peut subir une discrimination pour ces motifs aussi.
Bien que les sections suivantes traitent de chaque motif prévu au Code individuellement, il importe de rester attentif à la possibilité que plus d’un motif soit en cause à la fois, et que ces motifs peuvent se croiser. Aussi, le présent document met en évidence certains des croisements de motifs les plus répandus, lorsqu'il y a lieu.
La race et les motifs connexes prévus au Code
Comme il en a été fait mention ci-dessus, outre la race, le Code interdit la discrimination en matière de logement locatif pour plusieurs motifs connexes. Ces motifs comprennent principalement la couleur, l’origine ethnique, l’origine ancestrale, le lieu d’origine, la citoyenneté et la croyance (religion).
Selon les circonstances, une plainte en matière de droits de la personne pour discrimination fondée sur la race peut ne mentionner que la race ou inclure un ou plusieurs motifs connexes. Toutefois, à titre de concept de société, le motif de race peut englober la signification de tous les motifs connexes, et toute caractéristique racialisée[90] qui alimente la discrimination.
La discrimination raciale en matière de logement locatif peut prendre diverses formes. Le problème le plus fréquent auquel les personnes racialisées continuent d’être confrontées est probablement le refus de présenter une demande de logement locatif ou de visiter des propriétés. À cet égard, les propriétaires peuvent utiliser des méthodes subtiles de sélection pour ignorer certaines personnes pendant le processus de sélection des locataires. Il peut arriver que des personnes racialisées soient avisées qu’un appartement est déjà loué, uniquement pour voir un ami blanc qui se renseigne au sujet du même logement se faire dire qu’il est encore libre.
En Ontario, de nombreuses affaires en droits de la personne ont porté sur ce type de discrimination raciale. Par exemple, dans Richards c. Waisglass[91], une commission d’enquête a jugé que le défendeur avait exercé une discrimination contre la plaignante, une femme noire, en raison de sa race lorsqu’il a refusé de lui louer un appartement. Lorsque la plaignante et le défendeur se sont rencontrés, le défendeur a semblé réservé, il a refusé de prendre tout renseignement au sujet de la plaignante et a déclaré qu’il désirait continuer de montrer l’appartement à d’autres locataires potentiels. Lorsque l’amie de la plaignante, une femme blanche, s’est rendue visiter l’appartement à la demande de la plaignante, elle a été chaleureusement accueillie et le défendeur lui a offert l’appartement. Le défendeur a prétendu que la raison pour laquelle il avait agi différemment avec la plaignante était parce qu’il était fatigué le jour de leur rencontre; qu’il avait pensé qu’une autre personne allait prendre l’appartement; et avait jugé d’après le comportement de la plaignante qu’elle semblait grégaire et pourrait faire des fêtes. La commission a estimé qu’à la suite de leur brève rencontre, le défendeur ne pouvait raisonnablement conclure que la plaignante serait tapageuse et ferait des fêtes bruyantes, et elle a conclu que le défendeur avait jugé improbable que la plaignante soit stable sur le plan financier et probable qu’elle aimerait faire des fêtes. La commission a conclu que les deux suppositions étaient fondées sur des stéréotypes négatifs au sujet des personnes noires.[92]
Les études de contrôle constituent un des moyens par lesquels les chercheurs ont tenté de mesurer la portée de la discrimination raciale en matière de logement locatif.[93] Ces études ont été menées à grande échelle aux États-Unis depuis les années 1970. Par exemple, au cours des années 1970 et 1980, le U.S. Department of Housing and Urban Development a appuyé plusieurs vérifications en matière de logement qui ont généré une importante preuve de discrimination et de traitement différencié envers les personnes racialisées dans l’ensemble des grandes villes américaines. Par exemple, aux vérificateurs noirs et hispaniques qui se présentaient comme des locateurs potentiels, on faisait visiter 25 pour cent moins d’appartements qu’aux vérificateurs blancs de revenu comparable.[94]
En 1999, des chercheurs de l'agglomération urbaine de Philadelphie ont effectué à grande échelle une vérification par téléphone pour comparer l’expérience d’interlocuteurs masculins et féminins en « anglais de la classe moyenne blanche », « anglais avec un accent noir » et « dialecte anglais noir » en tentant de louer un appartement. L’hypothèse des chercheurs était que la discrimination raciale sur le marché du logement locatif était devenue extrêmement subtile et secrète. Les auteurs se sont fiés à une recherche socio-linguistique qui démontre que les personnes sont en mesure de faire des distinctions raciales assez justes sur la foi de seuls indices linguistiques. En conséquence, les propriétaires sont capables de sélectionner des locataires potentiels en disant simplement, après avoir entendu parler le locataire, que l’appartement est « déjà loué ». On a qualifié cette pratique de « profilage linguistique ».[95] Qui plus est, à un âge de technologie sophistiquée où la plupart des individus ont accès à un système de messagerie vocale ou à un afficheur, les propriétaires peuvent sélectionner les aspirants locataires s’ils le désirent, en se fondant par exemple sur l’accent ou sur le nom, sans jamais avoir besoin de les rencontrer personnellement. Sur la foi d’un grand nombre de demandes téléphoniques soigneusement vérifiées, la vérification a établi « une preuve claire et souvent radicale de discrimination raciale au téléphone ». En particulier, les chercheurs ont conclu que :
Comparativement aux blancs, les Afro-Américains étaient moins susceptibles d’obtenir un correspondant et de parler à un agent de location, moins susceptibles de se faire dire qu’un logement était disponible, plus susceptibles de payer des frais de demande et en devenant admissibles à un bail, plus susceptibles de se faire mentionner que la capacité de payer pourrait constituer un problème. Le sexe et la classe sociale avaient des incidences sur ces effets raciaux et les exacerbaient en général. Les Noirs des classes inférieures ont eu moins souvent accès à des logements locatifs que ceux des classes moyennes, et les femmes noires ont eu moins accès que les hommes noirs. Le groupe le plus différencié, et de loin, était celui des femmes noires de classe inférieure. Par rapport à toutes les mesures utilisées, ce sont les interlocutrices féminines de dialecte anglais noir qui ont invariablement éprouvé le plus de difficulté. Par suite de cette discrimination d’une intensité inhabituelle, les femmes noires pauvres de Philadelphie sont forcées de passer beaucoup plus de leur temps et de consacrer beaucoup plus d’efforts à faire des appels téléphoniques pour seulement contacter des locateurs éventuels. Pour elles, la probabilité d’entrer en contact et de parler avec un agent de location est de loin la plus faible, et même si elles obtiennent un correspondant, elles ont la plus faible chance de se faire dire qu’un logement est disponible et la plus forte probabilité de devoir payer des frais de dossier.[96]
Des vérifications comparables réalisées dans des villes canadiennes, quoiqu’à une moindre échelle, ont révélé des points similaires. Ces vérifications indiquent que les personnes de communautés noires et autochtones en particulier, subissent un traitement discriminatoire lorsqu’elles tentent de louer un logement.[97]
Depuis le 11 septembre 2001, il y a également eu un accroissement de la discrimination contre les personnes identifiées ou perçues comme étant des musulmans, des Arabes et des Asiatiques du sud. La Commission a entendu plusieurs rapports au sujet de personnes qui ont subi de l’islamophobie[98] par des fournisseurs de logements au moment où elles tentaient d’obtenir un logement locatif.
La discrimination raciale en matière de logement locatif ne concerne pas seulement le refus d’accès à un logement. Pendant toute la durée de leur location, des locataires racialisés peuvent voir leur accès aux services connexes à leur logement être réduit ou être autrement sujets à un traitement différencié. Des locataires peuvent, par exemple, être sujets à des conditions de vie inférieures aux normes ou à l’omission de faire des réparations nécessaires. Dans Ontario (Human Rights Comm.) c. Elieff[99], la Cour divisionnaire a infirmé la décision d’une commission d’enquête qui a conclu que la plaignante n’avait pas subi de discrimination pendant sa location. La plaignante, une femme d’ascendance cambodgienne, a prétendu que son locateur avait fait un entretien inférieur aux normes dans son immeuble d’habitation, tant pour elle-même que pour d’autres locataires d’ascendance asiatique. Elle a aussi allégué que dans un article de journal, il avait fait preuve de discrimination envers eux par des commentaires de nature à discréditer les Asiatiques. La commission a conclu que, même si le manque d’eau, les fenêtres brisées et les appareils hors d’usage, les invasions de coquerelles et les eaux d’égout brutes sur la propriété constituaient des conditions inférieures aux normes, une plainte pour discrimination ou harcèlement en raison de la race ne pouvait réussir, étant donné que ces conditions affectaient les locataires tant non Asiatiques qu’Asiatiques. Elle a aussi accordé peu de poids aux commentaires que le locateur avait faits au sujet des Asiatiques. La commission a cependant accordé une indemnisation pour les actes de représailles commis par le défendeur après que la plaignante ait intenté une action. En appel, la Cour a maintenu le jugement concernant les représailles, mais a renversé la conclusion voulant qu’il n’y ait pas eu de discrimination envers la plaignante. La Cour a statué que les remarques de nature à discréditer les Asiatiques ont causé un traitement différencié pour les membres de ce groupe, même si tous les locataires de cet édifice ont subi les mêmes conditions de vie déplorables. Elle a conclu qu’un milieu de vie empoisonné avait été créé, ce qui constitue une violation du Code.
Les locataires racialisés peuvent également être soumis à des exigences inéquitables à l’égard de la location, surtout dans un climat de faibles taux d’inoccupation des logements locatifs. Par exemple, les locateurs peuvent tenter de demander davantage que le loyer autorisé par la loi pour un appartement ou ils peuvent exiger qu’un locataire paie un pas-de-porte, qui constitue un paiement unique additionnel et illégal que le locateur exige du locataire pour obtenir un logement.
La discrimination peut aussi survenir en raison de problèmes suscités par les pratiques culturelles de locataires racialisés. Par exemple, les odeurs de cuisine ont fait l’objet de deux décisions du tribunal. Dans Fancy c. J & M Apartments Ltd.[100], un tribunal a conclu que les locataires sud-asiatiques se sont vu refuser un appartement en raison de stéréotypes concernant les odeurs de cuisine. Dans Chauhan c . Norkam Seniors Housing Cooperative Association[101], on a jugé que la plaignante avait cuisiné chez elle des aliments qui constituaient une expression de son origine ethnique et ancestrale et causaient des odeurs. Elle a subi un traitement différencié lorsqu’on l’a intimée de cesser de causer ces odeurs ou de subir une expulsion. Le droit d’exprimer et de jouir de sa propre origine ethnique et ancestrale a été jugé essentiel à la dignité de la personne. De plus, il a été jugé que la conduite du locateur n’était pas justifiée par des motifs raisonnables et de bonne foi.
Des locataires racialisés peuvent également subir du harcèlement après l’octroi d’une location. Dans King c. Bura[102], un tribunal a conclu que les défendeurs propriétaires d’une maison partagée avaient harcelé et discriminé le plaignant pendant plusieurs années, ce qui avait eu de graves effets sur ce dernier, tant sur le plan émotif que physique. Le tribunal a accueilli le témoignage du plaignant voulant que les défendeurs aient proféré plusieurs propos racistes méprisants, dont certains étaient enregistrés sur ruban, l’aient harcelé après qu’il a été expulsé et l’aient traité de pédophile. Le tribunal était convaincu que ce comportement constituait de la discrimination et qu’elle créait un milieu empoisonné pour le plaignant.[103]
Des locataires peuvent également subir un traitement discriminatoire en raison de leur association avec une personne racialisée.[104] Par exemple, dans John c. Johnstone[105], on a jugé qu’un fournisseur de logements avait violé le Code lorsqu’il a expulsé sa locataire, une femme blanche, après qu’elle ait reçu un ami noir à dîner. Dans Hill c. Misener (No. 1)[106], une affaire plus récente de la Nouvelle-Écosse, une commission d’enquête a jugé que le défendeur avait exercé une discrimination contre la plaignante en faisant comme condition d’occupation qu’elle ne s’associe pas à des « personnes de couleur ». La plaignante, une femme blanche avec deux enfants biraciaux, a été profondément offensée, et même si elle n’a pas révélé au défendeur qu’elle ne pouvait louer l’appartement à cause de sa famille, la commission a jugé qu’il y avait eu discrimination et a accordé une indemnisation.
Les Canadiens autochtones
Bien que la population autochtone vive souvent les mêmes expériences que les autres groupes racialisés sur le marché du logement locatif, il semble que ce groupe soit confronté aussi à des difficultés uniques et particulières au moment de tenter d’obtenir un logement locatif. On a observé que :
Les Autochtones et itinérants autochtones constituent des cibles faciles de discrimination sur le marché du logement. On pense généralement que les Autochtones de la rue sont tous des « ivrognes ». Des façons de voir peuvent dissuader des locateurs de louer à des Autochtones dans le besoin... Il y a des hommes et femmes autochtones qui tombent dans la catégorie des personnes difficiles à loger. Ils éprouvent des difficultés particulières à louer un logement, et plusieurs n’y arrivent jamais vraiment ou sont expulsés. Dans la plupart des cas, les familles et personnes autochtones dans le besoin n’ont pas les ressources financières suffisantes pour se procurer un logement convenable.[107]
Dans Flamand c. DGN Investments[108], un tribunal a conclu que la plaignante avait subi de la discrimination en raison de son origine autochtone et de son état familial. Après avoir visité un appartement, elle a communiqué avec le défendeur propriétaire pour lui dire qu’elle désirait le louer et fixer un rendez-vous pour lui remettre le dépôt. Lorsque le défendeur a réalisé qu’elle était Autochtone plutôt que Canadienne française comme il l’avait présumé d’après son nom, il lui a demandé pour qui elle voulait l’appartement et a ensuite fait le commentaire que, « dès que vous louez à un couple d’Autochtones, il y a quinze Indiens qui arrivent avec eux ».[109] Il l’a ensuite avisée qu’il lui fallait montrer l’appartement à d’autres personnes et qu’il lui faudrait des références. Lorsqu’elle a repris contact par la suite pour lui donner les références, il a évité ses appels téléphoniques et l’a ensuite avisée qu’il recherchait plutôt un couple marié comme locataires. Le tribunal a reconnu la nature intersectionnelle du cas et a décidé que le défendeur avait fondé sa décision de ne pas louer à la plaignante sur les caractéristiques qu’il attribuait au peuple autochtone, conjuguées avec ses perceptions stéréotypées des mères monoparentales comme étant incapables d’assumer seules la responsabilité des soins d’un enfant.
En 2001, les ménages autochtones qui vivaient dans les régions métropolitaines de recensement du Canada étaient plus susceptibles d’être en besoin impérieux de logement que la moyenne des ménages dans une proportion de 50 pour cent. Il s’agissait d’une amélioration par rapport à 1996 où ils étaient plus susceptibles d’être en besoin impérieux de logements que la moyenne des ménages dans une proportion de 80 pour cent.[110] Les ménages autochtones restent toutefois beaucoup plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés et en mauvais état.[111] La SCHL a fait observer que les groupes autochtones subissent un désavantage particulier avec un taux de pauvreté urbaine qui s’élève à plus du double de la moyenne nationale.[112] Dans les pires des cas, tout finit par l’itinérance.
Les nouveaux Canadiens
Pour les nouveaux Canadiens, l’accès à un logement locatif convenable constitue une étape essentielle du processus d’adaptation. Le logement est le point d’entrée par lequel on peut accéder à toute une gamme d’autres ressources essentielles, dont des cours de langue, des possibilités d’emploi et des études. Pour cette raison, le logement sert souvent d’indicateur par lequel on évalue le degré d’ajustement auquel les nouveaux Canadiens sont parvenus dans leur nouvelle patrie.[113]
En plus de subir la discrimination raciale, les nouveaux immigrants et réfugiés doivent faire face à de nombreux obstacles concernant leur statut de citoyen dans le domaine du logement locatif. Il arrive souvent que les nouveaux Canadiens ne connaissent pas leurs droits en vertu des lois provinciales ou fédérales et s’ils ont été victimes d’abus, peuvent être trop intimidés pour s’exprimer.
D’après Statistique Canada, soixante-cinq pour cent des nouveaux ménages d’immigrants qui s’installent au Canada passent par le marché du logement locatif pour satisfaire leurs besoins en matière de logement. Au moment de leur arrivée, un bon nombre de ces ménages n’ont pas l’emploi, l’épargne ou la cote de crédit nécessaires pour acheter une propriété.[114]
Des travailleurs dans le domaine de l’habitation se sont régulièrement plaints de locateurs demandant à des nouveaux arrivants de payer leur loyer jusqu’à douze mois d’avance, malgré que de telles pratiques soient illégales.[115] Certains ont émis l’hypothèse que la pratique d’exiger des dépôts inabordables peut en soi être une tactique pour dissuader des locataires qu’un locateur n’estime pas « désirables ». La Commission a également reçu des plaintes d’immigrants et réfugiés récents auxquels on a demandé de fournir des dépôts de sécurité exorbitants pour obtenir un logement locatif.[116]
Les autres obstacles sont, entre autres, le fait de devoir satisfaire des critères de location qui désavantagent les nouveaux venus. Par exemple, les nouveaux Canadiens n’auront généralement pas d’antécédents de location ou d’emploi, de cotes de crédit ou de références provenant de locateurs au Canada. Dans Ahmed c.177061 Canada Ltd., une commission d’enquête a décidé que même si le Code autorise les locateurs à demander des renseignements sur le revenu, les antécédents de location, des vérifications de crédit et des références dans certaines circonstances, la politique de sélection de locataires du locateur était discriminatoire en ce qu’elle établissait un lien entre l’absence d’une cote de crédit et la probabilité de défaut de paiement du loyer.
Selon un rapport de Statistique Canada, de nombreux nouveaux Canadiens ne sont pas en mesure d’accéder à un logement convenable et finissent comme locataires en besoin impérieux de logement. Cette situation comporte plusieurs explications possibles. Une étude menée sur des Africains qui avaient récemment immigré à Calgary a conclu que la discrimination constituait un important obstacle à l’obtention d’un logement convenable.[117] Une autre explication serait que les nouveaux Canadiens ont tendance à s’établir dans les régions urbaines où le coût des logements locatifs est particulièrement élevé. Par exemple, le nombre d’immigrants qui sont arrivés à Toronto entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 2003 était de 661 850. Ce nombre correspond à 43,9 pour cent du nombre total au Canada.[118] En 2001, 43,5 pour cent des ménages d’immigrants récents vivant à Toronto se trouvaient en besoin impérieux de logement.[119]
Statistique Canada et la SCHL ont signalé que les nouveaux Canadiens, non seulement courent un risque élevé de se retrouver en besoin de logement, mais il leur arrive aussi au moins deux fois plus souvent que les ménages de non immigrants (sans compter les ménages autochtones) de vivre dans des conditions de logement inférieures aux normes (par ex., dans des logements surpeuplés ou dans des logements nécessitant des réparations majeures).[120]
Sexe
Statistique Canada et la SCHL signalent que les femmes qui vivent seules courent un risque élevé de se retrouver en besoin impérieux de logement. En 2001, par exemple, parmi les femmes qui vivaient seules dans les régions métropolitaines de recensement au Canada, 33,8 pour cent se trouvaient en besoin impérieux de logement. Une des principales raisons à cette situation est la haute fréquence de très faibles revenus chez ce groupe de locataires. Il arrive souvent que les femmes soient sans emploi, aient un emploi à temps partiel ou soient tout à fait hors du marché du travail et, dans plusieurs cas, dépensent plus de la moitié de leurs revenus en logement.[121] Cette situation est fréquemment aggravée par la discrimination que de nombreuses femmes subissent tant dans l’accès à un logement locatif que lors de son occupation. Bien que les hommes et les femmes peuvent tous deux subir de la discrimination fondée sur le sexe, en règle générale, ce sont ces dernières qui la subissent.
En raison d’une constante inégalité des sexes dans la société, il peut y avoir d’autres défis auxquels les femmes font face en ce qui touche le logement locatif. Comme l’a observé une organisation :
Les femmes assument une responsabilité disproportionnée en faisant face aux besoins qui peuvent surgir soudainement par la maladie un handicap au sein de la famille immédiate ou élargie. Les femmes subissent des pertes de revenu énormes après une séparation (une baisse moyenne de 23 % de leur revenu, tandis que les hommes subissent une augmentation de 10 %). Lors d’un divorce, les femmes qui sont mères et seules à assurer le soutien subissent en moyenne une baisse de 33 % en revenu de ménage. La grossesse et les soins de jeunes enfants causent souvent des interruptions de revenus.[122]
Tous ces facteurs auront des répercussions sur la capacité d’une femme à accéder à un logement locatif convenable.
La discrimination fondée sur le sexe dans le domaine du logement locatif peut survenir d’un certain nombre de façons différentes. Par exemple, les femmes peuvent faire l’objet de stéréotypes fondés sur le sexe dans leur recherche de commodités de logement. Dans Conway c. Koslowski[123], une commission d’enquête de l’Ontario a jugé que le défendeur avait exercé de la discrimination contre la plaignante en refusant de lui louer une maison en partie parce qu’il n’y avait pas d’homme dans sa famille pour faire l’entretien du terrain. La commission a rejeté la défense voulant que l’âge avancé du locateur et son horizon ethnique aient constitué les raisons de son refus de considérer la plaignante selon ses propres mérites, et elle a conclu que le défendeur avait pris sa décision au sujet de la nécessité d’avoir un homme dans la famille d’un locataire potentiel longtemps avant même d’avoir rencontré la plaignante.
Il y a aussi eu des cas où des hommes ont subi de la discrimination en raison de stéréotypes défavorables fondés sur le sexe. Par exemple, dans Leong c. Cerezin[124], un conseil de la C.-B. a jugé que le plaignant avait subi de la discrimination de la part du défendeur lorsqu’il s’est vu refuser l’occupation d’une suite parce que, d’après le gérant de l’immeuble, le propriétaire préférait les locataires féminines. En fin de compte, l’appartement a été loué à une femme pour la même date d’occupation que le plaignant avait demandé et pour un loyer moins élevé.
Les femmes aux prises avec une relation de violence ou qui tentent de quitter une telle relation peuvent vivre des difficultés particulières sur le marché du logement locatif. Comme le souligne une organisation : « La violence familiale et l’agression sexuelle peuvent créer des besoins soudains de logement qui n’étaient pas prévus quelques mois auparavant, et peuvent rendre les choix de logement d’urgence ou la cohabitation soudainement intenables ».[125] De plus, une femme peut risquer l’expulsion à la suite du comportement de son partenaire violent, en raison par exemple, de plaintes pour bruit causé par la violence ou de l’intervention de la police en cas de violence familiale. Alors qu’elle tente de quitter une situation de violence, il peut arriver qu’une femme ne soit pas capable d’obtenir une bonne référence de la part de son locateur en raison de la conduite de son conjoint. Dans sa recherche de nouvelles commodités de logement, elle peut subir de la discrimination si elle a des enfants ou si elle reçoit de l’aide sociale, et on peut exiger qu’elle verse un dépôt anormalement élevé si elle n’a pas ses propres antécédents en matière de crédit ou si elle a des antécédents défavorables. De nombreuses femmes retournent à des relations violentes parce qu’elles n’ont pas d’autre endroit où aller.[126] Dans l’affaire du meurtre de Gillian Hadley par son ex-époux, le jury de l’enquête du coroner reconnaît le rôle déterminant que le manque d’options de logements locatifs abordables a joué dans la constante vulnérabilité de Gillian Hadley envers son ex-époux. Le jury a fait un certain nombre de recommandations visant à augmenter l’accès des femmes et des enfants à un logement locatif abordable.[127]
Les femmes subissent souvent de la discrimination fondée sur le sexe combinée avec de la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs protégés par le Code. Par exemple, une femme seule avec des enfants peut se voir refuser une possibilité de se loger parce que le locateur a un point de vue fondé sur des stéréotypes défavorables selon lequel les femmes seules ne sont pas des locataires désirables.[128] Une femme peut se voir refuser une possibilité de se loger à la fois en raison de son sexe et, par association, de sa situation financière présumée. Par exemple, dans Turanski c. Fifth Avenue Apartments[129], le B.C. Human Rights Council a conclu que le défendeur avait exercé de la discrimination fondée sur le sexe contre la plaignante parce qu’elle était employée comme serveuse, et il a tenu pour acquis que ce métier traditionnellement féminin lui vaudrait un salaire si peu élevé que celui-ci l’empêcherait de faire ses paiements de loyer.
Les jeunes femmes sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et sans abri. Des études récentes démontrent que les femmes entre 15 et 24 ans ont de plus en plus de faibles revenus et rencontrent des obstacles au logement parce que l’on applique un critère de revenu minimum en logement locatif. De la même façon, les jeunes femmes sont désavantagées lorsqu’elles n’ont pas encore d’antécédents de crédit, d’expérience d’emploi valable ou des références d’un précédent locateur.[130] Bien que de jeunes hommes peuvent être confrontés à des difficultés similaires sur le marché du logement locatif, les jeunes femmes subissent de plus grands désavantages en raison de leur vulnérabilité au harcèlement sexuel et aux autres formes de violence contre les femmes.
Les femmes âgées aussi sont vulnérables à l’insécurité en matière de logement. Tout comme les jeunes femmes, en raison de leur situation et d’années passées en cohabitation avec des propriétaires (habituellement masculins) elles peuvent s’avérer incapables de fournir des antécédents de crédit indépendants et des références lorsque leur situation change et qu’elles cherchent à obtenir leur propre logement. Les femmes âgées sont également beaucoup plus susceptibles de vivre dans la pauvreté. Statistique Canada a fait savoir qu’en 1997, environ 50 pour cent des femmes seules âgées de 65 ans et plus vivaient dans des situations de faible revenu.[131] Les femmes lesbiennes, qu’elles vivent seules ou avec des partenaires du même sexe, sont également souvent sujettes à de la discrimination sur le marché du logement locatif.
Les exigences relatives aux antécédents de location et d’emploi peuvent aussi avoir un effet nuisible aux femmes qui ont quitté le marché du travail pour élever des enfants, fournir des soins à d’autres personnes, qui mettent fin à une relation de violence ou tentent d’une autre manière de s’établir et de subvenir à leurs propres besoins de façon autonome.
Selon le Centre pour les droits à l'égalité au logement, les femmes autochtones ont le taux de pauvreté le plus élevé au Canada, plus du double de celui des femmes non autochtones.[132] Par conséquent, en recherchant un logement sur le marché locatif, les femmes autochtones courent un risque élevé d’être victimes de discrimination fondée sur un certain nombre de motifs.
Les femmes autochtones ont également été victimes de discrimination lorsqu’elles ont tenté de trouver un logement sur les réserves. Par exemple, dans Raphael c. Conseil des Montagnais du Lac Saint-Jean[133], un tribunal fédéral a jugé qu’un conseil de bande avait fait preuve de discrimination fondée sur le sexe contre quatre femmes autochtones en leur refusant un logement ou d’autres services sur la réserve. Les quatre femmes avaient perdu leur statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, mais ce statut a été rétabli en 1985, lorsque le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-31. En septembre 1985, le conseil de bande a imposé un moratoire à la prestation de services aux « femmes du projet de loi C-31 » parce que la bande anticipait l’arrivée de nombreuses personnes sur la réserve. Le tribunal a conclu que les actes de la bande étaient discriminatoires. Les plaignantes se sont vues refuser des services tels que des permis de construire, des permis de chasse, des cours de langue, un logement et la permission de vivre sur la réserve.
À l'heure actuelle, lorsque survient la rupture d’un mariage ou d’une union de fait sur une réserve, il n’existe aucune disposition juridique obligeant le partage équitable des biens immobiliers matrimoniaux, soit la résidence familiale et le terrain où elle est située. Par conséquent, les femmes autochtones et leurs enfants n’ont aucun droit d’occuper la résidence familiale. Ils peuvent devoir quitter leur foyer et, en raison de pénuries de logements, être chassés de la réserve vers les marchés de logements urbains où ils peuvent être très vulnérables à la discrimination en matière de logement locatif[134].
Les femmes d’autres groupes racialisés sont également confrontées à de nombreux obstacles lorsqu’elles tentent d’obtenir un logement locatif. Les femmes racialisées sont deux fois plus souvent susceptibles d’avoir de faibles revenus que celles non racialisées.[135] Il s’ensuit qu’elles peuvent être victimes d’une « triple » discrimination, soit celles fondées sur le sexe, la race et, possiblement, l’état d’assisté social.
Les femmes handicapées aussi sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et d’être victimes de discrimination pour une combinaison de motifs.
Le harcèlement sexuel
Tous les Ontariens ont le droit d’occuper des commodités de logement sans subir de harcèlement sexuel. Bien que certains hommes subissent effectivement du harcèlement sexuel en logement locatif, ce sont les femmes qui sont le plus souvent touchées. Le harcèlement sexuel comprend les contacts sexuels mal venus et les remarques, les regards concupiscents, les regards inappropriés, les demandes de sortie indésirables, les demandes de faveurs sexuelles et l’étalage d’images offensantes ou de graffitis. Toute personne a le droit d’être exemptée d’avances importunes ou de demandes de faveurs sexuelles par un locateur, un régisseur, un employé de l’établissement, une autre personne en position d’autorité ou un autre locataire.
Il n’est pas nécessaire que les commentaires ou la conduite soient de nature sexuelle. Quelqu’un peut taquiner ou ennuyer une femme en raison d’idées fondées sur le sexe sur la façon dont les hommes ou les femmes « devraient » paraître, s’habiller ou se comporter.
En matière de commodités de logement, les personnes transgenres sont protégées contre les commentaires dégradants, les insultes ou un traitement différencié en raison de leur identité sexuelle.
D’après le Groupe de travail national sur les femmes et le logement, les femmes qui dépendent des programmes de suppléments de loyer et qui vivent dans des logements privés sont particulièrement vulnérables aux menaces et au harcèlement sexuel de leurs voisins ou locateurs.[136]
Une étude a conclu que le type de harcèlement subi par une femme en logement peut aller d’indiscrétions importunes sur sa vie privée à des visites imprévues à son logement quand elle est absente, des refus de faire les réparations nécessaires, des menaces de couper des services et des menaces d’expulsion.[137] Dans Reed c. Cattolica Investments Ltd[138], un défendeur a harcelé sexuellement une locataire qui était aussi son employée. Quand la plaignante a été forcée de démissionner après avoir subi un harcèlement sexuel verbal et physique pendant des semaines, le défendeur a soudain augmenté son loyer sans préavis, l’a menacée d’expulsion et soumise à des menaces sexuelles répétées et des obscénités lors de visites surprises à son appartement. Une commission d’enquête de l’Ontario a jugé que le défendeur avait violé des droits de la locataire à un traitement égal et lui avait fait subir des représailles.
Le déséquilibre de pouvoirs habituel qui existe entre locateurs et locataires est souvent aggravé par les inégalités de genre. On peut difficilement exagérer les répercussions causées par le fait d’être harcelé sexuellement chez soi. Comme l’a observé un théoricien, « l’interaction de relations relatives à la propriété privée et de rapports hommes-femmes prend un sens nouveau lorsqu’une sexualité de contrainte envahit la vie privée du foyer des femmes, des foyers qui sont souvent la propriété privée d’hommes ».[139] Il est fort possible que les femmes ne signalent pas toujours de tels incidents en raison d’une crainte de représailles par le harceleur.
L’état matrimonial
Au Code, l’état matrimonial est défini au sens large comme l’état de personne « mariée, célibataire, veuve, divorcée ou séparée et comprend l’état de vie avec une autre personne dans une relation conjugale à l’extérieur du mariage ». Dans l’affaire Miron c. Trudel [140], la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit au sujet de la situation des personnes non mariées qui vivent en relation :
Les personnes qui vivent en union de fait constituent un groupe historiquement d désavantagé. De nombreux faits établissent que les partenaires non mariés ont souvent subi un ésavantage et un préjudice au sein de la société. En effet, traditionnellement dans notre société, on a considéré que le partenaire non marié avait moins de valeur que le partenaire marié. Parmi les désavantages subis par les partenaires non mariés, mentionnons l'ostracisme social par négation de statut et de bénéfices.
Un certain nombre d’affaires ont traité de la discrimination fondée sur l’état matrimonial dans le contexte du logement. Ces affaires traitent souvent de situations dans lesquelles des individus célibataires sont considérés comme moins préférables ou sont carrément rejetés au lieu de couples mariés. Par exemple, dans Vander Schaaf c. M & R Property Management Ltd.[141], la plaignante a prétendu que sa demande de location a été rejetée par le régisseur en raison d’une préférence pour les couples mariés. Même si la plaignante et son colocataire gagnaient ensemble suffisamment pour atteindre le seuil du loyer proportionné au revenu de 25 pour cent, aucun des deux ne pouvait maintenir ce pourcentage individuellement. Il y avait toutefois des éléments permettant de démontrer que des conjoints colocataires auraient reçu un traitement différent étant donné qu’on aurait considéré leurs revenus combinés et non individuels. Comme en a décidé une commission d’enquête de l’Ontario, les défendeurs ont exercé une discrimination directe contre la plaignante.[142]
Un parent qui n’est pas marié ou divorcé subira souvent des désavantages combinés en raison du stigmate social continu associé au fait d’être un parent seul ainsi que les responsabilités financières, pratiques et émotionnelles supplémentaires propres à la monoparentalité. Les mères monoparentales sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et de se retrouver exclues du marché du logement locatif. Par exemple, dans Booker c. Floriri Village Investments Inc.[143], une commission d’enquête de l’Ontario a jugé que la plaignante avait été victime de discrimination parce qu’étant monoparentale et que le régisseur avait exprimé une préférence pour les couples mariés. Certains éléments de preuve indiquaient que la propriété était considérée comme un immeuble familial et l’administration jugeait que les ménages à parent unique ne constituaient pas une « famille ».
Dans Raweater c. MacDonald[144], la plaignante, une mère monoparentale d’origine autochtone, a allégué que le défendeur a critiqué le comportement de ses enfants et lui a demandé où se trouvait leur père. Il a affirmé que ses enfants seraient « moins perturbés » et « mieux contrôlés » si leur père était présent. Le défendeur a aussi envahi périodiquement sa vie privée et une fois, il lui a fait un commentaire offensant au sujet de son héritage autochtone. Un tribunal de la Colombie-Britannique a conclu que, pris isolément, ces commentaires n’auraient peut-être pas été suffisants pour conclure que la plaignante avait été victime de discrimination fondée individuellement sur l’état matrimonial, l’état familial et l’origine autochtone. Par contre, les considérant avec l'ensemble de ses autres actes, le tribunal a conclu que le défendeur avait traité la plaignante de façon méprisante en raison de la combinaison de stéréotypes qu’il entretenait contre les personnes autochtones et les mères célibataires.
La vulnérabilité particulière des mères seules soutien de famille et prestataires d’aide sociale a été reconnue par la Cour d’appel de l’Ontario dans Falkiner c. Ontario (ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels).[145] La Cour a statué qu’il y avait des preuves évidentes de désavantage historique et de préjudice persistant contre ce groupe, soulignant la rancoeur et la colère qu’ils reçoivent des autres membres de la société qui les considèrent comme des « resquilleurs et fainéants », et l’histoire de la stigmatisation, des stéréotypes et des restrictions offensantes sur leurs vies personnelles.
D’autres affaires ont traité de situations dans lesquelles des couples en union de fait sont victimes de discrimination en faveur de couples mariés.[146] Par exemple, dans Matyson c. Provost[147], les défendeurs refusaient de louer à des couples en union de fait parce que cela heurtait leurs croyances religieuses. Une commission d’enquête de la Saskatchewan a jugé que tandis que la liberté de religion des défendeurs était protégée par la Charte des droits et libertés et le Code des droits de la personne de la Saskatchewan, les défendeurs avaient la responsabilité de fournir des commodités de logement de façon non discriminatoire du moment qu’elles sont offertes au public.
L’état familial
Le paragraphe 10(1) du Code définit « l’état familial » comme étant le fait de se trouver dans une relation parent-enfant. Les plaintes concernant la discrimination fondée sur ce motif vont des personnes auxquelles on refuse un logement locatif de façon formelle ou non parce qu’ils ont des enfants ou vont en avoir, aux locataires éventuels ou actuels qui subissent un traitement discriminatoire en raison de la forme ou de la composition particulière de leur famille.
Au cours des dernières années, on a vu croître la diversité de la nature des familles canadiennes. Le nombre de parents uniques et de familles reconstituées continue de croître. Aussi, ce n’est que récemment que l’on a accordé une quelconque reconnaissance aux familles dirigées par des parents du même sexe. Les fournisseurs de logements n’ont pas nécessairement ajusté leurs politiques, programmes et pratiques pour faire face à ces nouvelles réalités.
De nombreux rapports décrivent le manque d’accès à des logements locatifs sûrs, abordables et convenables pour les familles qui ont des enfants, et surtout les familles de femmes monoparentales. D’après la SCHL, 42 pour cent des chefs de famille monoparentale ont un besoin impérieux de logement.[148] Le rapport Golden indiquait que les familles représentaient 46 pour cent des usagers des centres pour itinérants à Toronto en 1996. À cette époque, 19 pour cent de la population des sans-abri à Toronto, ou 5300 itinérants, étaient des enfants. Sur les 100 000 personnes sur la liste d’attente pour des logements subventionnés, 31 000 étaient des enfants.[149]
Le manque d’accès à un logement convenable et abordable a des conséquences à long terme. Par exemple, les enfants de familles qui dépensent la majorité de leur revenu en loyer courent un risque plus élevé de souffrir de malnutrition, de maladies respiratoires et autres.[150] On a également établi des liens entre le logement et les caractéristiques du voisinage, et le niveau scolaire des enfants. La santé socio-émotionnelle des enfants est étroitement associée à la qualité du logement.[151] Une étude récente a découvert que la détérioration des conditions de logement à Toronto constitue un facteur déterminant pour l’admission d’enfants aux soins de la société d'aide à l'enfance : les familles et enfants qui sont clients de la société d'aide à l'enfance à Toronto sont confrontés à d’importants obstacles à l’obtention d’un logement convenable et approprié, et pour certains, cette situation nuit à leur capacité d’avoir soin de leurs enfants.[152]
Dans les pires des cas, des familles sont obligées de vivre dans des refuges. La discrimination contre les familles de femmes monoparentales, en particulier, peut facilement pousser une famille entière à l’itinérance. Des enquêtes menées dans les refuges indiquent une augmentation considérable d’usagers chez les femmes avec des enfants, et surtout les femmes autochtones et noires.[153] Les familles monoparentales se retrouvent dans le réseau de refuges à un rythme deux fois plus élevé que les familles à deux parents.[154]
Dans plusieurs cas, sinon la plupart, une personne sera victime de discrimination fondée sur l’état familial en même temps que sur un ou plus d’un motif protégé par le Code et ces motifs peuvent se croiser, et engendrer des expériences inédites de désavantages et de discrimination. Étant donné que les femmes continuent d’être les principales dispensatrices de soins pour la plupart des familles de l’Ontario [155], la discrimination fondée sur l’état familial comportera souvent une composante de genre. De plus, les familles avec de jeunes enfants peuvent être marginalisées sur le marché du logement locatif, surtout dans les cas où l’état familial recoupe l’état matrimonial, l’état d’assisté social ou les motifs du Code liés à la race. Les couples homosexuels et de parents uniques gais ou lesbiennes qui élèvent des enfants peuvent aussi être victimes d’attitudes défavorables et de stéréotypes parce qu’ils ne se conforment pas aux modèles familiaux normatifs.
Il importe de porter une attention spéciale aux moyens complexes par lesquels l’état familial recoupe les motifs du Code liés à la race. Les stéréotypes négatifs envers les familles prennent des formes précises pour divers groupes racialisés. Les recherches qui ont été menées dans le domaine de l’accès au logement locatif abordable, par exemple, portent à croire que parmi toutes les familles qui cherchent un refuge, les familles monoparentales des communautés racialisées et autochtones sont les plus désavantagées.[156]
Les questions d’état familial dans le domaine du logement locatif ont donné lieu à d’importants litiges, surtout dans le contexte ontarien. Partant, la jurisprudence en Ontario favorise en général une protection étendue à la relation parent-enfant dans le contexte du logement locatif. En commençant par Fakhoury c. Las Brisas Ltd.[157], les tribunaux ont reconnu les droits et l’importance des familles et la nécessité de protéger les droits relatifs à l’habitation. La jurisprudence a régulièrement élargi la portée de la protection de l’état familial pour y inclure le refus de logement à une femme parce qu’elle est enceinte, pour combattre l’animosité contre les familles monoparentales et pour assurer la protection des familles dont les parents ne sont pas légalement mariés.[158]
De nombreuses affaires en matière d’état familial abordent les obstacles systémiques que rencontrent les familles qui tentent d'avoir accès à un logement. Les tribunaux ont conclu que la stipulation par les locateurs d’un nombre minimum de chambres à coucher en fonction du nombre et du sexe des enfants peut avoir pour effet de gêner l’accès au logement pour les familles monoparentales.[159] Les tribunaux ont aussi statué contre le fait de restreindre les immeubles d’habitation aux « familles » dans les cas où cette désignation exclut les familles monoparentales ou les couples qui vivent en union de fait.[160]
Certains locateurs ont des politiques qui interdisent aux locataires de passer d’un logement à l’autre dans le même immeuble. De telles politiques peuvent avoir un effet défavorable sur les familles qui ont des enfants, parce que leurs besoins relatifs au logement locatif progressent avec la croissance de leur famille, mais pour satisfaire leur besoin d’espace additionnel, ils sont obligés de quitter leur immeuble. Dans Ward c. Godina[161], une commission d’enquête a jugé que les « politiques aucun transfert » ont un effet nuisible sur les familles ayant des enfants et violent le Code.
Les politiques concernant le nombre d’occupants par nombre de chambres peuvent aussi avoir un effet défavorable sur les familles ayant des enfants. Dans Desroches c. Québec (Commission des droits de la personne)[162], la plaignante s’est vue refuser la possibilité de louer l’appartement de son choix lorsque le locateur a découvert qu’elle était en instance de divorce, et que ses deux filles la visiteraient chaque dimanche. Le locateur avait comme politique de ne louer aucun de ses appartements quatre et demi à plus de deux occupants. La Cour d’appel du Québec a statué que cette politique constituait [TRADUCTION] une « barrière anti-enfants très efficace », puisque la politique avait pour effet d’exclure tous les enfants qui vivent avec deux parents ainsi que les familles monoparentales ayant plus d’un enfant. Par conséquent, la politique violait la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. La situation opposée pouvait également susciter des appréhensions. Par exemple, une politique voulant qu’une personne seule ne puisse louer un appartement avec plus d’une chambre peut empêcher un parent divorcé de recevoir la visite de ses enfants et qu’ils restent pour la nuit.
Dans une affaire plus récente[163], un locataire avait pour politique privée de louer ses appartements à une chambre seulement à des couples ou des célibataires; de deux chambres à des couples ayant un enfant et de trois chambres à des couples ayant deux enfants. Bien qu’il pouvait louer un appartement à trois chambres à une personne ou à un couple ayant trois enfants, il ne le faisait que si les enfants étaient très jeunes et même en pareil cas, la famille allait très bientôt devoir déménager dans un logement plus vaste. La plaignante dans cette affaire était une mère seule de trois enfants, qui était à la recherche d’un appartement à trois chambres (qu’on lui a refusé). Il a été jugé que cette politique avait un effet discriminatoire fondé sur l’état familial. On s’est également inquiété de politiques qui imposent des restrictions au partage de chambres par des frères et soeurs, au motif que de telles politiques peuvent réduire la capacité de familles ayant des enfants d’avoir accès à un logement locatif abordable. Ces types de politiques peuvent avoir des répercussions importantes sur les droits sociaux et économiques des familles, du fait qu’elles bloquent effectivement l’accès au type de logement qu’elles ont les moyens de se procurer.
Malgré ces progrès de la jurisprudence, cependant, l’état familial fait encore partie des motifs de discrimination les plus souvent mentionnés dans les plaintes déposées à la Commission à l’égard du logement. Un certain nombre de rapports ont indiqué que la discrimination continue de jouer un rôle important pour déterminer qui peut obtenir et conserver un logement locatif convenable et abordable. Le rapport Golden sur l’itinérance[164] stipule que :
[I]l n’est pas rare que des familles qui vivent dans des refuges ou des motels, des familles qui ont de bons antécédents de crédit et de bonnes références, se voient refuser un appartement par plusieurs locateurs différents. Pour ceux qui ont le plus besoin d’un logement, la discrimination peut rendre le marché impénétrable.
Cette observation est corroborée par la tendance constante des plaintes adressées à la Commission sur des problèmes de logement. Comme le précisait un rapport, « le fait d’axer les efforts sur l’inventaire de logements locatifs ne résoudra pas la crise, si la discrimination sans restriction des locateurs continue de refuser le logement à ceux qui en ont le plus besoin ».[165]
Dans une décision récente, un tribunal ontarien des droits de la personne a conclu qu’une mère monoparentale s’est vue refuser la possibilité de louer un appartement après que le locateur a découvert qu’elle avait un enfant. Le locateur a déclaré qu’il ne louerait pas l’appartement à une famille ayant des enfants et a aussi refusé de rendre le dépôt de la plaignante. La plaignante a témoigné qu’il lui a fallu cinq mois pour trouver un autre appartement convenable : il lui est arrivé à peu près cinq fois d’être refusée par des locateurs qui ont affirmé ne pas vouloir louer à des gens qui ont des enfants.[166]
Divers stéréotypes et attitudes peuvent aussi intervenir dans un refus de louer à des familles ayant des enfants. Par exemple, des locateurs peuvent refuser de louer aux familles ayant de jeunes enfants parce que ceux-ci sont « bruyants » et dérangeront les autres locataires. Les locateurs qui insistent pour que les locataires mènent « une vie tranquille » ou qui informent les locataires du fait que l’immeuble n’est pas « insonorisé » sont des thèmes qui reviennent souvent lors du rejet de locataires potentiels ayant de jeunes enfants.[167] Pendant leur occupation d’une résidence, des familles peuvent être victimes de harcèlement par d’autres locataires et par les fournisseurs de logement, et peuvent même être menacées d’expulsion en raison du comportement normal de leurs enfants. Des problèmes peuvent survenir relativement à des familles entières expulsées en raison de comportements inacceptables chez un enfant.
Le tribunal a jugé que la pratique des locateurs qui demandent de préciser l’âge de locataires potentiels sur les formulaires de demande était à sa face même un acte de discrimination fondée sur l’état familial. Il incombera aux locateurs qui posent de telles questions d’établir qu’il n’y avait en fait, aucune discrimination de cette nature :
Il y a beaucoup de mérite à l’argument de la Commission voulant qu’un locateur se limite à demander l’âge du colocataire potentiel, afin de pouvoir refuser la demande, si la réponse révèle que ce dernier est un enfant ou peut-être une personne âgée. Bien que l’on puisse alléguer qu’un locateur a besoin de connaître l’âge des colocataires dans son immeuble en cas de feu et pour de nombreuses autres raisons, il lui sera toujours loisible d’obtenir de tels renseignements après avoir loué ses logements.[168]
La Commission a aussi reçu des plaintes dans des cas où les actes du locateur sont fondés, non pas sur la présence d’enfants en soi, mais sur le nombre d’enfants dans la famille. La Commission a estimé que ces plaintes s’inscrivent avec le motif d’état familial.
La Commission se préoccupe de la pratique répandue par laquelle on désigne des appartements à louer et autres logements comme « pour adultes seulement » ou « communautés pour adultes ». Il est fréquent de voir annoncer des logements locatifs avec « mode de vie pour les adultes » et la Commission a renvoyé un certain nombre de plaintes à des audiences devant le tribunal, dans des cas où les demandeurs ayant des enfants se sont vu refuser la location de tels logements. De fait, ces locateurs annoncent leur intention d’exercer une discrimination contre les familles ayant des enfants.[169]
La discrimination peut aussi être fondée sur des stéréotypes précis ou des attitudes négatives envers les mères monoparentales, les familles prestataires d’aide sociale, les familles dirigées par un parent gai ou lesbienne, ou les familles de communautés racialisées.
Les fournisseurs de logement ont l'obligation de satisfaire les besoins en logement liés à l’état familial jusqu'au point de la contrainte excessive. On a signalé à la Commission que des familles ont été écartées de logements locatifs à cause de soucis relatifs à la sécurité des enfants. Il peut y avoir, à l’occasion, des situations où certains aménagements peuvent être nécessaires au logement pour répondre aux besoins des enfants. Par exemple, il peut être nécessaire d’installer des dispositifs de sécurité aux fenêtres ou aux balcons dans les appartements de tours d’habitation. De telles mesures peuvent constituer des accommodements nécessaires de la part d’un fournisseur de logements. Les familles ayant des enfants ne devraient pas être écartées de logements locatifs pour la seule raison que de telles mesures raisonnables sont nécessaires.
On a également signalé à la Commission que des familles sont expulsées de leur appartement à cause du bruit d’enfants qui pleurent. La vie dans une habitation de type appartement comporte inévitablement une certaine exposition aux bruits et activités de ses voisins. Plusieurs activités normales causent du bruit – écouter de la musique ou faire des activités sociales, par exemple. Les enfants, comme les autres locataires, peuvent faire du bruit dans le cadre de leurs activités normales, telles que jouer, parler et pleurer. Il ne faudrait pas traiter les bruits associés aux activités normales des enfants différemment des autres types de bruits qui peuvent être entendus lorsqu’on vit à distance rapprochée. Il ne faudrait pas non plus que le bruit normalement associé à la présence d’enfants soit une excuse pour refuser de louer à des familles ayant des enfants. Dans les cas où le bruit causé par les enfants est réellement dérangeant pour les autres locataires, toutes les parties peuvent collaborer pour résoudre le problème. Les parents peuvent prendre des mesures raisonnables, compatibles avec de bonnes pratiques parentales, pour réduire le bruit causé par les enfants. Les fournisseurs de logements ont également une responsabilité de tenter de résoudre les problèmes sans expulser les familles. Par exemple, une meilleure insonorisation pourrait être envisagée pour un appartement ou le déplacement d’une famille dans un autre appartement.
L’orientation sexuelle
Le Code prévoit que toute personne a droit à un traitement égal dans le domaine des commodités de logement, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Les locateurs et autres fournisseurs de logement doivent s’assurer qu’ils ne refusent pas un logement à des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Dans la même veine, ils doivent s’assurer que le traitement qu’ils accordent aux locataires actuels ne soit pas discriminatoire, ni influencé par des jugements subjectifs quant à l’orientation sexuelle ou par des attitudes négatives envers l’homosexualité ou les homosexuels et lesbiennes.
Les fournisseurs de logements doivent également s’employer à résoudre toute discrimination ou tout harcèlement relatifs à l’orientation sexuelle, qui peut survenir dans l’environnement de leur logement locatif, que ce soit entre locataires ou qu’il implique des représentants du fournisseur de logements ou d’autres personnes faisant partie de l’entourage (par ex., des travailleurs d’entretien à forfait). Si un fournisseur de logements devient conscient d’actes de discrimination ou de harcèlement, que ce soit au moyen d’une plainte ou autrement, il doit réagir de façon appropriée. Les fournisseurs de logements qui omettent de prendre des mesures pour corriger un milieu empoisonné ou répondre à une plainte de discrimination ou de harcèlement pourront voir leur responsabilité engagée.
En logement locatif, il y a plusieurs différentes façons dont les homosexuels et lesbiennes peuvent être victimes de discrimination. Par exemple, on peut leur refuser la possibilité de visiter un logement en raison de leur orientation sexuelle. À la fin des années 1990, lors d’une vérification par téléphone menée dans les villes de Windsor et London en Ontario, et Détroit au Michigan, on a fait 180 appels téléphoniques, où la moitié des appelants ont formulé de simples demandes de renseignements au sujet des logements disponibles, et l’autre moitié a formulé des demandes similaires, mais en se faisant un devoir de révéler leur orientation sexuelle comme homosexuel ou lesbienne. À ce dernier groupe, les locateurs avaient nettement plus tendance à affirmer que les logements n’étaient plus disponibles.[170]
Comme un chercheur l’a déclaré, dans les cas d’habitations locatives privées,
Il semblerait que, malgré une connaissance accrue de l’homosexualité dans la société, les personnes ainsi identifiées sont encore aux prises avec un bon nombre de situations de rejet qu’ils ont subies pendant de nombreuses années – au moins quand un tel rejet est exprimé en privé, apparemment légitime et susceptible d’être considéré comme indétectable par son auteur.[171]
L’expérience des couples homosexuels (qu’ils soient mariés ou vivent ensemble hors des liens du mariage) ou des homosexuels et lesbiennes monoparentaux est aussi unique. Ces parents peuvent se retrouver à faire les frais de stéréotypes négatifs et peuvent être victimes de traitements discriminatoires parce qu’ils ne se conforment pas à la norme habituelle de la « famille nucléaire ». Dans certains cas, eux et leurs enfants peuvent être victimes de harcèlement en raison de leur mode de vie.
À l’heure actuelle, il y a peu de cas signalés de discrimination et de harcèlement fondés sur l’orientation sexuelle en matière de logement. En Ontario, il n’y a eu que deux affaires jusqu’à présent, et les plaignants ont échoué dans les deux cas.[172] Cependant, il s’agit d’un domaine du droit et de la politique sociale qui est en progression et dans d’autres provinces, des plaintes ont été couronnées de succès.[173]
L’âge
En matière de logement, le Code interdit la discrimination fondée sur l’âge seulement pour les personnes âgées d’au moins 18 ans.[174] En d'autres termes, à l’exception des personnes qui sont âgées de seize ou dix-sept ans qui se sont soustraites à l'autorité parentale, les fournisseurs de logement ont le droit, en vertu du Code, de restreindre les commodités de logement qu’ils offrent aux mineurs. Il importe cependant de souligner qu’une récente décision d’un tribunal a indiqué que la définition de l’âge au Code peut constituer pour les enfants une injustifiable réduction des droits à l’égalité garantis par la Charte des droits et libertés.[175]
De toute façon, les restrictions au logement pour des enfants qui ont pour effet de restreindre l’accès au logement pour leurs parents peuvent constituer de la discrimination fondée sur l’état familial. Par exemple, la désignation de commodités de logement en « mode de vie pour adultes » exclurait de fait les familles, en plus des mineurs. Par conséquent, ce type de restriction serait traité comme de la discrimination fondée sur l’état de famille. Il ne faudrait pas se servir de restrictions abusives sur l’âge pour appuyer de simples préférences pour des milieux « sans enfants ».
Les jeunes personnes âgées de plus de dix-huit ans peuvent subir des formes particulières d’inconvénients sur le marché du logement locatif. Par exemple, les ratios indexés sur le revenu peuvent avoir un effet défavorable sur ce groupe de locataires en raison de leurs revenus habituellement faibles. Dans Sinclair c. Morris A. Hunter Investments Ltd.[176] , une commission d’enquête de l’Ontario a jugé que les plaignants avaient été victimes de discrimination lorsqu’on leur a refusé de louer un appartement parce qu’ils ne pouvaient respecter un coefficient indexé au loyer de 33 pour cent. La commission a accepté la preuve d’expert que les coefficients indexés au loyer causent de la discrimination contre des demandeurs de loyer, au moins jusqu’à l’âge de la mi-vingtaine. La Commission a également conclu que les politiques de location exigeant que les demandeurs aient des emplois permanents et un mandat d’une durée minimum chez un employeur constituent de la discrimination fondée sur l’âge, étant donné que l’emploi chez les jeunes est plus instable et de plus courte durée que chez les adultes plus âgés.[177]
Les jeunes personnes peuvent aussi faire l’objet de stéréotypes négatifs. Par exemple, il y a eu des cas qui ont traité des stéréotypes négatifs portant sur les adolescents. Dans Bushek c. Registered Owners of Lot SL 1, une plainte voulant qu’une famille ait été forcée de quitter son appartement parce qu’elle comptait deux adolescents, a finalement été rejetée. Le tribunal a toutefois exprimé des réserves au sujet des attitudes négatives envers les adolescents manifestées par l’administration de l’immeuble :
Une partie de la preuve donnait à penser qu’en tentant d’équilibrer les intérêts de ses résidants, le conseil local ne s’est pas suffisamment préoccupé des intérêts des adolescents. Bien qu’il était possible aux adolescents de se servir des équipements et de participer aux événements, les problèmes de sécurité semblent avoir jeté l’ombre d’un doute sur eux. La suggestion qu’ils rebutent des acheteurs éventuels et indisposent les personnes âgées serait tout naturellement offensante. Bien que ces commentaires peuvent avoir découlé de véritables problèmes que l’immeuble a subis avec certains adolescents, ils révèlent le type de stéréotypes que les lois en matière de droits de la personne cherchent à prévenir.[178]
Les aînés aussi sont confrontés à des défis particuliers sur le marché du logement locatif. Les personnes âgées, surtout les femmes, courent un risque élevé de se retrouver en besoin impérieux de logement. En 2001, par exemple, 57,5 pour cent des femmes âgées qui vivaient seules dans les régions métropolitaines de recensement au Canada étaient en besoin impérieux de logement. Parmi les hommes âgés qui vivaient seuls, 44,6 pour cent étaient en besoin impérieux de logement. Une des principales raisons à cette situation est la fréquence élevée de très faibles revenus dans ces groupes de rentiers. Dans de nombreux cas, les aînés sont sans emploi, employés à temps partiel ou complètement à l’écart de la population active. En outre, un grand nombre de personnes dans ces groupes dépendront du gouvernement pour la plus grande partie de leur revenu de ménage. La principale source de revenus pour plus de 90 pour cent de ces ménages était constituée par les transferts gouvernementaux. La moyenne des revenus avant impôt de ces personnes était inférieure à 15 000 $, dont presque la moitié constituaient des dépenses de logement.[179]
Le Code interdit la discrimination en matière de logement, qu’elle soit directe ou fasse suite à un effet défavorable.[180] Par exemple, un fournisseur de logements ne devrait pas refuser des personnes âgées au motif qu’il désire attirer des résidants plus jeunes. Dans un même ordre d’idées, les locateurs désireux d’attirer de nouveaux locataires qui payent un loyer plus élevé ne devraient pas tenter d’expulser les personnes âgées qui paient un loyer moindre en raison de leur ancienneté dans leur unité locative.
Pour les personnes âgées, le logement est un élément essentiel de la qualité de vie. Pour conserver leur autonomie et leur bien-être, les personnes âgées ont besoin d’un logement sûr, abordable, accessible et adaptable, qui leur offre un maximum de liberté et la possibilité de conserver leur mode de vie. Les changements physiques normaux que subissent les personnes vieillissantes et les maladies ou incapacités qui affectent certaines personnes âgées ont des répercussions sur le logement. Au moment de concevoir et de construire des logements pour des personnes âgées, il faudrait avoir pour objectif un environnement sans obstacle, tout en reconnaissant que ceux-ci sont à la fois physiques et psychologiques. Cette approche permettrait à ceux qui souffrent d’une invalidité plus ou moins grave de continuer à accomplir les activités quotidiennes.
La Commission a reconnu le fait que les projets d’habitation conçus pour les personnes âgées leur permettent de bénéficier du soutien, de la communauté et de la sécurité qui y sont offerts, de même que l’importance du « vieillissement chez soi ». Les logements pour personnes âgées comprennent un éventail d’options comprenant le logement locatif, les logements en copropriété, les maisons de retraite et les centres de santé. Certains logements et services peuvent se chevaucher, par exemple, des résidences pour personnes âgées dans lesquelles les services tels que l’entretien ménager, les repas ou l’assistance médicale sont fournis.
Il y a des situations où les logements qui visent à satisfaire les besoins des aînés ontariens favorisent les objectifs du Code. L’article 15 du Code permet d’accorder un traitement préférentiel aux personnes âgées d’au moins 65 ans, et de ce fait autorise les habitations réservées aux personnes âgées de plus de 64 ans. L’article 14 du Code autorise les programmes spéciaux qui atténuent un préjudice et un désavantage, tels que des projets d’habitation à accès facile spécialement conçus et destinés aux personnes âgées qui ont des déficiences. L’article 18 crée une exception pour un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts des personnes âgées et qui, parmi les services offerts, fournit le logement.
Les personnes âgées peuvent avoir besoin d’aménagements particuliers pour pouvoir jouir de leur logement autant que les autres résidants. Un fournisseur de logements a l’obligation de répondre aux besoins et capacités des résidants âgés, sous réserve de la norme de difficultés excessives. Les aménagements peuvent comprendre des modifications à un logement locatif, à l’entrée de l’immeuble, aux trottoirs, au stationnement et aux aires communes. Il peut s’agir de modifications physiques telles que l’installation d’ascenseurs, de rampes, d’alarmes à incendie visuelles, de sonnettes de porte adaptées aux malentendants, de poignées de porte différentes, de comptoirs abaissés, etc. Il peut aussi être nécessaire de procéder à d’autres formes d’aménagements, comme une dispense ou le changement à une règle, améliorer l’entretien par un déneigement plus fréquent ou le fait de permettre le transfert dans un autre logement sans pénalité. Par exemple, au cours de sa consultation sur la discrimination fondée sur l’âge, la Commission s’est fait dire que les gens âgés qui deviennent veufs sont confrontés à un préjudice particulier sous la forme d’une importante augmentation de loyer lorsqu’ils tentent de déménager dans un logement plus petit qu’il leur est plus facile d’entretenir. Un accommodement possible à cette situation peut être de faciliter le transfert dans un autre logement de l’immeuble sans traiter la situation comme une nouvelle location à laquelle s’appliquerait un loyer plus élevé.
Le handicap
En matière de logement, le Code interdit la discrimination fondée sur le handicap. Le paragraphe 10(1) du Code donne une définition large du handicap de façon à inclure tout trouble mental, incapacité physique, difficulté d’apprentissage, déficience intellectuelle ou toute lésion ou incapacité pour lesquels des prestations ont été demandées dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.[181] Le paragraphe 10(3) prévoit également une protection contre la discrimination envers les personnes qui ont eu un handicap et celles qui sont présumées avoir ou avoir eu un handicap.
Les personnes handicapées peuvent éprouver de nombreuses difficultés en société. Des soutiens sociaux inadéquats, une aide financière insuffisante et l’absence de mécanismes appropriés pour faciliter la désinstitutionnalisation contribuent tous aux difficultés auxquelles plusieurs font face dans leur quête d’autonomie. Ces défis sont souvent aggravés par les nombreux obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées lorsqu’elles tentent d’accéder à un logement locatif.
Ces obstacles peuvent prendre plusieurs formes et comprennent souvent des refus catégoriques de location. Par exemple, dans Yale c. Metropoulos[182], une commission d’enquête de l’Ontario a décidé que les défendeurs avaient volontairement et de façon irresponsable exercé de la discrimination contre la plaignante, une personne aveugle, lorsque sans l’en aviser, ils ont annulé la visite d’un appartement, ont ensuite refusé de la laisser entrer dans le logement et l’ont généralement traitée sans ménagement. La commission a conclu qu’un locateur ou un régisseur contrevient au Code s’il refuse de montrer un appartement à un locataire éventuel affligé d’un handicap visuel et omet de fournir une explication raisonnable à ce sujet.
Les immeubles inaccessibles et la conception d’habitations non inclusives font partie des obstacles auxquels les personnes handicapées font face régulièrement. Les fournisseurs de logements ont l’obligation de répondre aux besoins des locataires handicapés s’ils n'imposent pas une contrainte excessive. Les aménagements peuvent comprendre des modifications physiques telles que l’installation de rampes et d’ascenseurs, d’alarmes à incendie visuelles, de sonnettes de porte adaptées aux malentendants, de poignées de porte différentes, de comptoirs abaissés, etc. D’autres formes d’aménagements peuvent aussi s’avérer nécessaires, comme la dispense ou le changement d’une règle, le fait par exemple, d’autoriser les chiens-guides dans un immeuble qui a une politique d’« animaux de compagnie interdits ».[183] Pour les fournisseurs de logement, le retard à fournir une adaptation peut également constituer une contravention au Code.
Souvent, il n’est ni difficile ni une contrainte importante pour un fournisseur de logements de procurer les aménagements nécessaires. Dans Julie Ramsey c. S.W.M. Investments[184], un locataire a allégué la discrimination fondée sur le handicap en raison du défaut par le locateur de consacrer un stationnement « pour handicapés ». En vertu d’un règlement à l’amiable, le locateur a convenu de fournir deux espaces de stationnement réservés pour les locataires, un espace désigné pour les visiteurs et d’autres espaces désignés pour les locataires suivant les besoins, de sorte que chaque locataire y ayant droit aurait un espace à sa disposition. Le locateur a également convenu d’entretenir les espaces de stationnement par l’enlèvement de la neige et l’épandage de sable ou de sel sur les stationnements et le chemin menant à la porte de l’immeuble.
La Loi de 1992 sur le code du bâtiment de l’Ontario[185] régit la construction de nouveaux immeubles et la rénovation et l’entretien des immeubles existants. La commission s’est dite préoccupée du fait que les exigences relatives à l’accessibilité énoncées au Code du bâtiment ne se traduisent pas toujours par un accès égal pour les personnes handicapées comme l’exige le Code des droits de la personne.[186] De nombreux fournisseurs de logements continuent de se fier seulement aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario, sans tenir compte de leurs obligations relatives au Code des droits de la personne. Cependant, le Code des droits de la personne a prévalence sur le Code du bâtiment et les fournisseurs de logement peuvent s’exposer à des plaintes aux droits de la personne dans la mesure où leurs établissements continuent de ne pas répondre aux exigences du Code des droits de la personne. Le fait de s’appuyer sur les codes du bâtiment pertinents a été clairement rejeté comme moyen de défense à une plainte en discrimination en vertu du Code des droits de la personne.[187]
La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario[188] prévoit un mécanisme pour élaborer, mettre en oeuvre et faire exécuter des normes d’accessibilité, afin de fournir avant le 1er janvier 2025 aux personnes handicapées de l’Ontario l’entière accessibilité aux biens, services, équipements, logements, emplois, édifices, structures et établissements. Il importe de souligner qu’en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, on exigera des fournisseurs qu’ils appliquent aux logements les normes d’accessibilité pour personnes handicapées.
Les personnes handicapées peuvent être victimes de harcèlement de la part des fournisseurs de logements, de colocataires et d’autres personnes. Par exemple, dans Aquilina c. Pokoj[189], une commission d’enquête de l’Ontario a conclu que le locateur défendeur avait adopté une ligne de conduite vexatoire, afin de contrôler la vie de la plaignante, une dame affligée d’infirmité motrice cérébrale, tant comme locataire que comme personne. Dans cette affaire, on a aussi jugé que le défendeur avait proféré des insultes au sujet du handicap de la plaignante.
Les personnes qui ont un handicap mental sont souvent confrontées à des difficultés particulières sur le marché du logement locatif en raison d’attitudes négatives et de stéréotypes. Dans Weiher c. Polhill[190], dès qu’il a eu connaissance de son handicap mental, le locateur et défendeur a imposé à la plaignante des règles précises qui n’ont été imposées à personne d’autre. Ayant l’impression que le défendeur ne voulait pas d’elle à cet endroit, la plaignante n’a pas emménagé. Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a conclu qu’il y avait eu discrimination fondée sur le handicap mental de la plaignante et a accordé une indemnisation.
Les personnes qui ont des maladies psychiatriques passées ou actuelles continuent de subir une marginalisation et une discrimination extrêmes dans la plupart des sphères sociales, dont la location d’un logement.[191] Lors d’une vérification téléphonique menée dans les villes de Windsor et London en Ontario, et Détroit au Michigan au cours des années 1990, on a fait 160 appels téléphoniques, où la moitié des appelants ont formulé de simples demandes de renseignements au sujet des logements disponibles, et l’autre moitié a formulé des demandes similaires, mais en se faisant un devoir de révéler le fait qu’ils recherchaient alors un traitement psychiatrique, mais auraient bientôt besoin d’un logement. À ce dernier groupe, les locateurs avaient nettement plus tendance à affirmer que les logements n’étaient plus disponibles.[192] Le formidable ostracisme dont les personnes qui ont un handicap mental font l’objet sur le marché du logement locatif peut conduire à l’itinérance, comme c’est souvent le cas.
L’état d’assisté social
Une des façons dont les personnes qui vivent dans la pauvreté sont victimes de discrimination sur le marché du logement locatif est la discrimination fondée sur l’état d’assisté social. Malgré le fait que le Code interdise aux fournisseurs de logements de refuser une location à un ménage qui est prestataire d’aide sociale, la Commission a reçu de nombreuses informations indiquant que cette attitude reste une pratique répandue en Ontario, et des personnes continuent de porter plainte pour ce motif.
Pendant leur occupation d’un logement, les prestataires d’aide sociale sont souvent soumis à un traitement différencié et des exigences relatives à la location qui ne sont pas imposées aux autres locataires. Par exemple, on peut leur demander de faire verser directement les chèques gouvernementaux en paiement, en exiger des dépôts de loyer démesurés et souvent illégaux ou leur faire subir un interrogatoire importun qui viole leur vie privée et porte atteinte à leur dignité. De même, l’exigence par un fournisseur de logement de verser le premier et le dernier mois du loyer peut constituer une discrimination indirecte contre les prestataires d’aide sociale ainsi que les autres membres de groupes défavorisés protégés par le Code, qui ont souvent des revenus inférieurs et seront fréquemment incapables de dégager de telles ressources.
Les bénéficiaires d’aide publique portent souvent le poids des attitudes négatives et des stéréotypes. Dans Iness c. Caroline Co-operative Homes Inc.[193], une affaire qui traitait de discrimination en matière de logement et fondée sur l’état d’assisté social, la Dre Janet Mosher a été appelée comme témoin expert en discrimination contre les bénéficiaires d’aide sociale. Elle a témoigné du fait que le stéréotype le plus courant au sujet des personnes qui bénéficient d’aide publique est qu’ils ont un manque d’éthique de travail. Elle a aussi déclaré qu’il existe une opinion courante voulant que l’état d’assisté social soit associé à un comportement criminel. Elle a ajouté que les prestataires d’aide sociale sont fréquemment décrits comme des « fraudeurs » qui sont « paresseux, parasitaires et irresponsables », et comme des individus qui ont des « faiblesses personnelles, mais pas la vertu nécessaire ». Dans le cas des mères monoparentales qui reçoivent de l’aide sociale, elle a affirmé qu’elles sont souvent perçues comme des « vagabondeuses sexuelles » et comme ayant constitué une « famille déviante, ce qui est inapproprié comparativement aux familles biparentales ».[194] Comme il a été souligné précédemment, la Cour d’appel de l’Ontario aussi a reconnu les attitudes et stéréotypes particulièrement sévères que subissent régulièrement les mères monoparentales qui reçoivent de l’aide publique.[195] En raison de ce stigmate négatif, un bon nombre de celles qui dépendent de l’aide publique s’efforceront beaucoup de cacher leur état.
La discrimination fondée sur l’état d’assisté social a fait l’objet d’un bon nombre de litiges au Canada. De nombreuses affaires traitent de situations où le logement locatif a été carrément refusé. Par exemple, dans Willis c. David Anthony Philips Properties[196], une commission d’enquête de l’Ontario a conclu que le propriétaire avait dit à la plaignante qu’il ne voulait pas lui louer parce qu’elle était prestataire d’aide sociale. La commission a conclu qu’une discrimination illicite avait été exercée. Dans une affaire de 1995, Kostanowicz c. Zarubin[197], une mère monoparentale qui recevait de l’aide sociale s’est également vue refuser un appartement. La commission a jugé que le défendeur avait violé le Code en ne louant pas à la plaignante. Dans une affaire survenue au Québec, Drouin c. Wittan et Lavalee[198], un locateur a refusé de louer à la plaignante parce qu’elle était pauvre et sa source de revenus était l’aide sociale, sans tenir compte du fait si elle était ou non une locataire fiable. En fait, le locateur a expliqué que les pauvres ne sont pas capables de payer leur loyer. Le tribunal a jugé que les exclusions fondées sur de faibles revenus pouvaient constituer de la discrimination indirecte contre les familles monoparentales, et que les défendeurs avaient violé la Charte québécoise. Dans une autre affaire survenue au Québec, Laurente c. Gauthier[199], la commission a jugé que le défendeur avait pour politique de ne pas louer à des bénéficiaires d’aide sociale, indépendamment de leur capacité à payer le loyer. Le tribunal a conclu que les défendeurs avaient exercé de la discrimination fondée sur la condition sociale.
Il y a d’autres affaires concernant des personnes qui ont subi un traitement différencié pendant leur occupation d’un logement en raison de leur état d’assisté social. L’affaire Québec (Comm. des droits de la personne) c. Coutu[200] est digne de mention parce que dans cette affaire, le tribunal québécois a accordé aux plaignants, des résidants d’une maison de soins infirmiers privée, plus de 2 millions de dollars en dommages-intérêts généraux et spéciaux. Le tribunal a jugé que M. Coutu, l’administrateur de la maison de soins infirmiers, avait violé les droits économiques, physiques, psychologiques et moraux des résidants qui étaient tous des personnes handicapées prestataires d’aide sociale. Les allocations mensuelles d’aide sociale de résidants avaient été détournées, et des résidants payaient un prix excessif pour des services et achats tels qu’une coupe de cheveux, des vêtements, des articles d’hygiène personnelle et des activités de loisir. Des résidants étaient forcés de travailler dans l’établissement sans rémunération. Le personnel n’était pas qualifié, il agressait verbalement et humiliait les résidants, et les traitait de manières qui ne respectaient pas leur dignité et leur vie privée.
Il y a encore d’autres affaires qui traitent de l’effet négatif de politiques relatives au logement locatif et d’exigences envers les personnes qui reçoivent de l’aide sociale. Par exemple, dans Garbett c. Fisher[201], une commission d’enquête de l’Ontario a conclu que le fait de demander le montant du loyer du dernier mois du bail constitue de la discrimination indirecte contre les bénéficiaires d’aide sociale parce qu’ils ne reçoivent pas leur argent d’avance. Une affaire survenue en Colombie-Britannique, Larson c. Graham, en est arrivée à une conclusion semblable.[202]
Des niveaux d'aide sociale inadéquats
On a exprimé à la Commission de nombreuses appréhensions que le niveau d’aide financière offerte par le gouvernement de l’Ontario aux bénéficiaires d’aide sociale est trop bas et suscite de la discrimination indirecte en matière de logement. Des personnes ont allégué qu’on leur refuse un traitement égal dans leurs tentatives de se loger avec leurs enfants, en raison de leur revenu insuffisant. Ils ont ajouté que les niveaux d’aide sociale fixés par la province ont causé l’exclusion des grandes familles du marché du logement locatif.
Chaque mois, en plus d’une allocation de base, les bénéficiaires du programme d’aide sociale d’Ontario au travail reçoivent une allocation au logement. En janvier 2007, l’allocation mensuelle de logement fournie par Ontario au travail oscillait entre 342 $ pour un ménage d’une personne à 708 $ pour un ménage à six ou plus.[203] Comme on le sait généralement, ces montants sont bien moindres que le prix moyen d’un loyer en Ontario, surtout dans les villes, et la différence entre ces montants crée un « déficit du logement ».[204] Pour être en mesure de payer un loyer ou une hypothèque sur une résidence, des familles doivent souvent combiner leur allocation de base à leur allocation au logement. Toutefois, malgré ces efforts, de nombreux ménages finissent par se retrouver en besoin impérieux de logement.
Fréquence des besoins impérieux de logement chez les locataires dans les grands |
|||
Le déficit du logement est particulièrement prononcé pour les parents uniques soutiens de famille qui n’ont qu’un seul revenu pour élever leur famille. Par exemple, en 2003, l’allocation mensuelle maximale pour un parent unique ayant deux enfants âgés de moins de douze ans était de 1086 $ (554 $ en allocation de logement et 532 $ en allocation de base). Si cette famille avait loué un appartement de deux chambres à Toronto, après avoir payé le loyer, il lui resterait environ 31 $ pour faire face à tous les autres besoins du mois.[206] Parce que le loyer accapare la majeure partie de l’aide reçue, de nombreuses familles soutenues par un seul parent se tournent vers les banques d’aide alimentaire pour joindre les deux bouts. Le fardeau de devoir prendre ces moyens chaque mois peut aussi nuire à leur capacité de trouver un emploi ou de participer aux activités d’emploi du programme Ontario au travail.
En septembre 2006, plus de 50 pour cent des bénéficiaires d’Ontario au travail étaient membres de familles monoparentales.[207] Pour ces bénéficiaires et pour d’autres ménages qui reçoivent de l’aide sociale, les très faibles allocations de logement les placent dans la situation intenable de devoir choisir entre le logement et les autres besoins essentiels.[208] Dans plusieurs régions de la province, le marché privé de la location n’offre tout simplement pas de logements locatifs convenables pour les familles, dont le loyer soit dans les limites de l’allocation de logement. Cette situation peut faire en sorte que des familles se retrouvent sans-abri, comme il arrive déjà.
Des organismes chargés des traités internationaux sur les droits de la personne ont formulé de sérieuses critiques à l’égard du Canada au sujet de l’accroissement de la pauvreté et du manque d’accès au logement chez les mères monoparentales et les autres femmes. Par exemple, dans ses Observations finales de mars 2003, le Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a déploré sérieusement le pourcentage élevé de femmes vivant dans la pauvreté, surtout les femmes âgées vivant seules, les femmes monoparentales, les femmes autochtones, les femmes âgées, les femmes de couleur, les immigrantes et les femmes handicapées, pour lesquelles la pauvreté persiste ou même s’aggrave, en raison des ajustements budgétaires effectués depuis 1995 et des compressions dans les services sociaux qu’ils ont provoquées. Le Comité a proposé que le gouvernement évalue les répercussions des mesures antipauvreté sur le genre et accroisse ses efforts de lutte contre la pauvreté parmi les femmes en général, et les groupes de femmes vulnérables en particulier.[209]
[88] Le concept « d’intersectionnalité » a été défini comme étant « une oppression intersectionnelle qui naît de la combinaison de plusieurs types d’oppressions qui ensemble produisent une situation unique et distincte de toute autre forme de discrimination... » M. Eaton, « Patently Confused, Complex Inequality and Canada c. Mosso » (1994) 1 Rev. Cons. Stud. 203, p. 229.
[89] Commission ontarienne des droits de la personne, An Intersectional Approach to Discrimination: Addressing Multiple Grounds in Human Rights Claims (Toronto, Imprimeur de la Reine, 2001), [En ligne]. [www.ohrc.on.ca].
[90] La racialisation est un processus au cours duquel les sociétés construisent les races comme étant réelles, différentes et inégales et de façons qui importent dans la vie économique, politique et sociale. On préfère généralement ce terme aux descriptions telles que « minorité raciale », « minorité visible » ou « personne de couleur » parce qu’il exprime la race en tant que construction sociale plutôt qu’une description de personnes basée sur des caractéristiques perceptibles. Voir la Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et Directives sur le Racisme et la Discrimination Raciale (Toronto, Imprimeur de la Reine, 2005), [En ligne]. [ http://ohrc.on.ca/french/publications/racism-and-racial-discrimination-…] [ci-après politique de discrimination raciale].
[91] Richards c. Waisglass (1994), 24 C.H.R.R. D/51 (Com. enq. Ont.).
[92] Voir aussi Watson c. Antunes (1998), CHRR Doc. 98-063 (Com. enq. Ont.) où la commission d’enquête a jugé que l’intimé faisait preuve de discrimination envers les plaignants, une femme noire qui désirait louer un appartement et sa mère. L’intimé leur a montré l’appartement à contrecœur, puis a menti à la mère lorsque celle-ci a rappelé pour le louer en lui disant que l’appartement était déjà loué. Voir également Baldwin c. Soobiah (1983), 4 C.H.R.R. D/1890 (Com. enq. Ont.) où une commission d’enquête a jugé un cas apparemment fondé de discrimination en matière de logement locatif lorsque l’intimé a dit à des locataires potentiels d’une certaine race que la propriété était louée, puis a dit à des locataires potentiels d’une autre race que l’appartement était toujours à louer. Autrement dit, les refus de la part du propriétaire de louer l’appartement à des personnes appartenant à un groupe ethnique distinct ont été jugés comme étant la preuve d’une discrimination illégale.
[93] Les cours américaines acceptent généralement les données des enquêtes de vérification comme des preuves solides de discrimination raciale. Veuillez voir Massey, D.S. and Lundy, G. « Use of Black English and Racial Discrimination in Urban Housing Markets » (mars 2001), Urban Affairs Review no 36(4), p. 452 et 454.
[94] Dion, K.L. « Perceptions of Housing Discrimination in Toronto: The Housing New Canadians Project » (2001), Journal of Social Issues no 57, p. 523 et 527.
[95] On a défini le « profilage linguistique » comme étant « la détermination de caractéristiques telles que le statut socio-économique à partir de la façon dont une personne utilise le langage ». Voir [http://www.wordspy.com/words/linguisticprofiling.asp] (date de consultation : 3 janvier 2007).
[96] Massey & Lundy, supra note 93 p. 466-7.
[97] Voir à titre d’exemple, Dion, supra note 94 p. 528.
[98] On peut décrire « l’islamophobie » comme le fait d’appliquer des stéréotypes, de faire preuve de partialité ou de commettre des actes hostiles envers des personnes musulmanes ou des fervents de l’islam en général. En plus d’actes individuels d’intolérence ou de profilage racial, l’islamophobie mène à percevoir les musulmans comme étant une grande menace pour la sécurité sur les plans institutionnel, systémique et social. Voir la politique de discrimination de la Commission, supra note 90.
[99] Ontario (Human Rights Comm.) c. Elieff (1996), 37 C.H.R.R. D/248 (Cour de l’Ont. [Div. rég.]), rev’g in part (1994), 25 C.H.R.R. D/163 (Com. enq. de l’Ont.).
[100] Fancy c. J & M Apartments Ltd. (1991), 14 C.H.R.R. D/389 (B.C.C.H.R.).
[101] Chauhan c. Norkam Seniors Housing Cooperative Association (2004), 51 C.H.R.R. D/126, 2004 BCHRT 262.
[102] King c. Bura (2004), 50 C.H.R.R. D/213, 2004 HRTO 9.
[103] D’autres exemples de harcèlement racial dans le domaine des commodités de logement : Morrison c. Effort Trust Realty Co. (1993), 26 C.H.R.R. D/119 (Com. enq. de l’Ont.) et
Fuller c. Daoud (2001), 40 C.H.R.R. D/306 (Com. enq. de l’Ont.).
[104] Comme mentionné précédemment, l’article 12 du Code offre une protection contre la discrimination basée sur l’association avec des personnes identifiées par les motifs énumérés par le Code et permet aux personnes de bénéficier d’un recours quand leur droit a été violé.
[105] John c. Johnstone, (16 septembre 1977), No 82, Eberts (Com. enq. de l’Ont.).
[106] Hill c. Misener (No. 1) (1997), 28 C.H.R.R. D/355 (N.S. Bd. Inq.).
[107] Klos, N.« Aboriginal Peoples and Homelessness: Interviews with Service Providers » (1997) Canadian Journal of Urban Research, no 6(1), p. 40-48.
[108] Flamand c. DGN Investments (2005), 52 C.H.R.R. D/142 (HRTO).
[109] Ibid. au paragraphe 137.
[110] Engeland, Lewis, Ehrlich & Che, supra note 13 p. 49.
[111] Ibid. p. 50.
[112] Chisholm, supra note 1 p. 19.
[113] Grant, M.R. & Danso, R.K. « Access to Housing as an Adaptive Strategy for Immigrant Groups: Africans in Calgary » (2000), Canadian Ethnic Studies, no 32(3) p. 19.
[114] Rental Market Report: Toronto CMA, supra note 7 p. 3.
[115] Barahona, F. « Immigrants hit with ’illegal' rents: Landlord demands up to year's rent from newcomers », Toronto Star (29 juillet 2001); « Forum hears of discrimination in housing: Would-be tenants say they were victims of racism » Toronto Star (21 mars 2002).
[116] Le Code et le Règlement 290/98 permettent aux propriétaires de demander des renseignements sur les antécédents en matière de location d’un possible locataire. Cependant, d’après la décision dans Ahmed c. 177061 Canada Ltd. (2002), 43 C.H.R.R. D/379 (Com. enq. de l’Ont.), considérer l’inexistence d’antécédents en matière de location comme un antécédent négatif est un acte discriminatoire où le manque d’antécédent en matière de location est un motif énuméré par le Code.
[117] Grant & Danso, supra note 113.
[118] Engeland, Lewis, Ehrlich & Che, supra note 13 p. 20.
[119] Ibid. p. 52.
[120] Ibid. p. 53.
[121] Ibid. p. 50-51.
[122] Women and Housing in Canada: Barriers to Equality, supra note 34 p. 8.
[123] Conway c. Koslowski (1993), 19 C.H.R.R. D/253 (Com. enq. de l’Ont).
[124] Leong c. Cerezin (1992), 19 C.H.R.R. D/381 (B.C.C.H.R.). L’intimé s’est également plaint de l’origine sino-canadienne du plaignant.
[125] Women and Housing in Canada: Barriers to Equality, supra note 34 p. 8.
[126] Carter, T. & Polevychok, C. Housing is Good Social Policy (Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, 2004), p. 8.
[127] Le 20 février 2002. Les recommendations sont en ligne à :
[www.owjn.org/issues/w-abuse/hadley2.htm].
[128] On discutera plus en détail de la discrimination basée sur la situation de famille à la section intitulée L’état familial de ce document.
[129] Turanski c. Fifth Avenue Apartments (1986), 7 C.H.R.R. D/3388 (B.C.C.H.R.).
[130] Statistics Canada, Women in Canada 2000: A Gender-based Statistical Report (Catalogue No 89-503-XPE), p. 138.
[131] Ibid. p. 139.
[132] Women and Housing in Canada: Barriers to Equality, supra note 34 p. 11.
[133] Raphaël c. Conseil Des Montagnais du Lac Saint-Jean, (1995) 23 C.H.R.R. D/259 (C.H.R.T.).
[134] Mann, M.M. Les femmes autochtones : Un document d'information sur les problèmes (préparé pour Condition féminine Canada, août 2005), [En ligne]. [http://www.cfc-swc.gc.ca/resources/consultations/ges09-2005/aboriginal_…] (date de consultation : 30 mars 2007). Un processus de consultation national sur la division des biens matrimoniaux dans les réserves a été lancé en septembre 2006. Voir le communiqué de presse d’Affaires indiennes et du Nord Canada : Enjeu de la division des biens matrimoniaux dans les réserves : le Canada, l’APN et l’AFAC vont de l’avant avec des consultations (29 septembre 2006).
[135] Women and Housing in Canada: Barriers to Equality, supra note 34 p. 10-11.
[136] National Working Group on Women and Housing, Some Facts on Women and Housing in Canada, [En ligne]. [http://www.equalityrights.org/NWG/facts.htm] (date de consultation : 30 août 2006).
[137] Voir Novac, Darden, Hulchanski & Seguin, supra note 48 p. 3.
[138] Reed c. Cattolica Investments Ltd. (1996), 30 C.H.R.R. D/331 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[139] Novac, S. « Sexual Harassment of Women Tenants » (1990) Canadian Women’s Studies, no 11, p. 2 à 58.
[140] [1995] 2 R.C.S. 418, paragr. 72, L’Heureux-Dubé J.
[141] Vander Schaaf c. M & R Property Management Ltd. (2000), 38 C.H.R.R. D/251 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[142] Pour d’autres exemples canadiens de discrimination fondée sur la situation de famille, voir les causes suivantes : Swaenepoel c. Henry (1985), 6 C.H.R.R. D/3045 (Man. Bd. Adj.) : une commission a jugé que les plaignantes, un groupe de trois femmes célibataires, avaient fait l’objet de discrimination de la part des intimés qui avaient manifesté des préjugés à l’égard de colocataires célibataires de même sexe ne correspondant pas au modèle de la famille nucléaire; Gurman c. Greenleaf Meadows Investment Ltd (1982), C.H.R.R. D/808 (Man. Bd. Adj.) : une commission a jugé qu’un intimé avait fait preuve de discrimination envers les plaignants, deux sœurs et un frère, parce qu’ils constituaient un groupe d’adultes célibataires de sexe différent; Wry c. Cavan Realty (C.R.) Inc. (1989), 10 C.H.R.R. D/5951 (B.C.C.H.R.) : le British Columbia Council (le conseil des droits de la personne de la Colombie-Britannique) a jugé que le plaignant (un homme célibataire) avait été victime de discrimination parce que l’intimé ne voulait louer qu’à des familles et à des couples mariés. Le conseil a estimé que cela constituait une discrimination fondée sur le sexe et la situation familiale.
[143] Booker c. Floriri Village Investments Inc. (1989), 11 C.H.R.R. D/44 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[144] Raweater c. MacDonald, (2004), 51 C.H.R.R. D/459, 2005 BCHRT 63.
[145] Falkiner c. Ontario (ministère des Services sociaux et communautaires) (2002), 59 O.R. (3d) 481 (C.A.). Cette décision, rendue en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, a annulé la définition de « conjoint » contenue dans la Loi sur les prestations familiales, laquelle établissait qu’il y avait relation maritale dès le moment où un homme et une femme commençaient à vivre ensemble. Cette définition avait pour conséquence de priver de nombreuses personnes, en particulier des femmes bénéficiaires de l’aide sociale, de leur droit à des prestations. Le tribunal a estimé que la décision entraînait une discrimination fondée sur le sexe, la situation familiale et le statut de bénéficiaire de l’aide sociale.
[146] Dans une cause fédérale, Schaap c. Canada (forces armées) (1988), 12 C.H.R.R. D/451 (CAF), la Cour d’appel a jugé que le Tribunal canadien des droits de la personne avait commis une erreur de droit en statuant que les protections contre la discrimination fondée sur la situation familiale ne protègent pas les conjoints de fait.
[147] Matyson c. Provost (1987), 9 C.H.R.R. D/4623 (Com. d’enq. de la Sask.).
[148] Société canadienne d’hypothèques et de logement, Série sur le logement selon les données du recensement de 2001. Le point en recherche - Série socio-économique 4-002 (Ottawa, 2004). Au Canada, on considère qu’un ménage est en situation de besoins impérieux : s’il consacre au moins 30 % de son revenu avant impôt aux paiements d’hypothèque, aux taxes et impôts, aux charges de service public et aux loyers; si le logement a besoin de réparations importantes; ou si les parents et les enfants ou des enfants de sexe différent de plus de cinq ans, partagent la même chambre à coucher.
[149] Report of the Mayor’s Homelessness Action Task Force, supra note 19.
[150] Carter & Polevychok, supra note 126 à 15.
[151] Société canadienne d’hypothèques et de logement, Le logement des enfants au Canada (2000).
[152] Chau, S. et al., One in Five ... Housing as a Factor in the Admission of Children to Care (Centre for Urban and Community Studies, Toronto, novembre 2001).
[153] Women and Housing in Canada: Barriers to Equality, supra note 34.
[154] Report of the Mayor’s Homelessness Action Task Force, supra note 19.
[155] Voir Zukewich, N. « Soins informels non rémunérés » (automne 2003), Tendances sociales canadiennes, no 70, p. 14, [En ligne].
[http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/Statcan/11-008-XIE/0020311-008-…].
[156] Khosla, P. If Low Income Women of Colour Counted in Toronto (Community Social Planning Council of Toronto, Toronto, 2003), p. 23 et suivantes, [En ligne]. [http://www.socialplanningtoronto.org/Research%20&%20Policy%20Updates/Lo…].
[157] Fakhoury c. Las Brisas Ltd. (1987), 8 C.H.R.R. D/4028 (Com. d’enq. de l’Ont.). Cette cause est aussi importante en raison de son examen express des débats de politiques publiques et des documents internationaux relatifs aux droits de la personne, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme.
[158] Par exemple, dans Thurston c. Lu (1993), 23 C.H.R.R. D/253 (Com. d’enq. de l’Ont.), un tribunal a jugé que le fait de refuser à une femme le droit de présenter une demande pour un appartement et de lui opposer un refus catégorique parce qu’elle a un enfant constituait une discrimination prima facie. Dans la cause Cunanan c. Boolean Developments Ltd. (2003), 47 C.H.R.R. D/236, 2003 TDPO 17, un tribunal a jugé qu’il y avait violation du Code, le locateur ayant refusé de louer à la plaignante parce que la famille de celle-ci, qui comprenait trois adolescents, n’avait pas la taille « idéale » selon les « normes » canadiennes et, par conséquent, ne faisait pas l’affaire. Dans la cause Peterson c. Anderson (1991), 15 C.H.R.R. D/1 (Com. d’enq. de l’Ont.), un tribunal a jugé que l’éviction d’une locataire enceinte constituait une discrimination fondée sur la situation familiale ainsi que sur le sexe. Le tribunal a constaté des éléments de preuve de stéréotypes et de préjugés concernant la situation de parent seul et les relations conjugales hors mariage, et cela même s’il n’existait aucune restriction d’ordre général concernant les enfants dans l’immeuble.
[159] Fakhoury c. Las Brisas Ltd., supra note 157. Cette cause portait notamment sur une politique selon laquelle une famille de quatre personnes, composée d’un parent et de trois enfants, était obligée de louer un appartement d’au moins trois chambres à coucher. Le tribunal a jugé que cette inégalité de traitement n’avait aucune justification raisonnable.
[160] Booker c. Floriri Village Investments Inc., supra note 143.
[161] Ward c. Godina (1994), CHRR Doc. 94-130 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[162] Desroches c. Québec (Comm. des droits de la personne) (1997), 30 C.H.R.R. D/345 (C.A. Qué.).
[163] Cunanan c. Boolean Developments Limited, supra note 158. Voir aussi Fakhoury c. Las Brisas Ltd., supra note 157.
[164] Report of the Mayor’s Homelessness Action Task Force, supra note 19 at 91.
[165] Khosla, P. supra note 156, p. 23 et suivantes.
[166] St. Hill c. VRM Investments Ltd. (2004), CHRR Doc. 04-023. 2004 TDPO 1.
[167] Voir, par exemple, Huot c. Chow (1996), CHRR Doc 96-178 (B.C.C.H.R.).
[168] St. Hill c. VRM Investments Ltd, supra note 166, paragr. 29.
[169] Le Code autorise, dans certains cas, le traitement préférentiel des personnes âgées. Par exemple, l’article 15 autorise les logements réservés aux personnes âgées de plus de 64 ans; l’article 14 autorise les programmes spéciaux visant à alléger un préjudice ou un désavantage, tels que des projets de logements sans barrières destinés aux personnes âgées handicapées; et l’article 18 protège les groupements religieux, philanthropiques, éducatifs, de secours mutuel ou social, dont le principal objectif est de servir les intérêts des personnes âgées et dont une partie des services consiste à fournir des logements. En revanche, il n’est pas permis d’invoquer un « mode de vie adulte » pour exclure d’un logement des enfants ou des personnes dont l’âge est inférieur à une certaine limite. Voir Commission ontarienne des droits de la personne, Politique sur la discrimination fondée sur l’âge à l’endroit des personnes âgées (Imprimeur de la Reine, Toronto, 2002), [En ligne]. [http://www.ohrc.on.ca] [ci-après appelée Politique relative à l’âge].
[170] Page, S. « Accepting the Gay Person: Rental Accommodation in the Community » (1998), Journal of Homosexuality, no 36(2), p. 31.
[171] Ibid., p. 37.
[172] Voir A. c. Colloredo-Mansfeld (no 3) (1994), 23 C.H.R.R. D/328 (Com. d’enq. de l’Ont.) et Grace c. Mercedes Homes Inc. (no 1) (1995), 23 C.H.R.R. D/350 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[173] Voir, par exemple, Québec (Comm. des droits de la personne et des droits de la jeunesse) et Dubé c. Martin (1997), 33 C.H.R.R. D/487 (T.D.P.Q.), cause dans laquelle un tribunal du Québec a jugé que tenter d’invoquer la liberté de religion pour justifier une politique de refus de location aux personnes homosexuelles était inacceptable. Voir également Outingdyke c. Irving Apartments Ltd. (2005), CHRR Doc. 05-565, 2005 BCHRT 443.
[174] Fondé sur la définition d’« âge » dans l’article 10 du Code. Cependant, le paragraphe 4(1) du Code garantit aussi un traitement égal en matière de logement aux personnes de 16 et 17 ans qui ne dépendent plus de l’autorité parentale.
[175] Arzem c. Ontario (ministère des Services sociaux et communautaires (No 6) (2006), 56 C.H.R.R. D/426, 2006 TDPO 17, dans le contexte des plaintes pour discrimination relative à l’offre de services aux personnes autistes fondée sur l’âge et le handicap.
[176] Sinclair c. Morris A. Hunter Investments Ltd. (2001), 41 C.H.R.R. D/98 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[177] Pour une cause connexe, voir Dominion Management c. Vellenosi (1989), 10 C.H.R.R. D/6413 (Com. d’enq. de l’Ont.) : une commission d’enquête de l’Ontario a jugé que la plaignante, une femme de 37 ans, avait été victime de discrimination fondée sur l’âge parce que les propriétaires préféraient louer à des couples plus âgés et plus riches. Voir également Garbett c. Fisher (1996), 25 C.H.R.R. D/379 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[178] Bushek c. Registered Owners of Lot SL 1, Plan LMS13, Dist. Lot 384A, New Westminister Land Dist. (1997), CHRR Doc. 97-224, paragr. 48 (B.C.C.H.R.). Voir aussi Watkins c. Cypihot (2000), CHRR Doc. 00-036, 2000 BCHRT 13, et Cunanan c. Boolean Developments Limited, supra note 158.
[179] Engeland, Lewis, Ehrlich & Che, supra note 13 p. 50-51.
[180] Voir la Politique relative à l’âge de la Commission pour de plus amples renseignements sur l’interprétation du Code par la Commission en ce qui concerne la discrimination en matière de logement et les personnes âgées, supra note 169.
[181] Voir l’Annexe B, Glossaire des termes, pour la définition complète de « handicap ».
[182] Yale c. Metropoulos (1992), 20 C.H.R.R. D/45 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[183] Voir Di Marco c. Fabcic (2003), supra note 87.
[184] Julie Ramsey c. S.W.M. Investments (22 août 1994), No 642 (Com. d’enq. de l’Ont.) [non publié].
[185] Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario, 1992, L.O.1992, c. 23.
[186] En mars 2002, la Commission a communiqué de nombreuses propositions au ministère des Affaires municipales et du logement au sujet des exigences du Code du bâtiment en matière d’accès facile. La Commission a indiqué des moyens d’incorporer des principes relatifs aux droits de la personne dans le Code du bâtiment, et a mis l’accent sur la nécessité d’une meilleure harmonisation entre les deux Codes. On peut consulter l’exposé complet présenté par la Commission dans le cadre des consultations sur le Code du bâtiment sur le site Web de la Commission au www.ohrc.on.ca.
[187] Voir, par exemple, Quesnel c. London Educational Health Centre (1995), 28 C.H.R.R. D/474 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[188] Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 2005, L.O. 2005, c. 11.
[189] Aquilina c. Pokoj (1991), 14 C.H.R.R. D/230 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[190] Weiher c. Polhill (2003), 47 C.H.R.R. D/104, 2003 TDPO 13.
[191] Voir également la discussion sur les obstacles à la création de logements abordables et avec services de soutien pour les personnes handicapées dans la section consacrée à l’accès à des logements locatifs abordables.
[192] Page, supra note 170.
[193] Iness c. Caroline Co-operative Homes Inc., supra note 42.
[194] Ibid., parag. 43.
[195] Falkiner c. Ontario (ministère des Services sociaux et communautaires), supra note 145.
[196] Willis c. David Anthony Philips Properties (1987), 8 C.H.R.R. D/3847 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[197] Kostanowicz c. Zarubin (1994), 28 C.H.R.R. D/55 (Com. d’enq. de l’Ont.).
[198] Québec (Comm. des droits de la personne) c. Whittom (1993), 20 C.H.R.R. D/349 (Trib. Qué.), appel accueilli, Whittom c. Québec (Comm. des droits de la personne) (1997), 29 C.H.R.R. D/1 (C.A. Qué.).
[199] Québec (Comm. des droits de la personne) c. Gauthier (1993), 19 C.H.R.R. D/312 (T.D.P.Q. ) [Résumé en anglais].
[200] Québec (Comm. des droits de la personne) c. Coutu (No 2) (1995), 26 C.H.R.R. D/31 (Trib. Qué.).
[201] Garbett c. Fisher, supra note 177.
[202] Voir Larson c. Graham (1999), 35 C.H.R.R. D/382 (B.C.H.R.T.).
[203] Renseignements tirés de [http://www.toronto.ca/socialservices/Policy/Basic.htm] (date de consultation : 9 janvier 2007).
[204] Le rapport Golden sur les sans-abri recommandait que le volet logement de l’aide sociale qui, à l’heure actuelle, désavantage Toronto, soit ajusté pour refléter les conditions du marché local. Voir Report of the Mayor’s Homelessness Action Task Force, supra note 19, p. vii.
[205] Information tirée de Engeland, Lewis, Ehrlich & Che, supra note 13 à 45.
[206] Toronto Community and Neighbourhood Services, Social Assistance and Social Inclusion: Findings from Toronto Social Services’ 2003 Survey of Single Parents on Ontario Works (juin 2004), [En ligne] [http://www.toronto.ca/socialservices/pdf/singleparentsurvey.pdf].
[207] Ministère des Services sociaux et communautaires, Ontario au travail : Rapport statistique trimestriel, (décembre 2006), [En ligne].[http://www.mcss.gov.on.ca/NR/rdonlyres/D9824999-9F95-4BC7-9C78-BDCF943C… df].
[208] Les taux de l’aide sociale ont été augmentés de 3 % pour les prestataires d’OT et du POSPH début 2005 et de 2 % en 2006. Le montant maximum d’allocation-logement dans le cadre d’Ontario au travail se situe entre 342 $ par mois pour une personne seule et 708 $ par mois pour une famille de six personnes ou plus. Un parent seul avec deux enfants recevrait une allocation-logement de 583 $ par mois, plus une allocation pour besoins essentiels de 602 $ par mois (selon l’âge des enfants), soit un revenu mensuel maximum de 1185 $; mémoire du ministère des Services sociaux et communautaires, Consultation sur l’état familial et Income Security Advocacy Centre, Social Assistance Rates Fact Sheet, [En ligne].[http://www.incomesecurity.org/documents/2PercentIncreaseDetailedFactshe…].
[209] Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, conclusions finales : Canada, (20 mars 2003, A/58/38(Part I), paragr. 336-389 à 357-8.